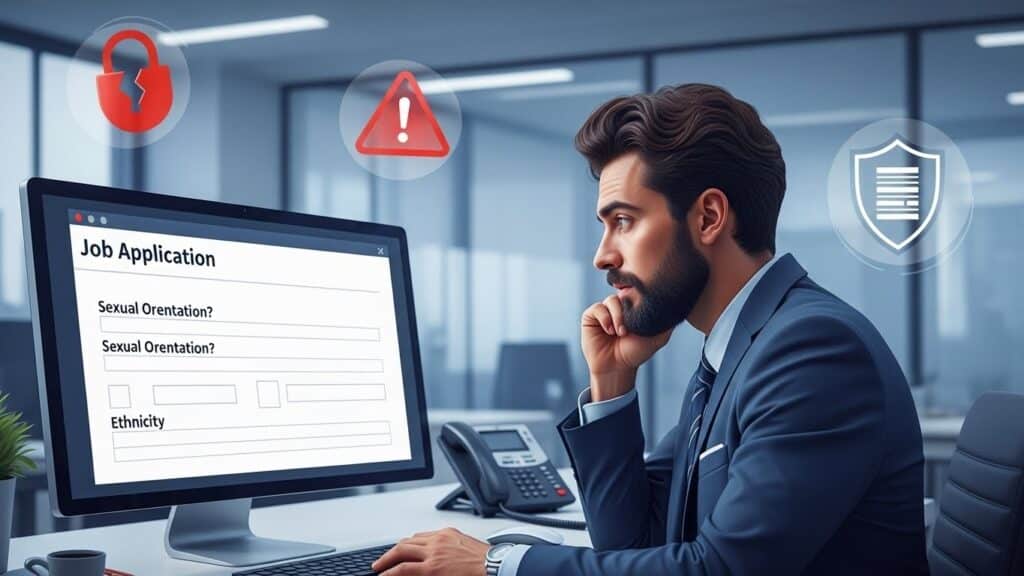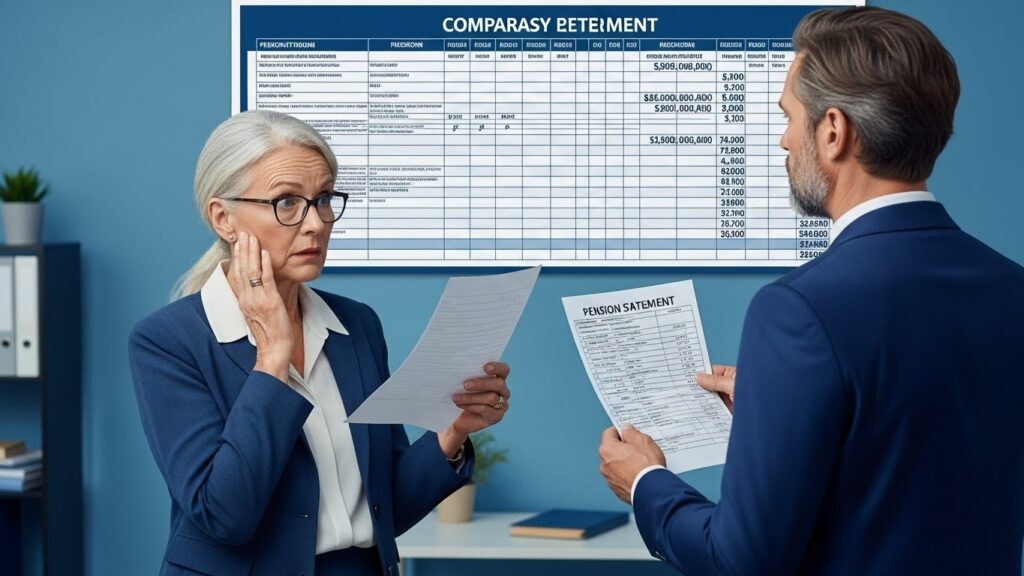Vous arrive-t-il parfois de regarder votre agenda et de vous dire que 24 heures dans une journée, c’est vraiment trop court ? Moi, oui. Et puis je tombe sur cette annonce et, franchement, je me demande si certains ne vivent pas dans une dimension parallèle.
Une jeune pousse suisse, spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à l’industrie, vient de publier une offre d’emploi qui laisse tout le monde pantois : entre 80 et 100 heures de travail par semaine, un salaire annuel autour de 75 000 euros, des actions dans la société et… un logement en colocation juste à côté du bureau. Cerise sur le gâteau : l’entreprise précise noir sur blanc qu’elle « ne croit pas à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ».
Autant vous dire que la toile s’est enflammée. Et pourtant, en quelques jours à peine, plus de mille deux cents personnes ont postulé. Alors, génie du recrutement ou dérapage assumé ? C’est ce qu’on va essayer de comprendre ensemble.
Quand une simple annonce remet tout en question
Il y a des annonces qui passent inaperçues et d’autres qui font l’effet d’une petite bombe. Celle-ci appartient clairement à la seconde catégorie.
Le poste ? Responsable du développement. Le lieu ? Près de Zurich. Le rythme ? Entre 11 et 14 heures par jour, sept jours sur sept, avec « quelques dimanches de repos » offerts comme une faveur royale. Le salaire ? Correct sans être fou pour le niveau de vie suisse. Et la philosophie maison affichée sans filtre : on cherche des « fondateurs », pas des salariés classiques.
« Les fondateurs travaillent entre 80 et 100 heures par semaine, selon l’intensité du moment. Je pense qu’il est légal de passer mon temps comme je le souhaite. C’est la vie dans une start-up, style Silicon Valley. »
Le dirigeant de l’entreprise
Difficile de faire plus clair. On assume, on revendique, on ne s’excuse pas.
La Suisse, ce pays où 42 heures est déjà « beaucoup »
Petit rappel utile : en Suisse, la durée légale maximale du travail est généralement fixée à 45 heures par semaine, voire 50 dans certains secteurs. Au-delà, c’est illégal, point. Les conventions collectives tournent plutôt autour de 40-42 heures. Bref, on est très loin du compte ici.
Des juristes spécialisés en droit du travail ont déjà pointé du doigt une violation flagrante de la législation. Et pourtant, l’annonce reste en ligne et les candidatures pleuvent. Étonnant ? Pas tant que ça quand on gratte un peu.
Pourquoi autant de candidats malgré tout ?
C’est là que ça devient intéressant. Sur les réseaux professionnels, les réactions oscillent entre indignation totale et… curiosité assumée.
- Certains y voient l’opportunité ultime : actions dans une boîte qui lève des fonds, proximité immédiate avec les fondateurs, montée en compétence express.
- D’autres se disent que deux ou trois ans à ce rythme peuvent valoir une carrière entière ailleurs.
- Et puis il y a ceux qui rêvent simplement du « mythe Silicon Valley » : dormir sous son bureau, coder jusqu’au bout de la nuit, devenir millionnaire avant 30 ans.
J’avoue que je comprends le fantasme. J’ai moi-même croisé, il y a quelques années, des trentenaires qui sortaient de ce genre d’expérience avec un CV en or et des cernes assortis. La plupart tenaient le coup… pendant un temps.
Le revers de la médaille : santé mentale et burn-out
Maintenant, soyons sérieux deux minutes. Travailler 100 heures par semaine, ça veut dire quoi concrètement ?
- Moins de 5 heures de sommeil par nuit en moyenne (si tout va bien).
- Presque aucun moment pour la famille, les amis, le sport, la lecture, ou simplement… ne rien faire.
- Un risque démultiplié de dépression, d’épuisement professionnel, voire de problèmes cardiaques à long terme.
Des études montrent que dépasser 55 heures hebdomadaires augmente déjà fortement les risques d’AVC. À 100 heures, on entre dans une zone où le corps dit stop, tôt ou tard. Et souvent plus tôt que prévu.
« Le cerveau humain n’est pas conçu pour fonctionner à ce régime de façon durable. On peut sprinter, pas courir un marathon à la vitesse du 100 mètres. »
Un neuropsychologue spécialisé dans le monde de l’entreprise
La culture start-up : héroïsation de l’épuisement
Ce qui me frappe le plus, c’est à quel point cette histoire cristallise un débat qui dépasse largement la Suisse. On glorifie encore et toujours ceux qui « dorment jamais », qui « vivent pour leur boîte ». Le hustle porn, comme disent les Anglo-Saxons.
Pourtant, les mentalités bougent. De plus en plus de jeunes talents refusent ce modèle. Ils préfèrent des entreprises qui parlent de semaine de quatre jours, de déconnexion réelle le soir, de congés illimités (quand c’est sérieux). Et ils ont raison.
Même dans la Silicon Valley tant admirée, des voix s’élèvent. Des ingénieurs témoignent anonymement du prix payé : divorces, anxiété chronique, perte de sens. Le mythe commence à se fissurer.
Et si c’était (un peu) légal malgré tout ?
Techniquement, un adulte peut choisir de travailler autant qu’il veut… tant que l’employeur ne l’impose pas formellement. Le diable se cache dans les détails : si l’entreprise écrit noir sur blanc 80-100 heures dans le contrat, elle s’expose à des sanctions. Si c’est juste « la culture maison » et que personne ne signe ça, c’est plus flou.
En pratique, beaucoup de start-ups fonctionnent comme ça : on ne compte pas les heures, on récompense l’engagement total, et ceux qui craquent partent sans faire de vagues. C’est moralement discutable, mais souvent toléré.
Le paradoxe du salaire et du niveau de vie suisse
Autre point qui fait grincer des dents : le salaire proposé reste en dessous de la médiane suisse pour des profils très qualifiés (Master d’universités prestigieuses exigé). À Zurich, avec le coût du logement, de la santé, des crèches, 75 000 euros annuels, ce n’est pas l’eldorado.
En gros, on demande un sacrifice énorme pour une rémunération qui, ailleurs en Suisse, s’obtient avec 40-45 heures par semaine. Le calcul est rapide : le taux horaire fond comme neige au soleil.
Que nous dit cette polémique sur notre rapport au travail en 2025 ?
À mon sens, cette histoire agit comme un révélateur brutal. Elle montre que deux mondes coexistent encore :
- Celui de ceux qui sont prêts à tout brûler pour « réussir vite ».
- Celui, de plus en plus large, qui préfère une vie équilibrée, durable, humaine.
Et vous, dans quel camp vous situez-vous ? Personnellement, j’ai passé l’âge de croire que dormir sous son bureau rend plus performant. L’expérience m’a appris que les meilleures idées viennent souvent… quand on se repose vraiment.
Cette annonce, aussi extrême soit-elle, a au moins le mérite de poser la question sans détour : jusqu’où est-on prêt à aller pour « réussir » ? Et surtout, qui définit la réussite ?
Parce qu’au final, une start-up qui explose en quelques années, c’est génial. Mais une vie consumée en chemin, ça, personne ne la rembourse.
Et vous, qu’en pensez-vous ? Laissez-moi votre avis en commentaire, je suis curieux de connaître votre point de vue sur cette nouvelle forme d’engagement professionnel. La passion justifie-t-elle tout ? Ou sommes-nous en train de franchir une ligne rouge collective ?