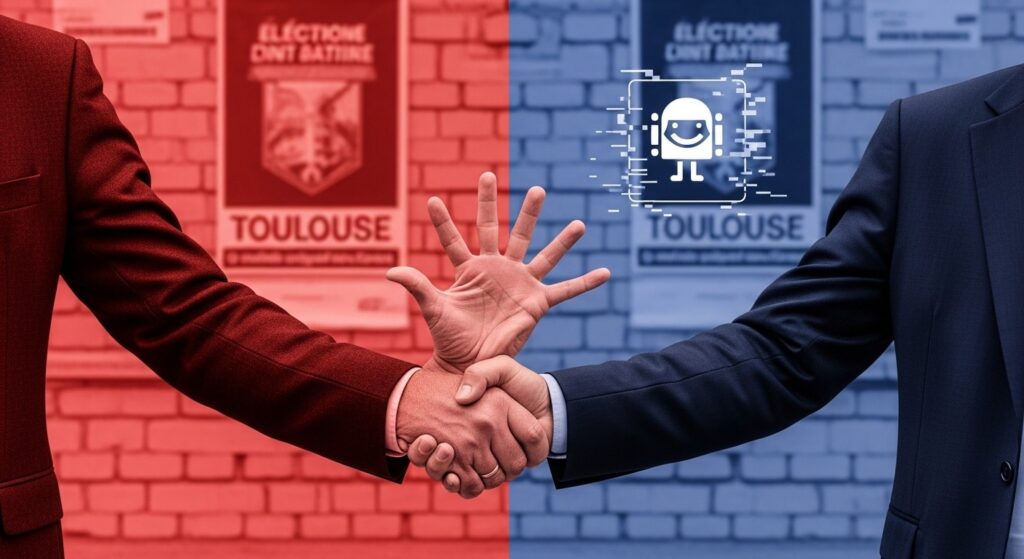Imaginez un objet si puissant qu’il peut parler à tout un village, transmettre des messages sacrés ou alerter d’un danger imminent. Cet objet, c’est le tambour parleur Djidji Ayôkwé, un géant de trois mètres de long, pesant 430 kg, qui a traversé un siècle d’histoire tumultueuse. Volé en 1916 par les autorités coloniales françaises en Côte d’Ivoire, il s’apprête enfin à rentrer chez lui, après un vote décisif à l’Assemblée nationale française. Pourquoi ce retour est-il bien plus qu’une simple restitution d’un artefact ? C’est une plongée dans l’histoire coloniale, la quête de justice culturelle et un symbole d’espoir pour les communautés africaines.
Un Trésor Sacré aux Racines Profondes
Le tambour parleur n’est pas un simple instrument de musique. Chez le peuple ébrié de Côte d’Ivoire, il est une voix, un lien spirituel, un outil de communication essentiel. Utilisé pour transmettre des messages rituels ou prévenir les villageois lors d’événements majeurs, comme des recrutements forcés sous la colonisation, il incarnait l’âme d’une communauté. J’ai toujours trouvé fascinant comment un objet, en apparence simple, peut porter autant de significations. Mais comment un tel trésor a-t-il quitté son foyer ?
Un Vol Colonial en 1916
En 1916, les autorités coloniales françaises s’emparent du Djidji Ayôkwé, arrachant cet objet sacré à la communauté ébrié. Treize ans plus tard, en 1929, il est envoyé en France pour être exposé, d’abord au musée du Trocadéro, puis au musée du quai Branly. Imaginez la douleur d’une communauté voyant son patrimoine spirituel transformé en simple curiosité de musée. Ce tambour, qui autrefois résonnait dans les villages ivoiriens, s’est retrouvé enfermé dans une caisse, loin de son sol natal. Une question me taraude : combien d’autres objets africains dorment encore dans des réserves européennes ?
Le tambour était plus qu’un instrument, c’était une voix qui unissait nos ancêtres.
– Membre d’une association culturelle ivoirienne
Une Demande de Restitution Portée Depuis l’Indépendance
La Côte d’Ivoire n’a pas attendu 2019 pour réclamer son tambour. Dès l’indépendance en 1960, les communautés ébrié ont exprimé leur désir de récupérer cet objet sacré. Pourtant, il a fallu attendre une demande officielle d’Abidjan, il y a six ans, pour que le processus s’enclenche véritablement. Ce délai, franchement, donne à réfléchir. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour reconnaître une injustice aussi évidente ? La restitution, prévue après un vote à l’Assemblée nationale, marque un tournant. Mais elle soulève aussi des questions sur la lenteur des démarches françaises.
Un Symbole de Réparation Culturelle
Ce retour n’est pas seulement celui d’un objet. Il s’agit d’un acte de réparation culturelle, un pas vers la reconnaissance des méfaits du colonialisme. Selon des experts, ce tambour pourrait devenir un symbole fort pour la Côte d’Ivoire, un peu comme les 26 trésors d’Abomey rendus au Bénin en 2021. Mais ce qui me frappe, c’est l’émotion que ce retour suscite. Pour les Ébrié, récupérer le Djidji Ayôkwé, c’est raviver une part de leur identité, de leur histoire. C’est comme si un morceau de leur âme rentrait enfin à la maison.
- Le tambour servait à transmettre des messages rituels.
- Il alertait les villageois en cas de danger ou d’enrôlement forcé.
- Son retour symbolise une reconnaissance des injustices coloniales.
Un Processus Français Critiqué
La France a été l’une des premières nations à s’engager dans la restitution d’objets pillés, notamment après un discours marquant d’Emmanuel Macron en 2017. Pourtant, aujourd’hui, elle semble à la traîne. Depuis une loi de 2020, seules 27 œuvres ont été rendues à des pays africains, un chiffre dérisoire face aux milliers d’objets encore conservés dans les musées européens. Des anthropologues pointent du doigt une certaine rétention d’informations sur les collections françaises, contrairement à l’Allemagne, qui a entamé un véritable travail d’inventaire. Franchement, ça fait grincer des dents.
| Pays | Objets restitués | Année |
| Bénin | 26 trésors d’Abomey | 2021 |
| Sénégal | Sabre d’El Hadj Omar | 2021 |
| Côte d’Ivoire | Tambour Djidji Ayôkwé | 2025 (prévu) |
Ce tableau montre bien la lenteur du processus. Chaque restitution nécessite une loi spécifique, un parcours administratif long et complexe, à cause du principe d’inaliénabilité des collections publiques. Une loi-cadre, promise depuis des années, pourrait simplifier les choses. Mais, pour l’instant, elle reste un vœu pieux. Pourquoi tant de réticence ? Est-ce une peur de trop regarder le passé colonial en face ?
Les Enjeux d’une Loi-Cadre
Une loi-cadre pour les restitutions d’objets coloniaux a été annoncée, mais son adoption traîne. En 2023, des textes sur les biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale et les restes humains ont vu le jour. Mais pour les objets pillés pendant la colonisation, le chemin est semé d’embûches. Selon des sources proches du dossier, un projet transmis en 2024 au Conseil d’État a été retoqué, car il manquait d’un « intérêt général supérieur » pour justifier une dérogation à l’inaliénabilité. Ce terme, un peu jargonneux, cache un vrai débat : la France est-elle prête à assumer pleinement son passé impérial ?
La restitution ne doit pas être vue comme une repentance, mais comme un acte de justice.
– Anthropologue spécialisée en patrimoine africain
Ce débat, parfois épineux, met en lumière une tension. D’un côté, il y a la volonté de réparer les injustices. De l’autre, une crainte d’ouvrir une boîte de Pandore, où chaque restitution pourrait être perçue comme une remise en question de l’histoire française. Personnellement, je trouve qu’il est temps de dépasser cette peur. Reconnaître les erreurs du passé, c’est aussi construire un avenir plus juste.
Un Symbole pour l’Afrique et au-delà
Le retour du Djidji Ayôkwé n’est que le début. La Côte d’Ivoire a dressé une liste de 148 œuvres qu’elle souhaite récupérer. Ce tambour, premier de la liste, pourrait ouvrir la voie à d’autres restitutions. Mais au-delà de la Côte d’Ivoire, c’est tout le continent africain qui regarde. Des pays comme le Nigeria, l’Éthiopie ou le Mali ont eux aussi des trésors dans les musées européens. Ce retour pourrait-il inspirer un mouvement plus large ?
- Première étape : reconnaître l’origine des objets pillés.
- Deuxième étape : établir un dialogue avec les pays demandeurs.
- Troisième étape : simplifier les processus légaux pour accélérer les restitutions.
Ce processus, bien qu’imparfait, montre une volonté de dialogue. Mais il faudra plus qu’un tambour pour réparer des décennies de spoliation. Ce qui me marque, c’est l’espoir que ce retour suscite. Pour les Ébrié, c’est une victoire culturelle. Pour le monde, c’est un rappel que le patrimoine appartient d’abord à ceux qui l’ont créé.
Et Après ?
Le vote de l’Assemblée nationale, prévu ce lundi, devrait sceller le retour du tambour. Mais ce n’est qu’une étape. Une fois rapatrié, le Djidji Ayôkwé retrouvera-t-il sa place dans les rituels ébrié ? Ou deviendra-t-il un symbole muséal en Côte d’Ivoire ? Ces questions restent ouvertes. Ce qui est sûr, c’est que ce retour marque un précédent. D’autres pays pourraient s’en inspirer pour réclamer leur patrimoine.
En attendant, la France doit accélérer. Une loi-cadre claire, un inventaire transparent des collections, et une volonté politique forte sont nécessaires. Sinon, les restitutions resteront des gouttes d’eau dans un océan d’injustices. Et si on osait enfin regarder l’histoire en face ?
Chaque objet restitué est une page d’histoire rendue à son peuple.
Le tambour parleur Djidji Ayôkwé, après un siècle d’exil, s’apprête à résonner à nouveau sur sa terre natale. Ce n’est pas juste un retour, c’est un symbole. Un symbole de justice, de mémoire, et peut-être, d’un avenir où le patrimoine africain retrouve sa place. Et ça, c’est une histoire qui mérite d’être racontée.