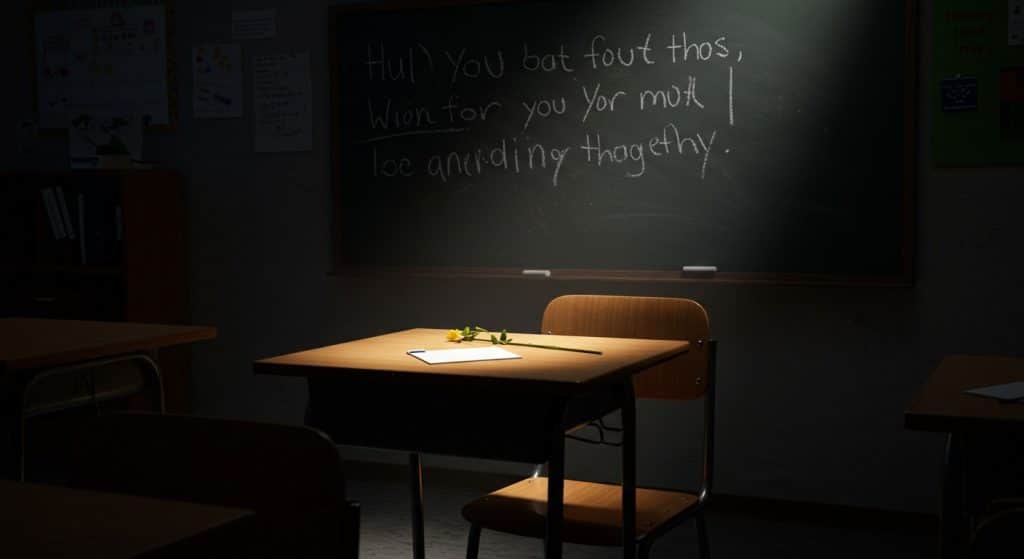Vous êtes-vous déjà demandé qui sont ces figures dont les noms résonnent dans l’histoire, gravés dans la pierre d’un lieu aussi solennel que le Panthéon ? Ce temple républicain, niché au cœur de Paris, n’est pas seulement un mausolée : c’est un miroir de nos valeurs, un hommage à ceux qui ont façonné la France par leurs combats. Aujourd’hui, alors que Robert Badinter, l’homme qui a fait tomber la guillotine, y fait son entrée, une question se pose : qui sera le prochain à rejoindre ce cénacle des grands ?
Le Panthéon, c’est plus qu’un monument. C’est un symbole, un lieu où la France célèbre ceux qui ont marqué son âme. Avec l’arrivée de Badinter, artisan de l’abolition de la peine de mort, et l’annonce de l’entrée prochaine de Marc Bloch, résistant et historien, en 2026, le débat s’intensifie. Des noms circulent, des figures émergent, portées par des combats universels : féminisme, liberté d’expression, justice. Dans cet article, je vous emmène dans les coulisses de cette question brûlante, avec quelques réflexions personnelles sur ce que ces choix disent de nous.
Un Panthéon, des Valeurs, une Nation
Le Panthéon n’est pas un simple club VIP de l’histoire. Chaque entrée est un message, un choix politique et symbolique. Depuis 1958, le président de la République a le pouvoir de proposer une panthéonisation, mais il faut l’accord des familles pour sceller ce destin. Ce processus, à la croisée de l’histoire et de la mémoire collective, reflète les combats que la France veut honorer. Mais alors, qui pourrait succéder à Badinter et Bloch ?
Gisèle Halimi : une icône féministe
Quand on parle de figures contemporaines, un nom revient avec force : Gisèle Halimi. Cette avocate, disparue en 2020, a marqué l’histoire par son engagement sans faille pour les droits des femmes. Son combat pour la dépénalisation de l’avortement dans les années 1970, notamment lors du procès de Bobigny, a changé la donne. Elle n’a pas seulement défendu des femmes en détresse, elle a bousculé une société patriarcale, forçant la France à regarder ses contradictions en face.
Le combat pour les droits des femmes est un combat pour la justice universelle.
– Une militante féministe
Mais son parcours ne s’arrête pas là. Halimi s’est aussi illustrée pendant la guerre d’Algérie, défendant des militants du FLN, ce qui lui a valu des critiques acerbes, notamment de la droite et des communautés harkis. Ces controverses, loin de ternir son héritage, montrent la complexité d’une femme qui n’a jamais reculé face à l’adversité. Depuis plusieurs années, des voix s’élèvent – pétitions, parlementaires, et même des promesses présidentielles – pour que son nom soit gravé au Panthéon. Personnellement, je trouve que son entrée serait un signal fort, surtout dans une époque où les droits des femmes sont parfois fragilisés.
Alfred Dreyfus : symbole de justice
Un autre nom émerge avec insistance : Alfred Dreyfus. Ce militaire, victime d’une injustice criante à la fin du XIXe siècle, incarne le combat contre l’antisémitisme et pour la vérité. Condamné à tort pour trahison en 1894, exilé sur l’île du Diable, Dreyfus a été au cœur d’une affaire qui a divisé la France. Les dreyfusards, menés par Émile Zola et son célèbre « J’accuse », ont transformé ce scandale en un symbole universel de lutte pour la justice.
Aujourd’hui, alors que l’antisémitisme refait surface sous de nouvelles formes, honorer Dreyfus au Panthéon serait un rappel puissant. Selon des proches du président, cette réflexion est en cours depuis longtemps. Une commémoration annuelle a même été instaurée récemment pour réhabiliter sa mémoire. Son arrière-petit-fils, favorable à cette panthéonisation, y voit une manière de rappeler les valeurs du dreyfusisme. Et franchement, dans un monde où la vérité est parfois malmenée, qui pourrait mieux incarner ce combat ?
Charb : la liberté d’expression à l’honneur
Et puis, il y a Charb. Ce nom résonne comme un cri. Dessinateur et directeur de Charlie Hebdo, il a été assassiné en 2015 lors de l’attentat qui a décimé la rédaction du journal satirique. Sa plume, acérée et sans compromis, incarnait la liberté d’expression. Proposer son entrée au Panthéon, comme le suggèrent ses proches et son successeur à la tête du journal, serait un geste fort pour ancrer cet événement tragique dans la mémoire nationale.
Charb représentait les valeurs mêmes de notre démocratie, celles pour lesquelles il est mort.
– Un proche du dessinateur
Pourtant, l’idée divise. Charb lui-même, connu pour son rejet des honneurs, aurait-il approuvé ? Probablement pas. Mais comme le souligne son entourage, il ne s’agit pas d’une récompense, mais d’un symbole. Honorer Charb, c’est dire que la France ne plie pas face à la peur. C’est un choix qui me touche particulièrement, parce que la liberté de dire, d’écrire, de dessiner, c’est le socle de tout le reste.
Les femmes au Panthéon : un déséquilibre à corriger
Si on regarde la liste des pensionnaires du Panthéon, un constat saute aux yeux : les femmes sont rares. Sur 83 figures, seules sept femmes y reposent. Simone Veil, Joséphine Baker, et récemment Mélinée Manouchian ont rejoint ce cercle restreint sous la présidence actuelle. Mais ce déséquilibre est criant, et il est temps de le corriger.
Prenez Olympe de Gouges. Cette pionnière du féminisme, auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, milite dès la Révolution française pour l’égalité et l’abolition de l’esclavage. Son nom circule depuis des décennies, porté par des artistes, des pétitions, et même des fictions récentes. Dans un monde où les droits des femmes sont parfois menacés, son entrée serait un symbole fort, un clin d’œil à celles qui se battent encore aujourd’hui.
- Olympe de Gouges : pionnière du féminisme et de l’abolitionnisme.
- Adélaïde Hautval : résistante, Juste parmi les nations, figure de la dignité humaine.
- Rose Valland : conservatrice ayant sauvé 60 000 œuvres d’art des nazis.
- Madeleine Riffaud : résistante, poétesse et journaliste, récemment disparue.
Adélaïde Hautval, par exemple, incarne le courage face à l’horreur. Médecin psychiatre, elle a refusé de participer aux expérimentations nazies, défendant la dignité humaine au péril de sa vie. Rose Valland, elle, a sauvé des milliers d’œuvres d’art spoliées pendant la guerre, un exploit qui lui a valu d’être nommée capitaine par de Gaulle. Quant à Madeleine Riffaud, résistante torturée par la Gestapo, elle a continué à porter haut les valeurs de liberté à travers son travail de journaliste. Ces femmes, souvent méconnues, méritent qu’on se penche sur leur héritage.
Un symbole à réinventer ?
Le Panthéon, c’est aussi une question d’identité. Sa devise, « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante », semble d’un autre temps. Certains, comme une ancienne ministre, proposent de la moderniser pour inclure explicitement les femmes. Pourquoi pas ? Cela pourrait envoyer un message clair aux nouvelles générations, en particulier aux jeunes filles, qui ont besoin de modèles forts.
| Figure | Combat principal | Impact |
| Gisèle Halimi | Féminisme, avortement | Changement législatif et sociétal |
| Alfred Dreyfus | Justice, antisémitisme | Symbole universel de vérité |
| Charb | Liberté d’expression | Martyre de la presse libre |
| Olympe de Gouges | Féminisme, abolition esclavage | Pionnière des droits humains |
Ce tableau, loin d’être exhaustif, montre la diversité des combats portés par ces figures. Chacune, à sa manière, incarne une facette des valeurs républicaines. Mais choisir, c’est aussi renoncer. Le Panthéon ne peut accueillir tout le monde, et chaque décision reflète les priorités d’une époque.
Et après ? Une réflexion collective
Alors, qui choisir ? Gisèle Halimi, pour son combat féministe ? Alfred Dreyfus, pour la justice ? Charb, pour la liberté ? Ou peut-être une figure moins connue, comme Rose Valland ou Madeleine Riffaud, pour rappeler que l’histoire est aussi faite de héros discrets ? Une chose est sûre : chaque panthéonisation est un miroir tendu à la société. Elle nous force à nous interroger sur ce que nous valorisons, sur les combats que nous voulons transmettre.
Personnellement, j’ai un faible pour l’idée d’honorer une femme, parce que leur sous-représentation au Panthéon est presque un scandale. Mais au-delà de mes préférences, ce choix appartient à la nation. Les pétitions, les débats, les propositions montrent une chose : les Français veulent un Panthéon qui leur ressemble, qui porte leurs espoirs et leurs luttes. Et vous, qui verriez-vous rejoindre ce temple de la mémoire ?
Le Panthéon, c’est la France qui se souvient et qui se projette.
En attendant la prochaine décision, une chose est claire : le Panthéon reste un lieu vivant, où l’histoire dialogue avec le présent. Chaque nouvelle entrée est une occasion de redécouvrir ce qui fait la force de la France : sa capacité à se réinventer à travers ses héros. Alors, à qui le tour ?