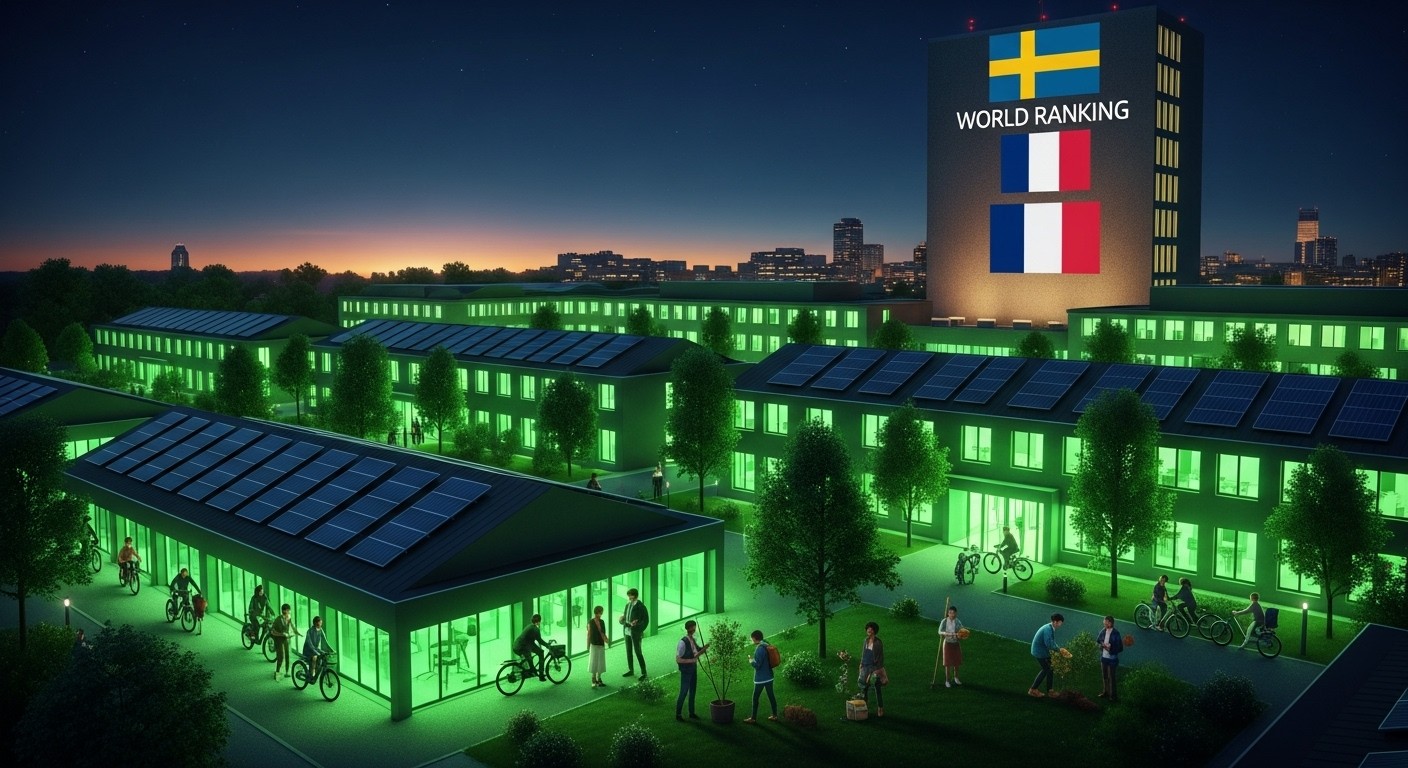Quand j’étais étudiant, on se moquait gentiment des « écolos » qui ramassaient les mégots dans la cour. Aujourd’hui, ces mêmes gestes font grimper une université au sommet des classements mondiaux. Drôle d’époque, non ? Le dernier palmarès consacré à la durabilité des campus vient de tomber et, franchement, il fait mal au moral tricolore.
Le choc du classement 2026 : la Suède prend le pouvoir
Cette année, c’est l’Université de Lund, en Suède, qui décroche la médaille d’or. Oui, vous avez bien lu : une université fondée en 1666, plus vieille que Versailles, truste la première place pour la première fois. Elle détrône Toronto, tenante du titre depuis deux ans, qui glisse à la deuxième marche. Le podium est complété par UCL à Londres. Autrement dit, l’Europe du Nord et le monde anglo-saxon se taillent la part du lion.
Et la France dans tout ça ? Accrochez-vous : une seule université dans le top 50. Paris-Saclay, 45e, perd même six places par rapport à l’an dernier. Derrière, il faut descendre jusqu’à la 61e place pour trouver Sorbonne Université, puis attendre la 109e pour voir l’Institut Polytechnique de Paris faire une remontée spectaculaire (+90 places, bravo quand même).
« On a l’impression que la France fait du sur-place pendant que les autres accélèrent à fond. »
C’est peu dire que ce classement fait grincer des dents dans les amphis français.
Comment on mesure la durabilité d’une université ?
Le système est plutôt malin. On ne regarde pas seulement si le campus a des poubelles de tri (même si ça aide). Trois grands piliers :
- Impact environnemental (45 %) : consommation énergétique, gestion des déchets, biodiversité sur le campus, recherche sur le climat…
- Impact social (45 %) : égalité hommes-femmes, inclusion des minorités, santé mentale des étudiants, employabilité après le diplôme, partenariats avec les ONG…
- Gouvernance (10 %) : transparence des comptes, éthique des recrutements, lutte contre la corruption.
En gros, on juge l’université comme une petite ville qui doit être exemplaire sur tous les plans. Et là, certains pays ont pris très au sérieux le défi.
Pourquoi les universités nordiques écrasent la concurrence
Prenez Lund. L’université s’est fixé l’objectif d’être climate positive d’ici 2030. Ça veut dire non seulement zéro émission nette, mais émettre moins de CO2 qu’elle n’en absorbe. Ils ont déjà couvert 100 % de leurs besoins électriques avec des énergies renouvelables, créé une ferme urbaine sur le campus, et même une monnaie locale pour les étudiants qui font du bénévolat écolo.
Toronto, de son côté, a investi massivement dans la géothermie et a fait de la lutte contre les violences sexuelles une priorité absolue (avec des résultats mesurables). UCL excelle dans la recherche sur le climat et l’ouverture internationale.
Et nous ? On a de très beaux discours, des plans climat ambitieux sur le papier… mais dans les actes peinent à suivre.
La France, championne d’Europe… en nombre, pas en performance
Paradoxe : on reste le pays européen qui place le plus d’universités dans le classement (devant l’Allemagne et l’Espagne). Mais 40 d’entre elles ont perdu des places cette année. Seules sept progressent. Résultat : une chute globale de 44 % du score moyen français. Aïe.
Paris-Saclay reste notre meilleur soldat, grâce notamment à son projet « Springboard » qui vise la neutralité carbone en 2030. Mais même là, on sent la fatigue : les investissements ralentissent, les crédits se font rares, et l’instabilité politique n’aide pas à planifier sur dix ans.
« On demande aux universités d’être des laboratoires de la transition écologique… avec un budget de plus en plus serré et des priorités politiques qui changent tous les six mois. »
– Un responsable de développement durable d’une grande université française (qui préfère rester anonyme)
Ce que veulent vraiment les étudiants
Le plus intéressant, c’est que les jeunes ne s’y trompent pas. Une étude menée auprès de dizaines de milliers d’étudiants montre que la durabilité est devenue le critère numéro 1 pour choisir une fac, juste derrière la qualité de l’enseignement et avant le prestige.
Ils veulent :
- Pouvoir participer concrètement (conseils de durabilité où ils ont vraiment la parole)
- Des cours obligatoires sur le climat et la justice sociale
- Un campus zéro plastique et des menus 50 % végétariens au resto U
- Des partenariats avec des associations locales
Quand une université cochle toutes ces cases, sa réputation explose auprès des 18-25 ans. Et ça, les établissements nordiques l’ont très bien compris.
Les petites pépites françaises qui montent
Parce qu’il y a quand même des raisons d’espérer. L’Institut Polytechnique de Paris fait +90 places en un an – c’est énorme. Sciences Po grimpe aussi discrètement mais sûrement. Certaines écoles d’ingénieurs (Mines, Centrale) commencent à intégrer la fresque du climat dans leurs cursus obligatoires. Et des initiatives étudiantes fleurissent : potagers partagés, repair cafés, défis zéro déchet…
Mais il manque une vraie impulsion nationale. En Suède ou aux Pays-Bas, l’État fixe des objectifs chiffrés et met l’argent qui va avec. Ici, on reste sur des incantations.
Et demain ?
Franchement, j’ai du mal à être optimiste à court terme. Tant que la durabilité restera un « bonus » et non une priorité budgétaire, on continuera à perdre du terrain. Mais à moyen terme, la pression des étudiants va devenir irrésistible. Les générations Z et Alpha ne rigolent pas avec ça. Ils sont prêts à bouder les campus qui traînent des pieds.
Alors oui, aujourd’hui, la France n’a qu’une université dans le top 50 mondial de la durabilité. Mais peut-être que ce classement un peu cruel servira d’électrochoc. Parce qu’on a les cerveaux, les idées, les terrains d’expérimentation. Il ne manque que la volonté politique et les moyens qui vont avec.
En attendant, si vous cherchez une fac où l’écologie n’est pas un gadget marketing, regardez plutôt du côté de Lund, Toronto ou Manchester. Et priez pour que, d’ici cinq ans, on puisse enfin écrire : « La France reprend la tête du peloton vert. »
Parce que, mine de rien, nos enfants nous regardent.