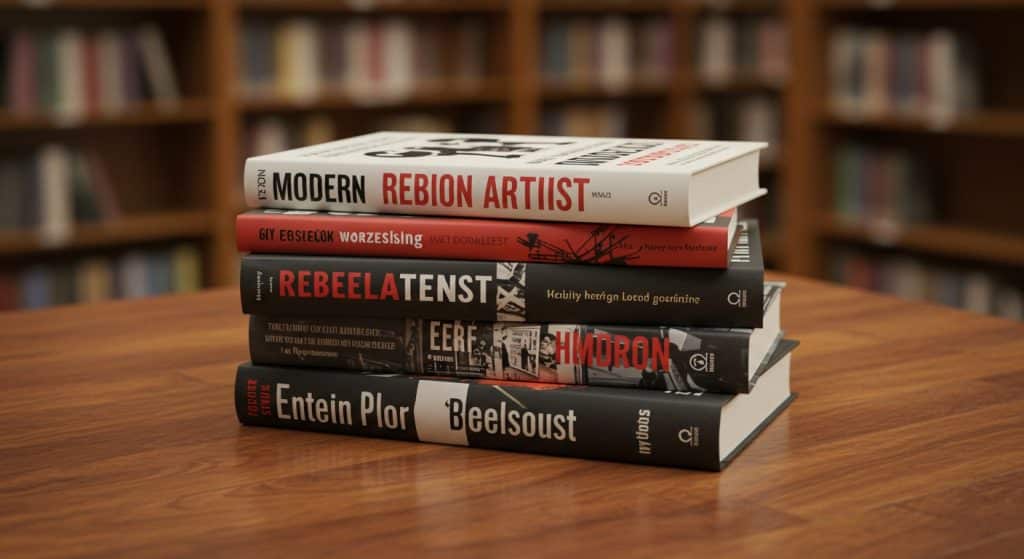Vous êtes tranquillement installé dans votre canapé, un vendredi soir, et vous lancez le dernier film d’un réalisateur que vous adorez depuis vingt ans. Pas de bande-annonce hurlante, pas de pop-corn hors de prix, pas de voisin qui commente. Juste vous, l’écran, et une œuvre magnifique. Le rêve, non ? Sauf que, quelque part, une petite voix vous murmure : « J’aurais préféré le voir en salle… »
Cette petite voix, des milliers de cinéphiles français la ressentent en ce moment même. Parce que, soyons honnêtes, on assiste à un basculement historique : les films les plus ambitieux, ceux qui autrefois auraient fait l’événement sur grand écran, choisissent massivement la diffusion directe sur les plateformes de streaming.
Le streaming est-il en train de tuer le cinéma de prestige ?
La question peut paraître brutale, presque provocatrice. Pourtant, quand on regarde la liste des sorties de ces dernières semaines, on ne peut pas faire autrement que de se la poser. Des projets portés par des noms qui, il y a encore dix ans, auraient trusté les plus belles salles parisiennes pendant des mois, débarquent aujourd’hui sans tambour ni trompette sur nos écrans de salon.
Et le plus fou ? Personne ne semble vraiment s’en émouvoir. Comme si on avait déjà intégré que le cinéma d’auteur à gros budget, celui qui mélange ambition artistique et moyens colossaux, avait trouvé un nouveau terrain de jeu. Plus confortable pour les créateurs. Plus rentable pour les financeurs. Mais forcément moins magique pour nous.
Quand les monstres sacrés du cinéma deviennent des exclusivités numériques
Prenez un réalisateur oscarisé, donnez-lui un budget à neuf chiffres, une star bankable, et demandez-lui où il veut montrer son bébé. Sa réponse, de plus en plus souvent ? « Directement chez les gens. »
C’est un peu ce qui s’est passé récemment avec une relecture très attendue du mythe de Frankenstein. Le film a été tourné avec un soin maniaque, des décors somptueux, des effets spéciaux à couper le souffle. Et pourtant, il n’a jamais connu les honneurs d’une sortie nationale en salles. Quelques festivals, oui. Une poignée de projections exceptionnelles, peut-être. Mais pour le grand public ? Clic, play, et c’est parti.
Idem pour un thriller psychologique ultra-tendu réalisé par une pionnière du cinéma d’action américain, ou encore un drame intimiste porté par une actrice multi-récompensée. Tous ont fait le choix – ou subi la décision – de privilégier la diffusion en ligne.
« On me propose enfin la liberté totale, sans compromis sur la durée ou le ton. Comment refuser ? »
Un réalisateur multi-oscarisé, récemment interrogé sur son passage au streaming
L’argent : la raison qui fait mal, mais qui explique tout
Soyons lucides deux minutes. Faire un film coûte une fortune. Et plus le projet est ambitieux, plus le gouffre financier potentiel effraie les studios traditionnels.
Les plateformes, elles, ont une logique radicalement différente. Elles ne misent pas sur le box-office. Elles misent sur vous, sur moi, sur l’abonné qui va rester fidèle parce qu’il y a « ce » film qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Un seul blockbuster exclusif peut justifier des centaines de milliers de nouveaux abonnements. C’est du marketing pur, mais diablement efficace.
- Budget garanti à 100 %, sans attendre le feu vert des distributeurs
- Aucune pression sur le montage final (exit la course aux 1h50 pour plaire aux exploitants)
- Visibilité mondiale instantanée, sans négocier pays par pays
- Données précises sur ce que le public aime vraiment (et donc moins de risques sur les prochains projets)
Pour un cinéaste, c’est le paradis. Pour un exploitant de salle, c’est l’enfer.
La fenêtre d’exploitation : ce chronomètre qui rendait tout le monde fou
Autrefois, il y avait une règle sacrée : un film devait rester plusieurs mois en salles avant d’espérer une sortie en VOD ou à la télévision. En France, la chronologie des médias est même encadrée par la loi. C’était une manière de protéger les cinémas, ces temples fragiles de la culture.
Mais quand une plateforme finance intégralement un film, elle n’a aucune envie d’attendre. Pourquoi bloquer son propre contenu pendant quatre mois alors qu’elle pourrait le rentabiliser dès le premier jour ? Résultat : les films « streaming first » contournent purement et simplement la case cinéma. Et tant pis pour la chronologie.
J’ai discuté récemment avec un directeur de salle indépendante à Paris. Il m’a confié, un peu amer : « Avant, on avait Scorsese, Cuarón, Campion… Maintenant, on a les suites de comédies franchisées et les films d’animation. Le reste, on le regarde sur Netflix. »
Le Covid a tout accéléré (et on n’a pas vu venir le point de non-retour)
Il faut être honnête : la pandémie a servi de catalyseur. Quand les salles ont fermé pendant des mois, les studios ont pris l’habitude de sortir leurs films directement en ligne. Le public a suivi. Et quand les cinémas ont rouvert, beaucoup de spectateurs avaient déjà pris goût au confort du canapé.
Le plus ironique ? Certains films pensés pour le grand écran ont cartonné en streaming. Du coup, les plateformes se sont dit : « Pourquoi continuer à partager les recettes avec les salles si on peut tout garder ? »
Aujourd’hui, on est clairement passé à l’étape suivante. Ce n’est plus une solution de secours. C’est une stratégie assumée.
Et nous, les spectateurs, on y gagne quoi ?
C’est la grande question qu’on oublie souvent de poser. Parce qu’avouons-le : voir un film chez soi, c’est pratique. C’est moins cher. On peut mettre pause pour aller chercher une bière.
Mais est-ce qu’on vit vraiment la même expérience quand on regarde un chef-d’œuvre sur une télé de 55 pouces plutôt que sur un écran IMAX ? Personnellement, je ne suis pas sûr. Il y a des plans-séquences, des effets sonores, une communion collective qui disparaissent complètement à la maison.
Et puis il y a cette sensation unique de découvrir une œuvre en même temps que des centaines d’inconnus. Ces rires qui fusent, ces soupirs, ces applaudissements spontanés à la fin… Le streaming ne remplacera jamais ça.
Vers un monde à deux vitesses pour le cinéma ?
Ce qui se dessine, c’est une segmentation claire :
- D’un côté, les blockbusters spectaculaires pensés pour les salles (les Marvel, les Mission Impossible, les nouveaux Avatar)
- De l’autre, les films d’auteur ambitieux, les projets risqués, les visions radicales – réservés au streaming
En gros, on garde le popcorn movie pour le cinéma et on relègue le cinéma d’art et d’essai… chez soi. C’est un peu triste quand on y pense.
Certains festivals tentent de résister. Cannes, Venise ou Toronto continuent d’exiger des sorties en salles pour être en compétition. Mais même là, les lignes bougent. Des films présentés en première mondiale dans les plus grands festivals finissent parfois exclusivement sur des plateformes.
Y a-t-il encore de l’espoir pour les salles ?
Oui, je veux y croire. Parce que le cinéma, ce n’est pas seulement un écran. C’est un rituel. Une sortie. Un moment partagé.
Des initiatives existent : des exploitants indépendants qui programment des avant-premières exceptionnelles, des festivals qui négocient des sorties limitées, des réalisateurs qui tiennent encore à défendre leurs films sur grand écran.
Mais il faudra sans doute repenser complètement le modèle. Peut-être des sorties simultanées ? Des fenêtres très courtes ? Des partenariats entre plateformes et salles ? Les solutions existent. Reste à trouver la volonté politique et économique de les mettre en place.
En attendant, je continue d’aller au cinéma dès que je peux. Parce que certains films méritent d’être vus en grand. Vraiment grand. Et parce que, quelque part, j’ai peur que mes enfants ne sachent plus ce que c’est, un vrai samedi soir au ciné.
Et vous, ça vous fait quoi, tout ça ? Dites-le-moi en commentaire. On en discute ensemble.