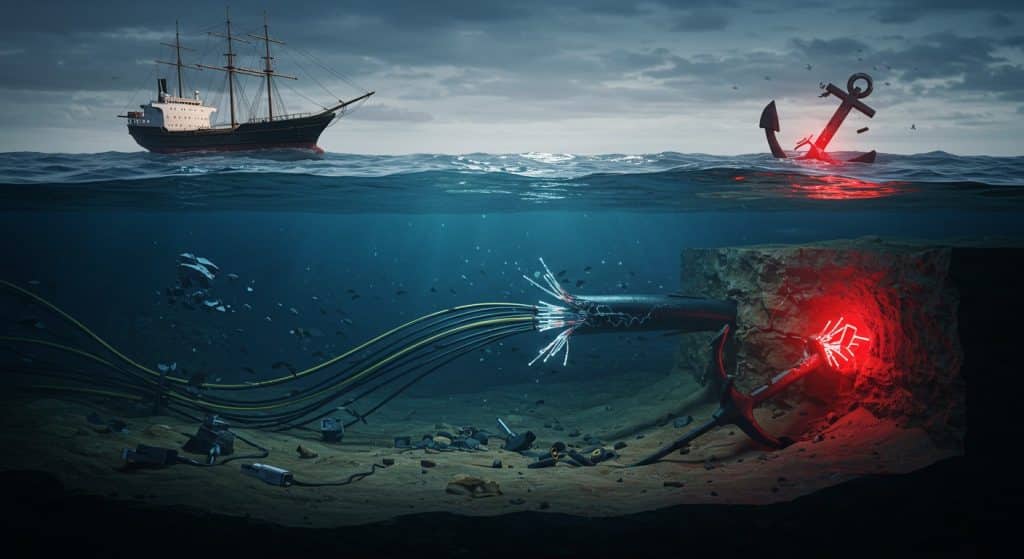Imaginez la scène : après deux semaines de négociations sous une chaleur écrasante à Belém, près de deux cents pays lèvent la main pour dire « oui » à un texte commun. Applaudissements polis, sourires crispés, et pourtant… quelque chose cloche. On vient de signer un accord climatique mondial sans jamais prononcer clairement la phrase qui aurait tout changé : « voici le calendrier pour sortir des énergies fossiles ». Frustrant, non ?
C’est exactement ce qui s’est passé ce samedi à la COP30. Un accord unanime, oui. Un texte qui bouge un peu les lignes sur l’argent, certes. Mais sur le cœur du problème – pétrole, gaz, charbon – on reste dans le flou artistique le plus total. Alors, triomphe diplomatique ou occasion manquée ? Allons voir ça de plus près, tranquillement, comme si on prenait un café ensemble.
Un accord en demi-teinte qui laisse tout le monde à moitié satisfait
Le texte final ? Disons-le franchement : il ne casse pas trois pattes à un canard sur la sortie des fossiles. On parle d’accélérer les efforts « de manière volontaire », d’« allusions » à la transition énergétique, mais jamais de feuille de route précise. Rien qui ressemble, même de loin, à ce que plus de quatre-vingts pays (Europe, Amérique latine, petits États insulaires) réclamaient à cor et à cri depuis le début.
En clair, on a reculé par rapport à l’élan de 2023 où, pour la première fois, le monde s’était mis d’accord sur le principe d’une « transition hors des combustibles fossiles ». Là, même ce principe semble avoir pris l’eau. Pourquoi ? Parce que certains gros joueurs n’ont tout simplement pas voulu entendre parler d’un calendrier contraignant.
Le seul vrai gagnant concret : l’argent pour l’adaptation
Il y a quand même une avancée qui mérite qu’on s’y arrête. L’accord promet de tripler l’aide financière dédiée à l’adaptation des pays en développement d’ici 2035. On passe donc théoriquement de 40 milliards de dollars par an à environ 120 milliards. C’est loin d’être négligeable.
Pour les nations du Sud global, c’est le nerf de la guerre. Inondations, sécheresses, cyclones plus violents : ils subissent déjà les conséquences alors qu’ils ont très peu contribué au problème. Cet engagement financier, même s’il reste à préciser (qui paie combien ? sous quelle forme ?), représente enfin un signal concret.
« On préfère un accord imparfait qui avance sur l’argent plutôt que pas d’accord du tout »
– Un négociateur européen, un peu résigné, à la sortie de la salle plénière
L’Europe déçue mais résignée
Côté européen, on ne va pas se mentir : c’est la douche froide. Les déclarations officielles restent polies, mais entre les lignes, ça grince sévère.
Le commissaire chargé du climat a été clair : on aurait voulu « beaucoup plus d’ambition sur tout ». La France, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas… tout le monde espérait remettre le sujet des fossiles au centre. Raté. Pire : certains ont senti qu’on leur faisait un procès en sorcellerie – comme si bloquer un texte trop faible aurait automatiquement signifié « on refuse de payer pour les pauvres ».
- Ambition climatique en berne
- Peur d’être accusés d’égoïsme financier
- Choix du « moindre mal » diplomatique
Du coup, l’Europe a fini par lever la main. Pas par enthousiasme, mais parce que faire capoter la conférence aurait été pire pour l’image – et surtout pour les pays vulnérables qui attendaient cet argent.
Le Brésil et la Chine sortent vainqueurs
À l’inverse, le pays hôte peut sabrer le champagne (sans alcool, hein, on reste écolo). Le Brésil voulait absolument éviter toute mention trop précise d’un calendrier fossile, et il a obtenu gain de cause jusqu’au bout. Le président Lula, pourtant fervent défenseur de l’Amazonie, s’est félicité bruyamment depuis le sommet du G20 : « La science a prévalu, le multilatéralisme a gagné ».
Certes. Mais on peut aussi lire entre les lignes : le Brésil, grand producteur de pétrole offshore, n’avait aucune envie de se tirer une balle dans le pied.
La Chine, elle, repart avec un trophée inattendu : l’ouverture d’un « dialogue » sur le commerce mondial et le climat. Traduction : on va enfin parler officiellement des taxes carbone aux frontières que l’Europe met en place et que Pékin déteste cordialement. Pour eux, c’est une petite victoire symbolique énorme.
« Nous avons accompli ce succès dans une situation très difficile »
– Le chef de la délégation chinoise, visiblement soulagé
Pourquoi c’est si dur de parler franchement des fossiles ?
La vraie question, celle qu’on devrait tous se poser en buvant notre café du matin, c’est : pourquoi est-ce si compliqué de simplement écrire noir sur blanc qu’il faut arrêter le pétrole et le gaz rapidement ?
La réponse tient en un chiffre : 80 %. C’est la part des énergies fossiles dans la consommation mondiale d’énergie aujourd’hui. Toujours. Malgré les éoliennes, les panneaux solaires, les batteries électriques. 80 %. Autant dire que toucher à ça, c’est toucher au cœur de l’économie de dizaines de pays – producteurs ou gros consommateurs.
Ajoutez à ça la réalité politique : certains gouvernements sont élus grâce à leurs industries pétrolières ou gazières. D’autres, émergents, estiment avoir le droit de se développer comme l’Occident l’a fait avant eux. Et puis il y a la peur du chaos économique mondial si on coupe trop vite.
Résultat ? On tourne autour du pot depuis des années. On parle de « transition », de « réduction progressive », de « pic des émissions ». Jamais de date butoir claire. Et pendant ce temps, la planète, elle, ne négocie pas. Elle a déjà franchi – peut-être définitivement – la barre des +1,5 °C.
Et maintenant ? Vers la COP31 entre Turquie et Australie
Prochain rendez-vous : novembre 2026. Et là, c’est cocasse, ce sera partagé entre la Turquie (qui accueillera les leaders à Antalya) et l’Australie (qui hébergera les négociations techniques). Une sorte de COP en deux temps, fruit d’une guerre d’enchères inédite entre deux pays qui voulaient absolument le prestige – et les retombées touristiques.
On peut déjà parier que la question des fossiles reviendra sur la table. Ou pas. Parce qu’entre-temps, il y aura des élections un peu partout, des chocs pétroliers éventuels, des catastrophes climatiques supplémentaires. Tout peut basculer.
Ce que j’en pense, personnellement
Après avoir suivi ces négociations depuis des années, j’avoue que je ressors de cette COP30 avec un goût amer. On célèbre un accord « historique » parce qu’il existe, mais on sait tous qu’il ne suffira pas. C’est un peu comme signer un régime pour maigrir de 50 kilos en disant « je commence par manger une salade par semaine ». C’est mieux que rien… mais soyons sérieux deux minutes.
Le plus inquiétant ? Ce sentiment que la diplomatie climatique est devenue une machine à produire des textes mous pour éviter l’échec spectaculaire. On préfère un demi-succès qui permette à tout le monde de sauver la face plutôt qu’un vrai bras de fer qui ferait enfin bouger les lignes.
Pourtant, il suffirait d’un peu de courage politique. D’un ou deux gros pays qui disent : « Ok, on arrête les conneries, voilà un calendrier réaliste mais ambitieux ». Les autres suivraient, par peur ou par intérêt. Mais ce leadership manque cruellement aujourd’hui.
En attendant, la planète continue de chauffer. Les records tombent les uns après les autres. Et nous, on applaudit poliment un texte qui, dans dix ans, nous fera probablement dire : « Si seulement on avait été plus audacieux en 2025… ».
La COP30 n’est pas un échec total. Elle a évité la rupture, elle a mis de l’argent sur la table pour les plus vulnérables. Mais elle reste un rendez-vous manqué sur l’essentiel. Et l’essentiel, c’est de commencer vraiment, concrètement, à se sevrer des énergies qui nous tuent à petit feu.
À méditer. Et surtout, à transformer en actes. Parce que le temps des belles paroles est révolu depuis longtemps.