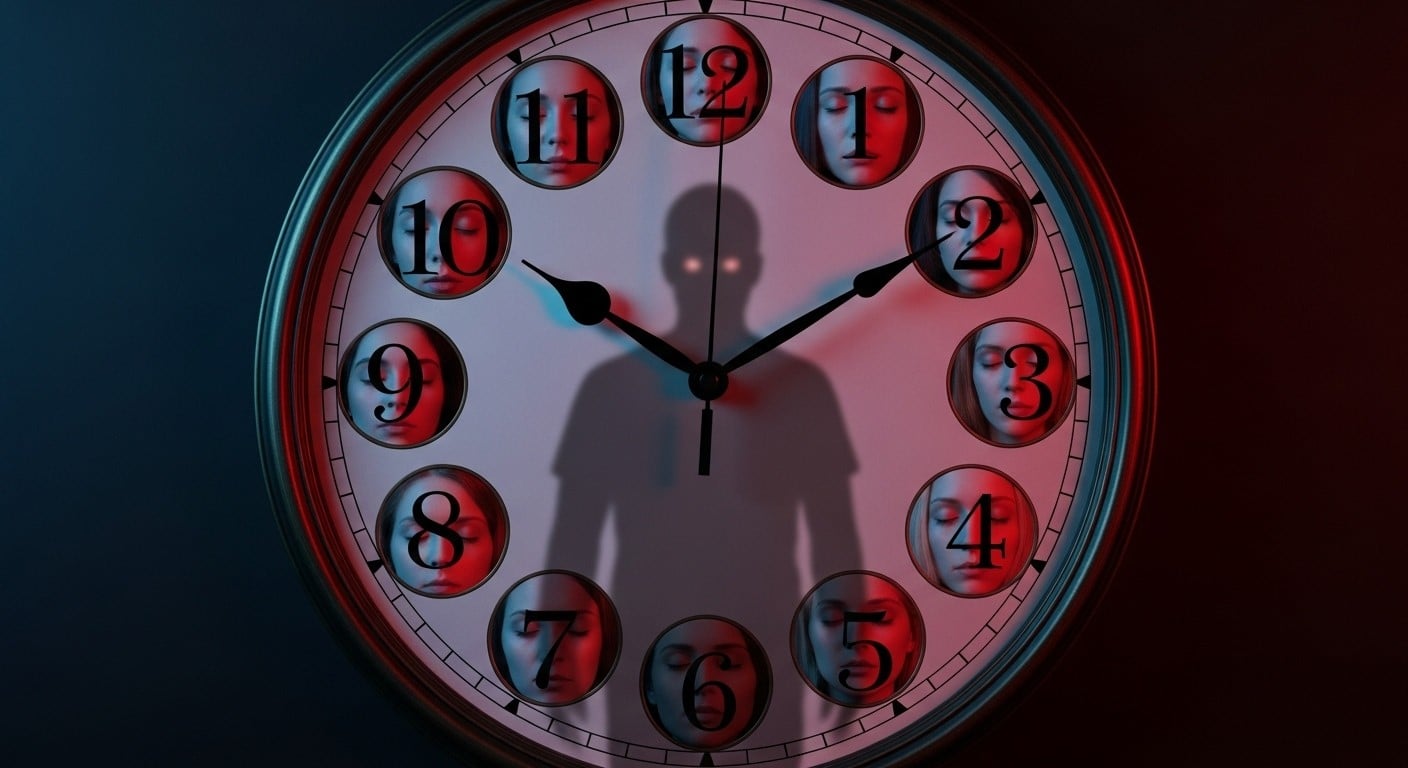Sept heures. C’est le temps qu’il faut pour aller de Paris à Marseille en TGV, un café à la main, en regardant défiler la campagne. Sept heures, c’est aussi, chez nous, le rythme infernal auquel une femme est tuée, tente d’être tuée ou finit par se donner la mort sous la pression insupportable de son conjoint ou ex-conjoint. Cette simple comparaison me glace le sang à chaque fois que je la croise. Parce qu’elle rend tangible l’urgence. Elle transforme une statistique en quelque chose de concret, de presque palpable.
Et pourtant, malgré les discours, les grenelles, les plans successifs, on a parfois l’impression que le sujet avance à reculons. Ou, pire, qu’on tourne en rond. Alors, posons-nous la question sans détour : qu’est-ce qu’on attend vraiment ?
Un fléau qui ne faiblit pas assez vite
Commençons par les chiffres, parce qu’ils parlent plus fort que n’importe quel discours. En moyenne, on recense encore plus d’une centaine de féminicides par an. Derrière ce mot barbare se cache une réalité brutale : une femme morte parce qu’elle était une femme et qu’elle voulait (ou non) quitter son partenaire. Et attention, le chiffre officiel ne compte que les cas aboutis. Il ne prend pas en compte les tentatives, ni les suicides forcés, ni les vies brisées qui continuent malgré tout.
Quand on élargit le champ, c’est encore plus vertigineux. Toutes les deux minutes environ, une femme est victime de viol, de tentative de viol ou d’agression sexuelle. Deux minutes. Le temps de lire ce paragraphe, peut-être.
« Le contrôle coercitif est présent dans presque 100 % des dossiers de féminicide. »
Une magistrate spécialisée, auditionnée récemment
Cette phrase, entendue lors d’une commission, m’a marqué. Parce qu’elle résume tout. Le féminicide n’arrive presque jamais « comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu ». Il est précédé, presque systématiquement, d’un lent étouffement psychologique, d’une emprise totale qui coupe la victime de ses proches, de ses repères, de sa liberté.
Le contrôle coercitif, ce tueur silencieux
On en parle enfin un peu plus, mais c’est encore loin d’être entré dans le langage courant. Le contrôle coercitif, c’est cette toile d’araignée invisible faite d’humiliations répétées, de surveillance permanente, de chantage affectif, d’isolement progressif. C’est le conjoint qui vérifie le téléphone toutes les cinq minutes, qui décide ce que vous avez le droit de porter, qui vous interdit de voir vos amis « parce qu’ils ont une mauvaise influence ».
Et le pire ? Beaucoup de victimes elles-mêmes ne se rendent pas compte qu’elles sont déjà dedans. Parce que ça commence doucement. Un « je t’aime tellement que j’ai peur quand tu sors sans moi », ça peut paraître presque mignon au début. Et puis, un jour, vous vous retrouvez à marcher sur des œufs en permanence, terrorisée à l’idée de déclencher la prochaine crise.
- Surveillance du téléphone et des réseaux sociaux
- Contrôle des finances (argent de poche, interdiction de travailler)
- Critiques permanentes sur le physique, les compétences, la valeur
- Interdiction de voir famille et amis
- Menaces voilées (« si tu me quittes, je me suicide » ou pire, « je te retrouve où que tu ailles »)
Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle donne une idée. Et le plus effrayant, c’est que ce comportement est désormais reconnu comme une forme de violence à part entière dans plusieurs pays. Chez nous, on commence seulement à en parler sérieusement.
Les outils existent… mais sont sous-utilisés
On nous ressort régulièrement le catalogue : téléphone grave danger, bracelet antirapprochement, ordonnance de protection, éviction du conjoint violent du domicile. Tout ça, c’est bien. Vraiment. Le problème, c’est l’écart entre le principe et la réalité du terrain.
Prenez le téléphone grave danger. L’idée est géniale : une ligne directe avec les forces de l’ordre, géolocalisation, intervention prioritaire. Sauf que, selon les derniers chiffres disponibles, moins de 3 000 sont actifs en France. Pour un pays de 67 millions d’habitants. Faites le calcul.
Le bracelet antirapprochement ? Même chose. Quelques centaines déployés. On est très loin du compte quand on sait que des milliers de femmes vivent sous la menace permanente d’un ex qui n’accepte pas la séparation.
Et puis il y a les plaintes classées sans suite, les mains courantes qui s’empilent, les « il a promis de ne plus recommencer » qu’on entend encore trop souvent dans certains commissariats. Je ne jette la pierre à personne en particulier, mais force est de constater que la formation des policiers et gendarmes reste inégale selon les territoires.
La prévention, grande absente du débat
On réagit beaucoup. On accompagne (parfois) les victimes. Mais on prévient encore trop peu. Et pourtant, c’est là que tout se joue.
Éducation à l’égalité dès l’école primaire, déconstruction des stéréotypes garçons/filles, apprentissage du respect du consentement et des limites de l’autre… Tout ça existe déjà dans les textes. Mais dans les faits ? Combien de collèges proposent vraiment des interventions sérieuses sur ces sujets ? Combien de jeunes sortent du système scolaire en sachant reconnaître une relation toxique ?
J’ai discuté récemment avec une éducatrice spécialisée. Elle me disait : « Les gamins de 13-14 ans que je vois reproduisent déjà des schémas qu’ils ont vus chez eux ou sur les réseaux. Le jaloux qui demande le mot de passe Snapchat de sa copine, pour eux, c’est normal. C’est même une preuve d’amour. » Ça fait peur.
Et les hommes dans tout ça ?
On parle beaucoup des victimes – et c’est normal – mais on parle trop peu des auteurs. Parce que, oui, il y a des profils récidivistes, des pathologies lourdes, mais il y a aussi des hommes « ordinaires » qui basculent. Et là, la question de la prise en charge se pose cruellement.
Les centres de prise en charge des auteurs de violences existent, mais ils sont rares, souvent saturés, et surtout méconnus du grand public. Résultat : beaucoup d’hommes violents ne sont jamais orientés vers ces structures. Et quand ils le sont, c’est parfois trop tard.
Il faut oser le dire : tant qu’on ne travaillera pas sérieusement sur la prévention chez les auteurs potentiels, on continuera à courir derrière le problème au lieu de l’anticiper.
Ce qui pourrait changer la donne dès demain
Si on voulait vraiment faire bouger les lignes, voilà quelques pistes concrètes (et réalistes) :
- Former tous les policiers et gendarmes (pas seulement les référents) à l’accueil des victimes et à la détection du contrôle coercitif
- Généraliser les unités d’évaluation spécialisées dans chaque tribunal
- Rendre le bracelet antirapprochement systématique dès qu’il y a un risque avéré
- Multiplier par dix le nombre de téléphones grave danger
- Créer un vrai parcours de sortie de la violence pour les auteurs (obligatoire en cas de condamnation)
- Investir massivement dans l’éducation à l’égalité et au respect dès l’école
Ce n’est pas une question d’argent uniquement. C’est surtout une question de volonté politique. Et de courage.
Parce qu’en attendant, il y a des prénoms qui s’ajoutent chaque semaine à la liste déjà trop longue des victimes. Des femmes qui avaient prévenu, parfois. Qui avaient porté plainte. Qui croyaient être protégées.
Alors oui, la question est brutale, mais elle mérite d’être posée : qu’est-ce qu’on attend vraiment pour que ça s’arrête ?
Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Mais une chose est sûre : continuer comme avant n’est plus une option. Le train de la prévention doit enfin accélérer. Parce que sept heures, c’est déjà beaucoup trop long.