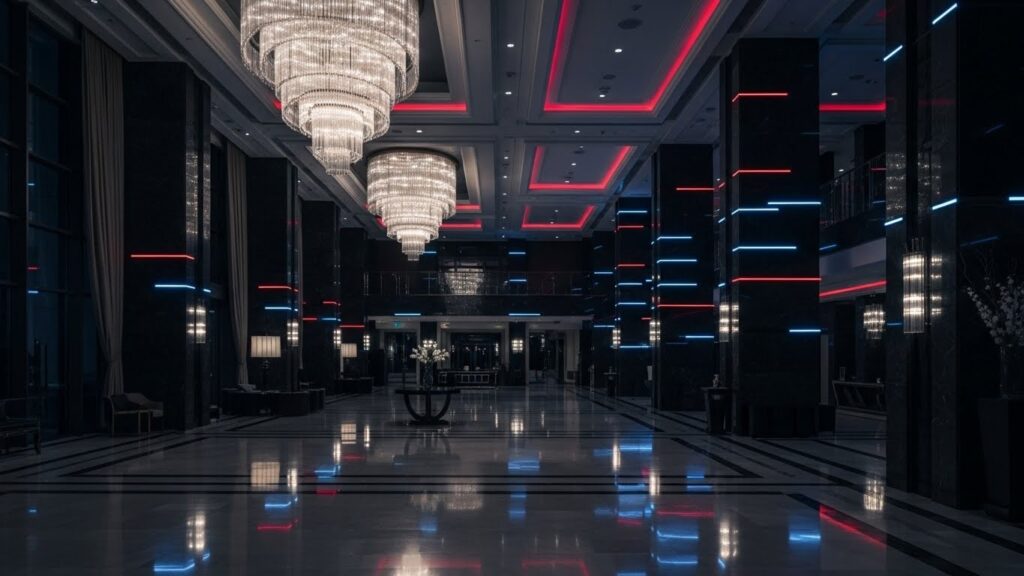Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si, du jour au lendemain, votre médecin ne pouvait plus vous arrêter plus d’un mois ? Imaginez : une pathologie chronique, un burn-out profond ou une opération lourde… et hop, au bout de trente jours, retour obligatoire au boulot, même si vous tenez à peine debout. C’est exactement le scénario que le gouvernement voulait imposer pour freiner l’explosion des dépenses d’arrêts maladie. Eh bien hier, le Sénat a dit non. Un non franc, massif, presque unanime à droite comme à gauche. Et franchement, ça mérite qu’on s’y arrête deux minutes.
Un bras de fer qui en dit long sur l’état de la France
Onze milliards d’euros. C’est le chiffre qui revient en boucle dans les couloirs du Palais du Luxembourg comme dans les ministères. Onze milliards dépensés en 2024 pour les indemnités journalières, avec une hausse moyenne de 6 % par an depuis cinq ans. Autant dire que la Sécurité sociale tousse sévère. Face à ça, l’exécutif avait dégainé une idée simple : limiter par décret la durée initiale des arrêts de travail. Quinze jours en ville, trente à l’hôpital au départ, puis les députés avaient durci le ton en voulant graver dans le marbre un plafond unique de trente jours renouvelable uniquement en présentiel.
Mais patatras. Les sénateurs, toutes tendances confondues, ont balayé la mesure d’un revers de main. Pourquoi ? Parce qu’ils estiment que dans un pays où trouver un rendez-vous chez le médecin relève parfois du parcours du combattant, rajouter des consultations obligatoires juste pour prolonger un arrêt, c’est prendre le problème à l’envers.
L’argument qui a fait mouche : l’accès aux soins déjà en péril
La rapporteur de la commission des affaires sociales, Corinne Imbert, n’y est pas allée par quatre chemins. Selon elle, plafonner les arrêts « mobiliserait plusieurs centaines de milliers d’heures de consultation dans un contexte d’accès aux soins déjà fragilisé ». Traduction : on manque cruellement de médecins, les déserts médicaux s’étendent, et on voudrait leur rajouter des milliers de rendez-vous juste pour cocher une case administrative ? Merci bien.
blockquote class= »wp-block-quote »>« On défend avant tout la liberté de prescription des médecins. »
Corinne Imbert, sénatrice et rapporteur du texte /blockquote>Cette phrase a résumé l’état d’esprit de la majorité sénatoriale. Et on peut la comprendre. Quand vous habitez dans certains coins de Creuse ou des Ardennes, revoir votre médecin au bout d’un mois, c’est parfois mission impossible avant… trois ou quatre mois. Résultat : soit le patient revient trop tôt au travail et risque la rechute, soit il reste chez lui sans indemnités. Perte-perte.
La téléconsultation dans le collimateur
Les sénateurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi voté un amendement visant à interdire purement et simplement le renouvellement des arrêts de travail par téléconsultation. Actuellement, la loi autorise déjà les arrêts initiaux en télémedecine mais les limite à trois jours. Prolonger au-delà ? Niet, selon la Chambre haute.
Le gouvernement a crié à l’inconstitutionnalité et au retour en arrière. Il faut dire que la téléconsultation a explosé depuis la pandémie et qu’elle permet à des milliers de personnes, notamment dans les zones sous-dotées, de consulter sans faire 80 km. Mais les sénateurs répliquent que certains abus existent : des plateformes peu regardantes, des arrêts délivrés en quelques clics… Le débat est loin d’être tranché.
- Arrêt initial par téléconsultation : autorisé mais limité à 3 jours maximum
- Renouvellement : obligatoirement en présentiel selon le souhait du Sénat
- Exception : le médecin téléconsultant doit être le médecin traitant du patient (règle actuelle qui reste en vigueur)
Un coût exorbitant qui inquiète tout le monde
Revenons aux onze milliards. C’est énorme. Pour vous donner une idée, c’est presque l’équivalent du budget de la Justice ou de la Culture. Et la courbe ne redescend pas. Burn-out, troubles musculo-squelettiques, longues maladies, effets différés du Covid… les raisons sont multiples. Mais il y a aussi, soyons honnêtes, une part de fraude ou du moins d’arrêts parfois discutables.
Le gouvernement voulait donc taper du poing sur la table. La ministre chargée de la Santé a d’ailleurs eu cette phrase qui résume bien la philosophie initiale :
« Au bout d’un mois, on peut quand même revoir son patient. Ça ne paraît pas choquant. »
Sauf que dans la vraie vie, entre les agendas surbookés et les patients qui annulent à la dernière minute, revoir quelqu’un à J+30 relève parfois de la gageure. Et puis, il y a cette réalité qu’on oublie trop souvent : beaucoup de Français attendent déjà le dernier moment pour s’arrêter, par peur de perdre leur emploi ou simplement par sens du devoir. Rajouter des contraintes risque surtout d’aggraver le présentéisme.
Présentéisme ou non-recours : le vrai danger
Plusieurs sénateurs, notamment écologistes, ont alerté sur ce point. Limiter la durée des arrêts ne va pas magique faire baisser les dépenses. Ça va juste pousser certains à venir travailler malade, au risque de contaminer leurs collègues ou de faire une rechute plus grave ensuite. D’autres, faute de pouvoir revenir consulter, renonceront purement et simplement à leur indemnisation.
On connait déjà ce phénomène avec les soins dentaires ou l’optique : une partie des Français y renonce parce que c’est trop compliqué ou trop cher. Veut-on vraiment rajouter les arrêts maladie à la liste des droits théoriques dont on ne bénéficie jamais en pratique ? Poser la question, c’est un peu y répondre.
Et maintenant ? Rien n’est joué
Attention, tout ça n’est pas définitif. Le texte va repartir à l’Assemblée nationale, puis probablement en commission mixte paritaire. Et vu les positions diamétralement opposées, on risque l’échec de la CMP et donc le retour au texte initial voté par les députés – celui avec le plafond de trente jours inscrit dans la loi.
En clair, le match est loin d’être terminé. Le gouvernement peut encore utiliser le 49.3 sur le PLFSS si vraiment il veut passer en force. Mais politiquement, ça ferait désordre : s’attaquer aux arrêts maladie en pleine période de tensions sociales, alors que le pouvoir d’achat reste la première préoccupation des Français, c’est prendre le risque d’un nouveau foyer de mécontentement.
Ce que ça dit de notre modèle social
Au-delà du débat technique, il y a une question de fond. Veut-on un système où la suspicion devient la règle ? Où chaque arrêt maladie est vu comme une potentielle fraude ? Ou veut-on conserver un modèle basé sur la confiance entre médecin et patient, même si ça coûte parfois un peu plus cher ?
Personnellement, je penche pour la seconde option. Parce que l’expérience montre que quand on resserre la vis trop fort, on obtient l’effet inverse : les gens contournent, trichent, ou pire, abandonnent. Regardez les contrôles renforcés ces dernières années : les fraudes détectées restent marginales (moins de 1 % des arrêts selon les chiffres officiels). Alors oui, il y a des abus. Mais veut-on vraiment faire payer à 99 % de malades honnêtes les dérives de 1 % ?
Et puis il y a cette réalité qu’on oublie trop souvent : derrière chaque arrêt maladie, il y a une vraie souffrance. Physique ou psychique. Un salarié qui craque après des mois de surcharge, un ouvrier usé par des gestes répétitifs, un cadre qui n’a pas pris de vacances depuis deux ans… Vouloir tout réglementer à la décimale près, c’est oublier l’humain.
Le Sénat, en disant non hier, a peut-être sauvé un peu de cette humanité-là. Même si le combat n’est pas terminé.
Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous plutôt pour un contrôle plus strict des arrêts maladie ou estimez-vous que la liberté de prescription doit primer ? Les commentaires sont ouverts, et croyez-moi, sur ce sujet, tout le monde a un avis…