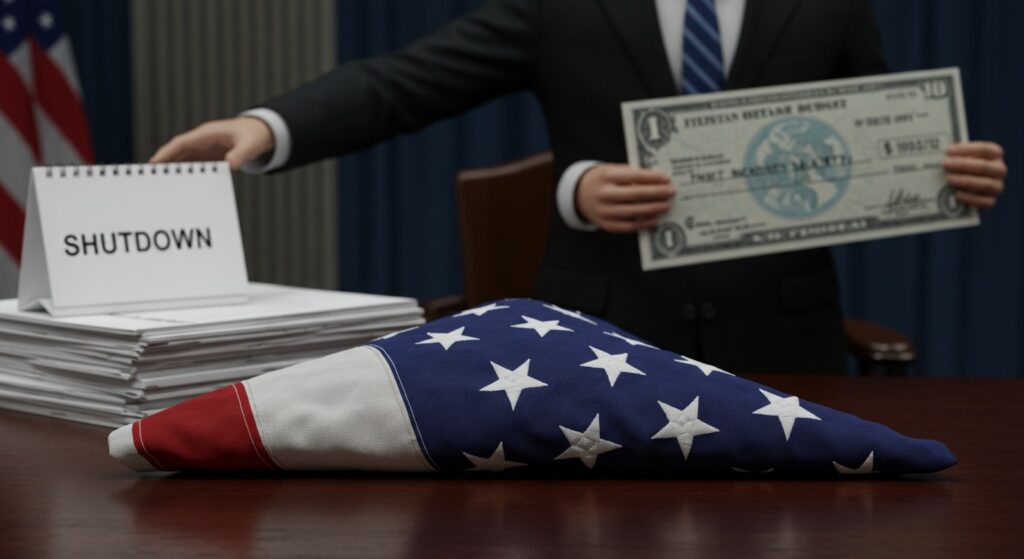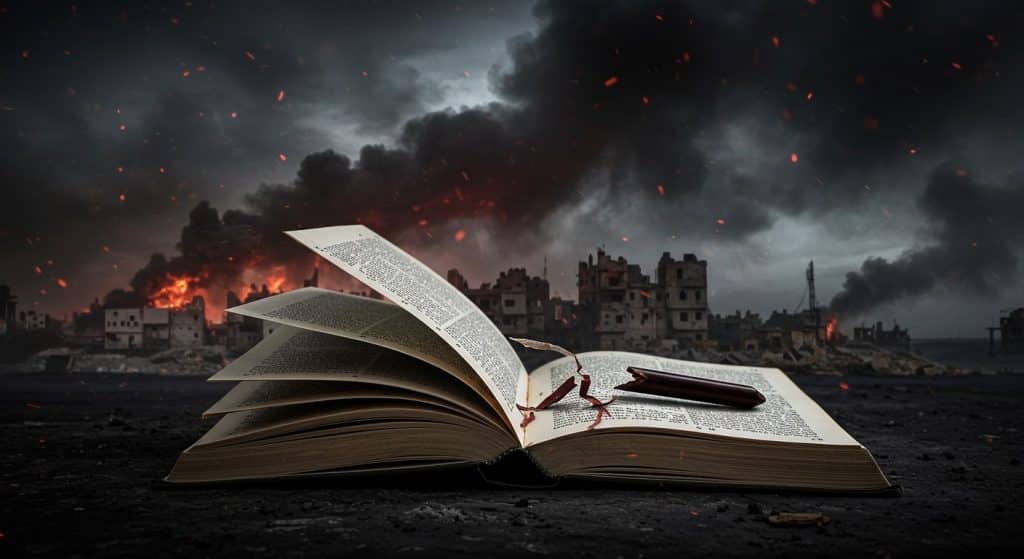Vous avez déjà vu ces vidéos ? Un jeune, souvent entre deux gorgées de café, explique tranquillement pourquoi il a choisi d’être agent de sécurité de nuit dans un entrepôt désert ou employé administratif dans un service où « personne ne vient jamais ». Le ton est léger, presque comique. Et pourtant, quand on gratte un peu, on sent autre chose. Une lassitude. Une méfiance. Voire une forme de résignation.
Je suis tombé là-dessus un soir en scrollant, et franchement, ça m’a scotché. Parce que derrière l’humour, il y a une question qui brûle : pourquoi une génération entière semble-t-elle chercher avant tout à ne pas trop travailler une fois le diplôme en poche ?
La « planque » : le nouveau Graal de la Gen Z
On l’appelle la « planque », le « job pépère », le « poste où on te fout la paix ». L’idée est simple : trouver un emploi payé correctement, avec le moins de stress possible, le moins de contact humain inutile, et surtout le moins de pression. Idéalement en télétravail, ou dans un bureau où le manager passe une fois par semaine.
Et non, ce n’est pas une poignée de feignasses. C’est une tendance massive. Des milliers de vidéos, des groupes privés, des tableaux Excel qui circulent avec les « meilleurs jobs planque » classés par salaire, niveau de surveillance et risque de burnout. On y trouve :
- Agent de sécurité dans des parkings souterrains ou des résidences vides la nuit
- Gardien d’immeuble avec logement de fonction
- Employé dans des services comptables d’entreprises publiques peu regardantes
- Technicien dans des data centers où il n’y a presque jamais d’urgence
- Standardiste dans des administrations où le téléphone sonne deux fois par jour
Le plus fou ? Ces jobs existent vraiment. Et ils sont pris d’assaut.
Ce n’est pas de la paresse, c’est de la survie
Quand on écoute ces jeunes, un mot revient sans cesse : épuisement. Ils ont vu leurs parents, leurs grands frères ou sœurs, rentrer cassés d’open-spaces toxiques, pleurer le dimanche soir, faire des burn-out à 35 ans. Ils ont grandi avec les témoignages de cadres qui gagnent bien leur vie… mais qui n’ont plus de vie.
Ils ont aussi vu autre chose : des CDI qui ne protègent plus de rien, des salaires d’entrée qui ne permettent plus de se loger décemment dans les grandes villes, des stages à répétition, des missions intérim interminables. Et surtout, une culture du « toujours plus » où on te demande d’être passionné par ton boulot… tout en te payant au lance-pierre.
« Moi je veux juste un salaire correct pour vivre, pas donner mon âme à une entreprise qui me virera à la première restructuration. »
– Un jeune de 24 ans, dans une vidéo vue plus d’un million de fois
Cette phrase, je l’ai vue des dizaines de fois, sous des formes différentes. Elle résume tout.
Un marché du travail qui a trahi ses promesses
Il faut être honnête : le contrat social a changé. Autrefois, on acceptait de bosser dur en début de carrière parce qu’on savait qu’ensuite, ça irait mieux. Sécurité de l’emploi, progression, retraite correcte. Aujourd’hui ? Rien n’est plus garanti.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En France, un jeune sur cinq est au chômage six mois après son diplôme. Les CDD et l’intérim représentent plus de 80 % des embauches des moins de 30 ans. Et quand un CDI arrive enfin, il est souvent mal payé, avec des responsabilités énormes dès le premier jour.
Ajoutez à ça la pression sociale : on te vend le rêve de l’entrepreneuriat, du side hustle, du « fais ce que tu aimes ». Résultat ? Ceux qui choisissent la stabilité passent pour des losers. Alors certains décident de jouer le système à leur tour.
Le paradoxe : plus on est qualifié, plus on veut se cacher
Le plus surprenant, c’est que cette quête de la planque touche particulièrement les profils très diplômés. Des ingénieurs, des masters en communication, des écoles de commerce qui rêvent… de postes administratifs dans la fonction publique territoriale.
Pourquoi ? Parce qu’ils ont vu de près ce qui les attend dans le privé : des rythmes infernaux, des objectifs inatteignables, des open-spaces bruyants, des réunions à n’en plus finir, et surtout une culture du présentéisme où rester tard est plus valorisé que d’être efficace.
Un jeune ingénieur me confiait récemment : « J’ai fait cinq ans d’études pour me retrouver à faire des PowerPoint jusqu’à 22 h ? Non merci. Je préfère un poste où je travaille vraiment 20 heures par semaine et que je touche 2200 euros net. Au moins j’ai une vie. »
Et les entreprises dans tout ça ?
Beaucoup de boîtes commencent à paniquer. Elles ne comprennent pas pourquoi les jeunes refusent leurs « super opportunités » avec baby-foot et fruits gratuits. Elles parlent de « génération flemmarde ».
Mais la vérité, c’est que les entreprises ont elles-mêmes créé ce désamour. Années de stages non rémunérés, de petits boulots ubérisés, de salaires bloqués, de management par la peur… Et maintenant elles s’étonnent que les jeunes ne veuillent plus jouer le jeu ?
« On nous a vendu la passion au travail. On a essayé. Et on a vu que ça ne payait pas les factures. »
Vers un nouveau modèle de travail ?
Ce qui est fascinant, c’est que cette quête de la planque pourrait bien être le début de quelque chose de plus grand. Une forme de révolte douce. Un refus collectif de sacrifier sa santé mentale sur l’autel de la productivité.
Certains y voient déjà les prémices d’une société où le travail redeviendrait… juste un travail. Pas une identité. Pas une famille. Pas une raison de vivre. Juste un moyen de payer ses factures et de profiter du reste.
Et si c’était ça, finalement, la vraie modernité ? Refuser de se tuer au travail quand on sait que l’entreprise vous oubliera en deux secondes. Choisir la sérénité plutôt que l’épuisement.
Après tout, nos parents nous ont appris à travailler dur. Peut-être que notre génération est en train d’apprendre autre chose : travailler malin.
Ou peut-être que non. Peut-être que c’est juste une parenthèse. Que dans quelques années, quand les loyers auront encore augmenté et que les salaires n’auront toujours pas suivi, même la meilleure planque ne suffira plus.
Mais en attendant, une chose est sûre : la Gen Z ne veut plus se faire avoir. Et ça, c’est déjà une petite révolution.
Et vous, vous en pensez quoi ? La recherche de la « planque » est-elle un symptôme de précarité… ou le début d’une prise de conscience salutaire ?