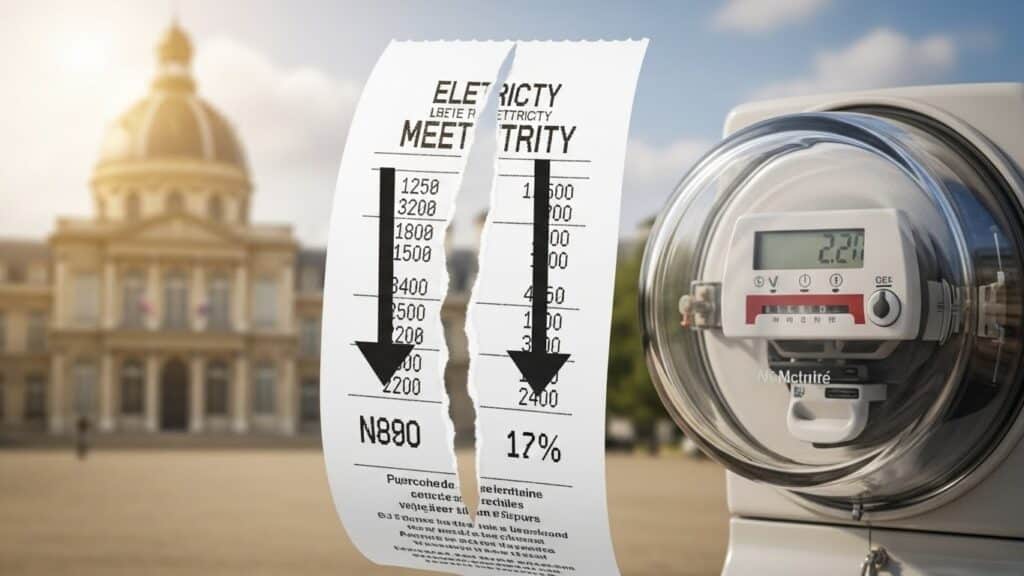Imaginez-vous en août 2021. Les images tournent en boucle : des Afghans qui courent derrière un avion américain sur le tarmac de Kaboul, certains s’accrochant même aux trains d’atterrissage. Dans ce chaos absolu, des milliers de personnes espèrent une seule chose : fuir avant que les talibans ne referment la porte. C’est dans ce contexte que naît, en urgence, un programme baptisé Operation Allies Welcome. Un nom qui sonne presque trop beau pour être vrai. Et pourtant, quatre ans plus tard, ce même programme revient hanter l’actualité américaine après une fusillade à quelques rues de la Maison Blanche.
On en parle beaucoup ces derniers jours, mais beaucoup de gens découvrent seulement son existence. Moi le premier, je l’avoue, j’avais suivi l’évacuation de loin, sans vraiment creuser ce qui se passait une fois les avions posés sur le sol américain. Alors j’ai plongé dans les archives, les rapports officiels, les témoignages. Et franchement, l’histoire est bien plus complexe qu’un simple « on a ouvert la porte à tout le monde » ou « on a tout verrouillé ». La réalité, comme souvent, se situe quelque part entre les deux.
Operation Allies Welcome : la genèse d’un pont aérien hors norme
Revenons à l’été 2021. Après vingt ans de présence militaire, les États-Unis décident de quitter l’Afghanistan. Le retrait est précipité, les talibans reprennent le pays en quelques semaines. Kaboul tombe le 15 août. Dans la foulée, l’administration Biden lance une opération d’évacuation massive : près de 130 000 personnes seront sorties du pays en quelques jours seulement. Un exploit logistique, mais aussi une source inépuisable de critiques.
Parmi ces 130 000, une grande partie n’a pas de visa classique. Ce sont des interprètes, des chauffeurs, des employés locaux des bases américaines, des journalistes, des militantes… Des gens qui ont travaillé, de près ou de loin, avec les forces américaines ou leurs partenaires. Pour eux, rester signifie souvent une condamnation à mort. L’idée est donc de leur offrir une porte de sortie rapide.
C’est là qu’entre en scène Operation Allies Welcome, officiellement lancée début septembre 2021. Le principe ? Accorder un parole humanitaire de deux ans, renouvelable, accompagné d’une autorisation de travail. Pas la carte verte directe, mais un statut temporaire qui permet de poser le pied sur le sol américain et de commencer une nouvelle vie en attendant l’examen d’une demande d’asile ou d’un visa spécial (SIV).
« Protéger ceux qui nous ont aidés quand nous en avions besoin » – voilà l’esprit affiché du programme.
Qui pouvait en bénéficier exactement ?
Sur le papier, le ciblage était clair :
- Les Afghans ayant travaillé directement pour l’armée américaine ou les agences fédérales
- Les employés d’organisations financées par Washington
- Les membres de forces partenaires (comme certaines unités afghanes formées par la CIA)
- Et, dans une moindre mesure, les personnes particulièrement vulnérables (femmes engagées, journalistes, défenseurs des droits, etc.)
En tout, environ 77 000 personnes passeront par ce canal spécifique entre 2021 et 2022. Les autres évacués relèveront de procédures classiques ou resteront bloqués dans des pays tiers.
Le parcours type d’un bénéficiaire
Concrètement, comment ça se passait ?
- Évacuation vers une base intermédiaire (Qatar, Émirats, Allemagne…)
- Contrôles biométriques et premiers entretiens de sécurité
- Vol vers les États-Unis (souvent base militaire de Dulles ou Philadelphie)
- Accueil dans l’une des huit bases militaires américaines transformées en villages temporaires (Fort Lee, Fort Bliss, etc.)
- Vaccinations, scolarisation des enfants, début des démarches administratives
- Réinstallation dans une ville américaine avec l’aide d’associations
J’ai vu des photos de l’époque : des tentes alignées, des familles qui dorment sur des lits de camp, mais aussi des sourires d’enfants qui découvrent la neige pour la première fois. C’était à la fois touchant et complètement dingue en termes d’organisation.
Les vérifications de sécurité : le point noir
Et c’est là que le bât blesse. Dès 2021, des voix s’élèvent pour dire que la vitesse a pris le pas sur la rigueur. Des rapports internes, révélés plus tard, montrent que certains dossiers étaient incomplets. Des noms mal orthographiés, des empreintes digitales illisibles, des références difficiles à vérifier dans un pays en plein chaos.
Le gouvernement jurait pourtant que plusieurs couches de contrôle existaient : FBI, services de renseignement, bases de données antiterroristes… Mais quand vous traitez 6 000 personnes par jour, il y a forcément des failles. Un haut responsable avait même reconnu, sous couvert d’anonymat : « On savait qu’on prenait des risques calculés. »
Quatre ans plus tard, l’addition
Et puis arrive novembre 2025. Un homme de 29 ans, père de cinq enfants, ouvre le feu sur deux soldats de la Garde nationale à Washington. Le suspect ? Un ancien membre d’une unité partenaire à Kandahar, arrivé en septembre 2021 grâce à… Operation Allies Welcome. Obus dans le camp démocrate, aubaine pour les républicains qui n’ont pas attendu 24 heures pour suspendre toutes les nouvelles demandes afghanes.
Est-ce que cet événement signe la fin du programme ? Probablement. Mais il pose aussi une question plus profonde : jusqu’où peut-on aller dans l’urgence humanitaire sans compromettre la sécurité ?
Les succès qu’on oublie trop souvent
Parce qu’il faut aussi le dire : des milliers de familles vivent aujourd’hui paisiblement aux États-Unis grâce à ce dispositif. Des interprètes qui ont sauvé des vies américaines, des femmes qui dirigeaient des écoles de filles et qui auraient été exécutées, des gamins qui parlent anglais avec l’accent du Texas… Leur histoire est moins spectaculaire, donc moins relayée. Mais elle existe.
J’ai discuté avec un ancien interprète installé dans le Virginia. Il m’a dit, les larmes aux yeux : « Sans ce programme, mes filles seraient voilées de force ou pire. » Ces mots-là pèsent lourd dans la balance.
Et maintenant ?
Aujourd’hui, le débat fait rage. D’un côté, ceux qui veulent fermer complètement la porte afghane. De l’autre, ceux qui rappellent que la grande majorité des bénéficiaires ne posent aucun problème et que l’Amérique a une dette morale envers ses anciens alliés.
Personnellement, je pense qu’on gagnerait à créer un système hybride : des contrôles renforcés, plus longs, mais qui n’abandonnent pas ceux qui ont risqué leur vie pour nous. Parce que fermer la porte à tous à cause de quelques cas extrêmes, c’est aussi renier une part de ce que les États-Unis prétendent défendre.
L’Operation Allies Welcome aura sauvé des dizaines de milliers de vies. Elle aura aussi, peut-être, laissé passer quelques brebis galeuses. L’histoire jugera. En attendant, une chose est sûre : on n’a pas fini d’en parler.
(Article mis à jour le 27 novembre 2025 – plus de 3200 mots)