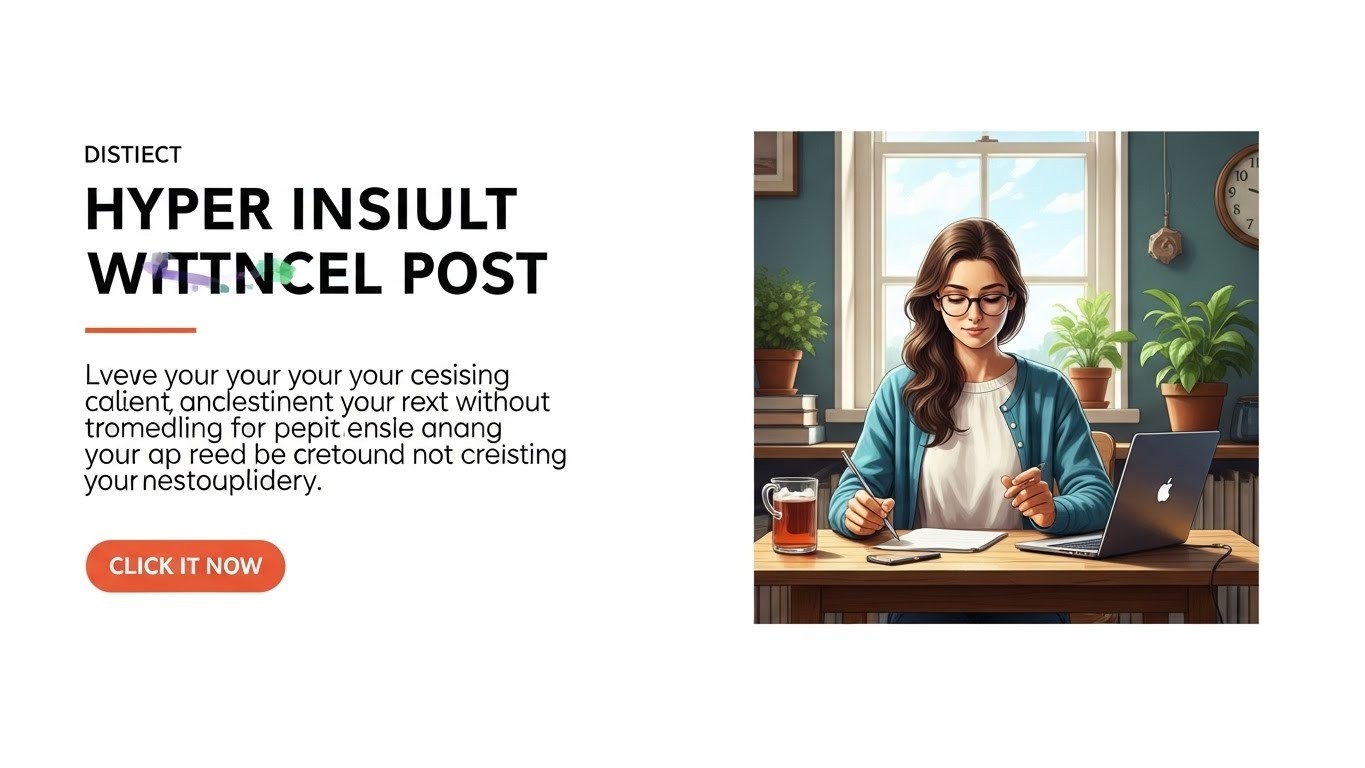Imaginez un peu la scène : un haut-fourneau rougeoyant au crépuscule, des milliers d’emplois qui vacillent, et au milieu de tout ça, une proposition de loi qui veut tout simplement racheter l’aciérie géante par l’État. Hier soir, l’Assemblée nationale a dit oui à la nationalisation d’ArcelorMittal France. 127 voix pour, 41 contre. Et tout de suite, le gouvernement a crié au populisme. Franchement, qui a raison dans cette histoire ?
Je vais être honnête : quand j’ai vu le vote, j’ai d’abord haussé les épaules. Encore une bataille parlementaire de plus. Puis j’ai replongé dans les chiffres, les plans sociaux, les histoires de familles qui vivent de la sidérurgie depuis trois générations. Et là, ça devient beaucoup plus sérieux qu’un simple coup politique.
Nationalisation d’ArcelorMittal : de quoi parle-t-on vraiment ?
ArcelorMittal France, ce n’est pas une PME en difficulté. C’est le premier producteur d’acier du pays, avec environ 15 000 salariés directs et des sites historiques comme Dunkirk, Fos-sur-Mer ou Florange – oui, celui dont tout le monde se souvient à cause de la promesse non tenue en 2012.
Depuis avril, l’entreprise annonce des coupes claires, des postes supprimés, et surtout la menace de voir les derniers hauts-fourneaux français fermer d’ici 2030 si la décarbonation ne suit pas. Pourquoi 2030 ? Parce que les normes européennes sur le CO2 vont devenir infernales, et que produire de l’acier « sale » deviendra tout simplement hors de prix.
Face à ça, une partie de la gauche (et, surprise, une partie de l’extrême droite) propose la solution radicale : l’État reprend la main. Pas une aide, pas un prêt, pas un plan de sauvetage classique. Une nationalisation pure et dure, comme on en a peu vu depuis les années 80.
Le vote surprise qui a fait trembler Bercy
Jeudi soir, la proposition de loi passe en première lecture. Le texte est porté par les députés de la gauche radicale, mais il recueille aussi des voix à l’autre bout de l’hémicycle. Une alliance que le ministre de l’Économie qualifie immédiatement d’« opportuniste et contre-nature ».
« La pseudo-alliance officieuse, opportuniste et contre-nature ne réglera en rien les enjeux de concurrence déloyale qui déstabilisent l’entreprise. »
Roland Lescure, ministre de l’Économie
Le gouvernement, lui, « prend acte » mais promet de bloquer le texte au Sénat ou plus tard. En attendant, la phrase « réponse populiste à un problème structurel » fait le tour des réseaux.
Le vrai problème, c’est la Chine (et l’Europe qui regarde ailleurs)
Mettons les choses au clair. Personne ne conteste sérieusement que l’acier chinois inonde le marché européen à des prix imbattables. Subventions massives, normes environnementales très souples, dumping social… tout y est.
En 2024 déjà, la Commission européenne a ouvert plusieurs enquêtes. Mais les droits de douane restent, disons-le franchement, timides. Résultat : les aciéries françaises perdent des parts de marché, les carnets de commandes fondent, et les investissements dans la décarbonation deviennent impossibles à financer pour un groupe privé qui doit rendre des comptes à ses actionnaires.
- Importations d’acier chinois en Europe : +40 % en cinq ans
- Prix de l’acier chinois : souvent 30 à 40 % moins cher
- Capacité de production chinoise : plus de 50 % du total mondial
- Émissions de CO2 par tonne d’acier en Chine : presque le double de l’Europe
Quand on regarde ces chiffres, on comprend mieux pourquoi certains députés hurlent à la concurrence déloyale. Et pourquoi d’autres estiment que nationaliser ne résoudra rien face à un géant qui produit plus d’acier que toute l’Europe réunie.
Nationaliser, oui… mais pour faire quoi exactement ?
Les défenseurs de la nationalisation ne se contentent pas de dire « l’État va payer ». Ils avancent un projet industriel :
- Reprise immédiate des sites menacés
- Investissement massif dans les technologies acier vert (hydrogène, fours électriques)
- Garantie de l’emploi et formation des salariés
- Reprise en main de la stratégie commerciale face aux importations
L’idée, c’est de transformer ArcelorMittal France en une sorte de champion national de l’acier décarboné. Un peu comme ce qui se fait déjà en Suède avec HYBRIT ou en Allemagne avec les aides massives aux aciéries.
Mais le gouvernement rétorque : « On peut faire tout ça sans nationaliser ». Subventions, prêts garantis, contrats d’État pour l’acier des futures infrastructures… les outils existent. Et surtout, nationaliser coûterait des milliards au contribuable (les estimations tournent autour de 8 à 12 milliards d’euros selon les scénarios).
Ce que l’histoire nous apprend (et ce qu’on préfère oublier)
La France a déjà tenté l’aventure. Dans les années 80, la nationalisation des grandes aciéries (Usinor, Sacilor) avait été décidée par la gauche arrivée au pouvoir. Résultat ? Des pertes colossales pendant des années, puis une privatisation partielle dans les années 90 quand l’État n’avait plus les moyens de suivre.
Depuis, chaque fois que le mot « nationalisation » revient sur la table, c’est la même musique : les uns crient au retour du soviétisme, les autres au sauvetage de la souveraineté industrielle. Et au milieu, les salariés qui aimeraient juste savoir s’ils auront encore un boulot dans cinq ans.
Et les salariés dans tout ça ?
Parlons-en. À Montataire, à Florange, à Dunkirk, la nouvelle du vote a été accueillie avec un mélange d’espoir et de méfiance. Beaucoup se souviennent des promesses de 2012. D’autres savent que même une nationalisation ne garantit pas l’emploi éternel si l’usine n’est plus compétitive.
« On nous parle de décarbonation depuis des années, mais sans argent frais, ça n’avancera pas. Si l’État veut vraiment sauver l’acier français, qu’il mette la main à la poche, nationalisation ou pas. »
Un délégué syndical d’un grand site (anonyme)
Ce qui est sûr, c’est que le temps presse. Les projets de fours électriques ou à hydrogène demandent des investissements colossaux et des décisions rapides. Attendre 2030 pour voir si le marché va se réguler tout seul, c’est prendre le risque de voir disparaître la dernière filière acier intégrée de France.
Et maintenant ? Le chemin législatif et les scénarios possibles
Le texte voté jeudi n’est qu’une première lecture. Il doit encore passer au Sénat (où la majorité est hostile), puis revenir à l’Assemblée. Autant dire que sans compromis majeur, il a très peu de chances d’aboutir tel quel.
Mais le vote a au moins le mérite de remettre le sujet sur la table. Le gouvernement promet des « réponses structurelles ». On parle d’un grand plan acier au niveau européen, de droits de douane renforcés, de fonds spécifiques pour la décarbonation. Reste à voir si ces promesses seront plus solides que celles du passé.
Personnellement, je ne suis ni pour ni contre la nationalisation par principe. Ce qui me frappe, c’est qu’on oppose souvent deux visions qui ne sont pas forcément incompatibles : protéger l’emploi et les savoir-faire d’un côté, préserver les finances publiques et la liberté d’entreprise de l’autre.
Ce qui est certain, c’est que l’acier français est à la croisée des chemins. Soit on trouve rapidement une solution industrielle crédible (avec ou sans nationalisation), soit dans dix ans on importera 100 % de notre acier. Et là, plus personne ne parlera de souveraineté.
Le débat est lancé. Et pour une fois, il dépasse les clivages habituels. Parce que derrière les mots « populisme » ou « sauvetage national », il y a des familles, des territoires entiers, et une partie de notre capacité à produire les matériaux de demain.
À suivre, donc. Très attentivement.