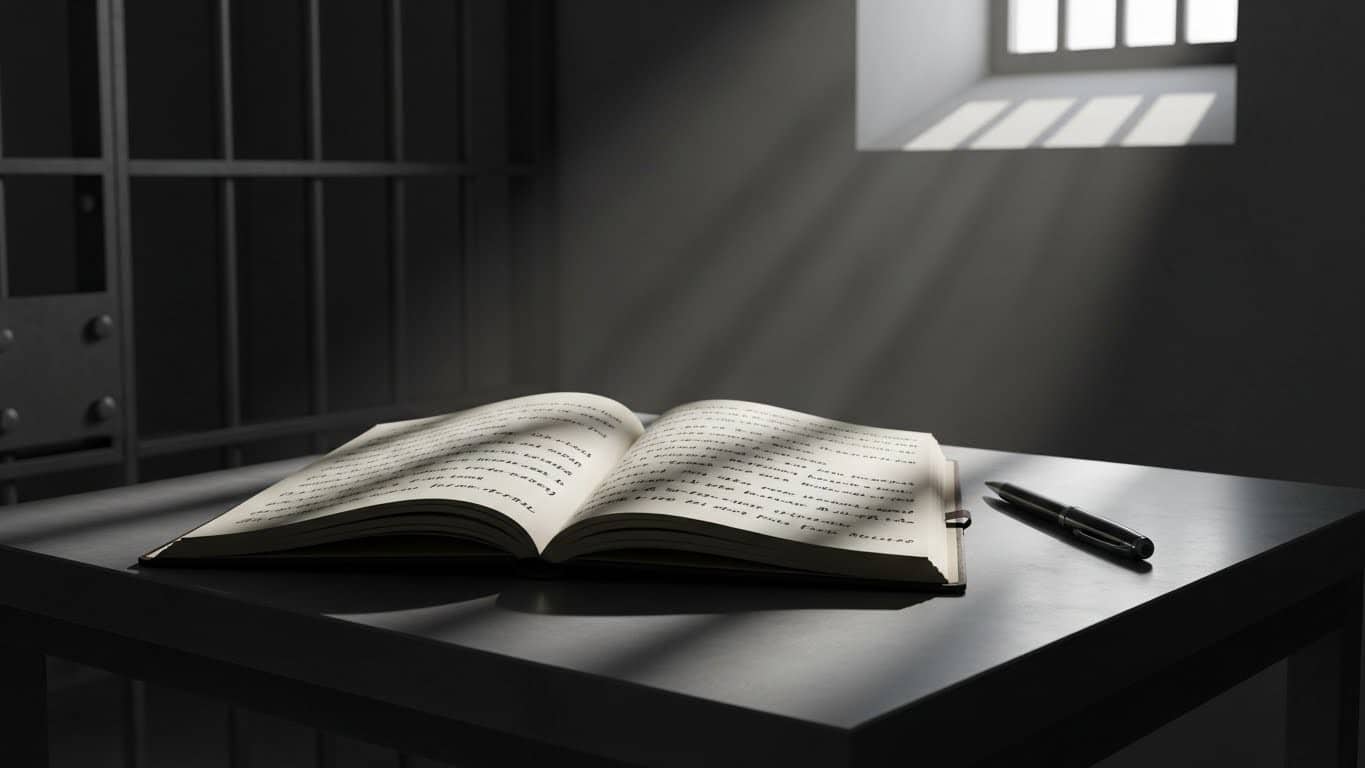Imaginez un instant : l’homme que tout un pays a appris à haïr ouvre un cahier en prison et se met à écrire. Pas pour demander pardon, non. Pour raconter sa vérité, sa vie, ses explications. Et s’il trouvait un éditeur prêt à publier ça ? C’est exactement ce qui se passe en ce moment avec Dominique Pelicot, le principal condamné de l’affaire des viols de Mazan.
Je dois vous avouer que, personnellement, l’information m’a laissé sans voix. On parle d’un septuagénaire condamné à vingt ans de réclusion criminelle qui, moins d’un an après le verdict, cherche déjà à reprendre la parole publiquement. Pas dans une interview encadrée, pas lors d’une audience. Non : dans un livre entier. Peut-être plusieurs.
Derrière les murs, la plume remplace la parole
Depuis sa condamnation prononcée en décembre 2024, il n’a pas chômé. Romans, recueils de poèmes, et surtout une autobiographie détaillée : voilà le fruit de ses mois de détention. Selon son avocate, il souhaite avant tout être lu. Comprendre : qu’on entende enfin sa version des faits. Celle qu’il n’a pas vraiment pu développer au procès, diront certains. Celle que personne ne veut entendre, répliqueront les autres.
Le projet est pris au sérieux. Un journaliste connu possède déjà les manuscrits et démarche activement les maisons d’édition. Mais pour l’instant, le silence est assourdissant. « Beaucoup de frilosité », confirme sobrement l’avocate. Traduisez : personne n’ose.
Pourquoi un tel malaise chez les éditeurs ?
La question mérite d’être posée franchement. Publier le récit d’un homme condamné pour avoir drogué et fait violer son épouse pendant dix ans, ça pose évidemment problème. Éthique, bien sûr. Mais aussi commercial et juridique.
D’un côté, il y a la liberté d’expression, le droit pour chacun de s’expliquer, même quand les actes sont monstrueux. De l’autre, il y a la douleur des victimes – au premier rang desquelles son ex-épouse – et la peur de paraître cautionner, ne serait-ce qu’un instant, le discours du bourreau.
« Il a envie d’être lu, surtout son parcours de vie, de raconter sa version des choses »
– L’avocate de Dominique Pelicot
Cette phrase, prononcée calmement, fait l’effet d’une bombe. Parce qu’elle révèle une chose : en prison, l’homme n’a pas renoncé à occuper l’espace médiatique. Il a simplement changé d’outil. La parole est bridée ? Très bien, il passera par l’écrit.
Le précédent des « grands criminels » qui publient
On a déjà vu ça, évidemment. Certains se souviennent du livre de Maurice Papon, d’autres des mémoires controversés d’anciens collaborateurs. Plus récemment, des affaires de terrorisme ou de tueurs en série ont donné lieu à des publications très débattues. Chaque fois, la même question : jusqu’où va le droit de prendre la parole quand on a commis l’irréparable ?
Mais le cas présent est particulier. Ici, la victime principale est encore vivante, très présente médiatiquement, et s’apprête elle-même à publier son propre récit dans quelques mois. Deux livres, deux regards opposés, sur la même histoire. L’un depuis la cellule, l’autre depuis la lumière crue de la résilience. Le contraste est violent.
- Le condamné écrit pour se justifier (ou du moins expliquer)
- La victime écrit pour se reconstruire et aider les autres
- Le public sera juge… s’il accepte de lire l’un, l’autre, ou aucun des deux
Et c’est peut-être là que ça coince le plus. Qui achèterait le livre de Dominique Pelicot ? Par curiosité malsaine ? Par volonté de comprendre l’incompréhensible ? Ou simplement parce que certains lecteurs adorent plonger dans les abysses de l’âme humaine, même les plus sombres ?
La frilosité des éditeurs : peur du bad buzz ou principe moral ?
Disons-le clairement : personne n’a envie de se retrouver avec une campagne de boycott sur les réseaux sociaux le jour de la sortie. Imaginez les titres : « Untel édite le monstre de Mazan ». Ça ne passe pas. Même les maisons habituées aux textes sulfureux hésitent.
Il y a aussi la question juridique. Les victimes – et elles sont nombreuses – pourraient attaquer en justice. Diffamation ? Atteinte à la dignité ? Le risque existe. Et puis il y a les associations, les collectifs féministes, les personnalités publiques déjà très mobilisées sur ce dossier. Le coût d’image serait colossal.
Pourtant, certains éditeurs indépendants ou spécialisés dans les témoignages « à la limite » pourraient être tentés. On a vu des livres de détenus condamnés pour des crimes graves trouver preneur ces dernières années. Parfois sous pseudonyme, parfois sans photo, mais ils existent.
Et si on parlait du contenu, justement ?
Personne ne l’a lu, évidemment. Les manuscrits circulent sous le manteau. Mais on peut imaginer. Une enfance difficile ? Une construction psychologique particulière ? Des justifications que lui seul trouve recevables ? Des regrets (ou pas) ? Des accusations en retour ? Tout est possible.
Ce qui est sûr, c’est que l’homme a eu le temps de réfléchir. Des mois entiers, seul avec lui-même. La prison, parfois, pousse à l’introspection. Parfois aussi à la réécriture complète de sa propre histoire. On appelle ça le déni, ou la rationalisation. Les psychiatres qui l’ont expertisé en savent quelque chose.
Ce qui trouble, c’est cette volonté farouche de publier maintenant. Pas dans dix ans, quand la tempête sera retombée. Non, tout de suite. Comme s’il y avait urgence à rétablir une vérité qu’il estime bafouée. Ou comme s’il voulait garder la main, ne pas laisser le récit lui échapper complètement.
Le parallèle troublant avec le livre de son ex-épouse
Le timing est presque cruel. Dans quelques semaines, c’est elle qui prendra la parole, par la voix écrite cette fois. Un récit attendu, soutenu, porté par une grande maison. Elle y racontera la sidération, la reconstruction, le courage. Un livre qui, lui, ne posera aucun problème éthique à publier.
Deux livres. Deux versions. Le même cauchemar, vu de deux côtés du miroir. L’un risque de se vendre à des centaines de milliers d’exemplaires. L’autre pourrait ne jamais voir le jour. Et quelque part, c’est peut-être ça, la vraie sanction : être réduit au silence, même quand on crie.
Mais est-ce vraiment une sanction ? Ou simplement le prix à payer quand on a détruit des vies ? La question reste ouverte.
Et nous, lecteurs, que ferions-nous ?
Soyons honnêtes deux minutes. Si demain, par curiosité, on tombait sur ce livre en librairie (ou en ligne, sous le manteau), combien d’entre nous cliqueraient « ajouter au panier » ? Pas pour approuver, bien sûr. Juste pour comprendre. Pour voir jusqu’où peut aller le déni, la perversité, l’aveuglement.
Il y a une forme de fascination morbide, on le sait. Les affaires criminelles remplissent les rayons, les podcasts, les séries. Mais quand le criminel prend lui-même la plume, ça change tout. Ça devient trop proche. Trop réel.
Peut-être que finalement, le plus grand châtiment n’est pas l’hésitation des éditeurs. Peut-être que c’est de savoir qu’on écrira, qu’on enverra des manuscrits, et que personne ne voudra les lire. Rester enfermé avec ses mots, comme on est enfermé avec ses actes.
À moins que… À moins qu’un jour, un éditeur ose. Et là, tout recommencera.
En attendant, l’histoire continue d’écrire ses chapitres les plus sombres. Un stylo gratte du papier dans une cellule. Quelque part ailleurs, une femme se reconstruit en posant des mots sur l’innommable. Et nous, on regarde, on juge, on se demande où s’arrête la liberté de parole et où commence le respect dû aux victimes.
Une chose est sûre : ce n’est pas fini. L’affaire de Mazan continue de nous hanter, bien au-delà du verdict.