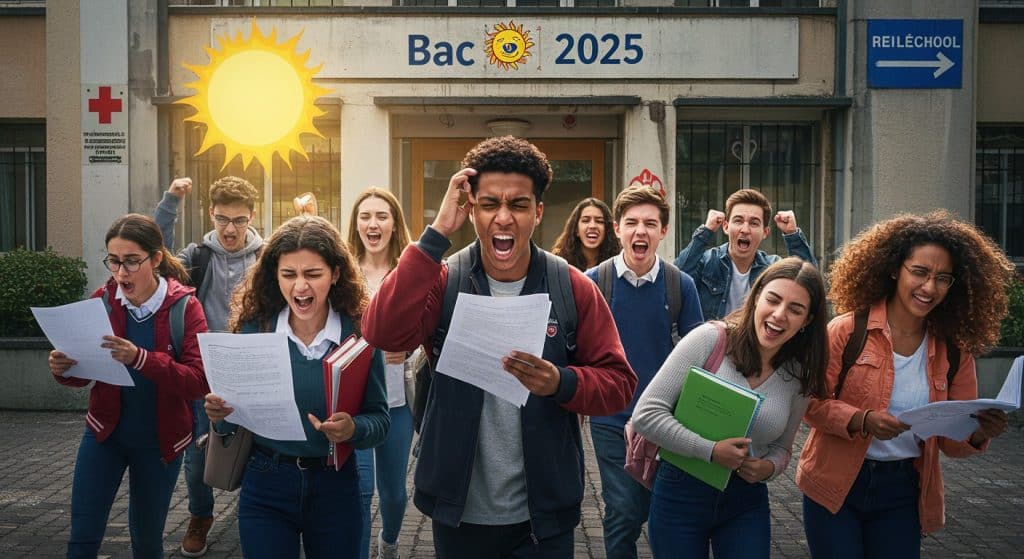Vous est-il déjà arrivé de hésiter à prendre le dernier tram parce que l’ambiance vous semblait un peu trop lourde ? De jeter des regards inquiets autour de vous en attendant le bus à une heure tardive ? À Saint-Étienne, beaucoup d’usagers connaissent cette petite boule au ventre. Et si, dès la fin du mois, tout cela changeait grâce à une idée qui n’existe nulle part ailleurs en France ?
C’est l’histoire d’une ville de taille moyenne qui décide de frapper fort sur la sécurité dans ses transports en commun. Pas avec plus de caméras ou de vigiles privés, non. Avec une patrouille composée exclusivement de policiers nationaux et gendarmes réservistes armés, dédiée à 100 % aux bus et tramways. Une grande première, et franchement, ça mérite qu’on s’y arrête deux minutes.
Une patrouille jamais vue ailleurs en France
Ce qui rend le projet vraiment original, c’est sa composition. On ne parle pas de simples agents de sécurité ou de médiateurs. Ici, ce sont huit réservistes opérationnels – donc des gens qui ont déjà l’expérience et l’entraînement des forces de l’ordre – qui vont monter dans les rames et les bus, en tenue, avec leur arme de service. La moitié vient de la police nationale, l’autre de la gendarmerie. Ensemble, ils forment une unité mixte dédiée aux transports. En France, personne n’avait osé ce mélange jusqu’à présent.
Le maire de la ville le répète avec une certaine fierté : c’est du jamais-vu. Et quand on creuse un peu, on se rend compte qu’il n’a pas tort. Dans d’autres agglomérations, on voit parfois des policiers municipaux renforcés ou des équipes de médiation. Mais une brigade qui réunit sous le même commandement des réservistes des deux grandes forces de l’État ? C’est inédit.
Pourquoi maintenant ? Le sentiment d’insécurité pèse lourd
Officiellement, les chiffres de la délinquance dans les transports stéphanois n’ont pas explosé. Pas de flambée spectaculaire des agressions ou des vols à l’arrachée. Pourtant, le sentiment d’insécurité, lui, est bien là. Et c’est souvent lui qui fait le plus de dégâts. Quand les gens commencent à éviter certains horaires ou certaines lignes, les transports en commun perdent leur raison d’être.
Les témoignages recueillis sur le terrain sont éloquents. Une retraitée du quartier Bergson qui prend le tram tous les jours m’a confié qu’elle ne se sentait plus vraiment à l’aise après 20 heures. Des jeunes qui racontent les regards insistants, les remarques, parfois pire. Et puis il y a eu les émeutes de 2023, qui ont laissé des traces dans les mémoires. Même si les bus et tramways n’ont pas été les cibles principales, l’idée qu’une rame puisse déraper rapidement reste dans les têtes.
« Le soir, je préfère rentrer à pied plutôt que d’attendre le bus seule. S’il y avait des agents en uniforme dans les rames, je reprendrais les transports sans hésiter. »
– Monique, habitante de Saint-Étienne
Comment ça va fonctionner concrètement ?
Pour cette première année, le dispositif reste en mode expérimental. Huit agents, ça ne permet pas d’être partout tout le temps. Le planning prévoie donc l’équivalent de deux jours pleins par semaine en moyenne, avec une grande souplesse. Quand le réseau signale une tension particulière – fête, match, période de forte affluence –, les patrouilles peuvent être renforcées en quelques heures.
Le centre névralgique, c’est le PC sécurité de l’opérateur de transports. Grâce aux caméras et aux remontées des conducteurs, ils voient en temps réel où ça chauffe. C’est là que se décide l’itinéraire des patrouilles. Un peu comme un chef d’orchestre qui dirige ses musiciens en fonction de la partition du moment.
- Détection d’un incident ou d’un secteur sensible via le PC sécurité
- Envoi immédiat de la patrouille mixte sur place
- Possibilité de faire appel à la police municipale en renfort si nécessaire
- Présence visible et dissuasive dans les rames et aux arrêts stratégiques
Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, les agents n’auront pas seulement un rôle répressif. Leur simple présence, en uniforme, avec l’autorité que ça confère, devrait suffire dans la plupart des cas à calmer les esprits.
230 000 euros pour un an : cher ou pas cher payé ?
La question du financement revient souvent. C’est la mairie qui met la main à la poche, à hauteur de 230 000 euros pour cette année test. À l’échelle d’une ville comme Saint-Étienne, ce n’est pas une somme astronomique. Surtout quand on sait que l’agglomération avait estimé à 2 millions d’euros le coût d’un dispositif similaire étendu à tout le territoire métropolitain.
Pour certains, c’est une goutte d’eau dans l’océan des besoins. Pour d’autres, c’est déjà trop, surtout si l’expérimentation ne débouche sur rien de concret. Personnellement, je trouve que le ratio coût/bénéfice potentiel est plutôt intéressant. Si ces 230 000 euros permettent à quelques milliers d’habitants de reprendre les transports en commun sereinement, l’investissement est largement rentabilisé en termes de lien social et de qualité de vie.
Le timing politique qui fait jaser
On ne va pas se mentir : le calendrier pose question. L’expérimentation démarre à quelques mois des élections municipales. Difficile de ne pas y voir une opération de communication bien rodée. D’ailleurs, certains usagers ne s’y trompent pas.
« J’espère qu’on ne nous vend pas du rêve à des fins politiques. »
La phrase est sortie spontanément lors d’une discussion place Massenet. Et elle résume assez bien le sentiment ambivalent d’une partie de la population. D’un côté, on veut y croire. De l’autre, on a vu tellement de promesses électorales rester lettre morte…
Mais il faut aussi reconnaître que le projet ne date pas d’hier. Il traînait dans les cartons depuis 2020. Les démarches administratives pour faire travailler ensemble police nationale et gendarmerie, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc oui, le timing est pratique. Mais non, ce n’est pas sorti du chapeau la veille des élections.
Et après ? Vers un modèle replicable ailleurs ?
Un premier bilan est prévu dans un an. Si les résultats sont positifs – baisse du sentiment d’insécurité, absence d’incidents majeurs pendant les patrouilles, satisfaction des usagers –, la question de la pérennisation se posera forcément. Et là, deux scénarios possibles.
Soit la métropole finit par mettre la main à la poche et on étend le dispositif à l’ensemble de l’agglomération. Soit d’autres villes s’en inspirent et adaptent le modèle. Car c’est peut-être ça, le plus intéressant dans l’histoire : Saint-Étienne pourrait bien faire office de laboratoire pour tout le pays.
Dans un contexte où la sécurité dans les transports devient un enjeu national – regardez les débats autour des lignes de nuit à Paris ou des RER en Île-de-France –, une expérimentation qui marche aurait valeur d’exemple. Et ça, ça dépasse largement le cadre local.
Ce que j’en pense, personnellement
J’ai suivi pas mal d’initiatives de ce genre ces dernières années. Entre les caméras partout, les agents privés, les applications de signalement… on a tout essayé. Et souvent, ça donne l’impression de traiter les symptômes plus que la maladie.
Là, pour une fois, on remet de l’humain au cœur du dispositif. Des agents formés, avec une vraie autorité, qui peuvent intervenir immédiatement. Pas de hotline à appeler, pas d’attente interminable. Juste des femmes et des hommes en uniforme qui font le boulot.
Après, rien n’est parfait. Huit agents, même bien organisés, ça reste limité. Et il ne faudrait pas que cette patrouille devienne un alibi pour ne rien faire sur les autres sujets : éclairage des arrêts, fréquence des passages en soirée, aménagements urbains qui rassurent… La sécurité, c’est un tout.
Mais pour une première étape ? Franchement, je trouve ça plutôt malin. Et si ça marche à Saint-Étienne, je parie que d’autres villes vont rapidement suivre. Parfois, il faut une commune de taille moyenne pour oser ce que les grandes agglomérations n’arrivent pas à mettre en place à cause de la lourdeur administrative.
Alors, opération gadget ou vraie avancée ? Réponse dans un an. En attendant, les premiers réservistes vont bientôt enfiler leur brassard. Et quelque part, c’est déjà une petite révolution dans le paysage de la sécurité publique à la française.
Et vous, qu’en pensez-vous ? Est-ce que vous reprendriez plus facilement les transports en commun s’il y avait des patrouilles comme celle-ci ? Ou est-ce que vous trouvez que l’argent serait mieux utilisé ailleurs ? Dites-le moi en commentaire, ça m’intéresse vraiment.