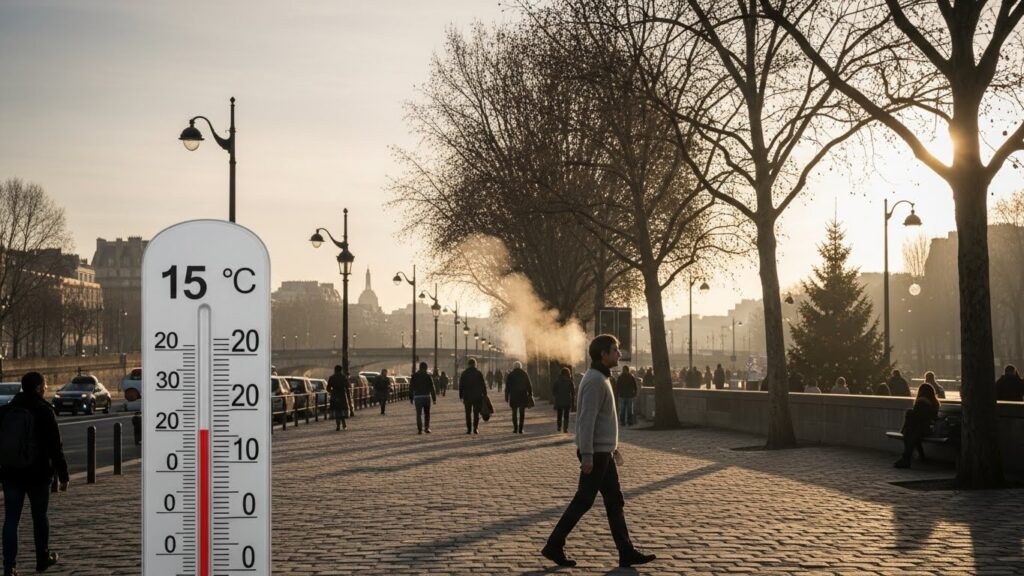Vous souvenez-vous de l’été 2022 ? Les images de Sainte-Soline, les affrontements, les grenades, les slogans « pas une bassine de plus ». Trois ans plus tard, le vent semble avoir tourné, du moins dans le nord de la Charente-Maritime. Là-bas, on ne parle plus seulement de projets : on passe à la phase béton. Six nouvelles réserves d’eau, plus une réhabilitation, vont sortir de terre dès 2027. Et franchement, ça fait réagir tout le monde.
Un projet qui renaît de ses cendres après dix ans de galère
Reprenons depuis le début, parce que l’histoire est longue et pleine de rebondissements. En 2015, le département crée un syndicat spécialement dédié à la construction de réserves d’eau de substitution – ces fameuses « bassines » que certains appellent des cratères, d’autres des assurances-vie agricoles. Objectif : stocker l’eau l’hiver pour l’utiliser l’été, quand les cultures ont soif et que les rivières sont au plus bas.
Pendant des années, rien. Ou presque. Recours sur recours, annulations, nouveaux dossiers, nouveaux recours. Les associations environnementales gagnent du terrain, les agriculteurs s’impatientent. Et puis, au printemps 2025, la justice tranche définitivement : le projet peut avancer. Le dernier pourvoi en cassation est rejeté. Game over pour les opposants, du moins sur le plan juridique.
C’est le signal que tout le monde attendait. Le syndicat annonce immédiatement la couleur : six nouvelles réserves, plus une septième déjà existante à remettre aux normes, dans la vallée de la Boutonne. Volume total ? Près de 2 millions de mètres cubes. De quoi irriguer sereinement plusieurs centaines d’hectares de maïs, de tournesol ou de cultures maraîchères.
Des chiffres qui font tourner la tête
Parlons argent, parce que c’est là que ça coince souvent. En 2018, la première tranche était estimée à 11,2 millions d’euros hors foncier. Aujourd’hui ? On est à plus de 20,5 millions. Presque le double. Et devinez quoi ? 70 % seront payés par l’Agence de l’eau, donc par nos impôts et nos factures d’eau. Le syndicat met 20 %, le département 10 %. Les agriculteurs ? Ils ne sortent que… rien pour la construction. Leur participation commence quand ils rempliront leur assiette.
Et puis il y a ce poste budgétaire qui fait bondir : plus de 3,3 millions d’euros pour « sécuriser » les chantiers et les futures réserves. Clôtures ultra-résistantes, caméras, vigiles, fossés anti-intrusion… On protège des ouvrages légaux comme s’il s’agissait de centrales nucléaires. Ubuesque ? C’est le mot qu’utilise la présidente du syndicat elle-même.
« On dépense des millions en pure perte, et vraisemblablement avec de l’argent public, pour protéger des équipements qui sont pourtant parfaitement légaux. »
Françoise de Roffignac, présidente du syndicat des réserves 17
Un modèle économique sous haute tension
Le prix de l’eau, voilà le nerf de la guerre. Pour la première bassine, celle de Saint-Félix, on parle de 47 centimes le mètre cube. Une fois les six construites et les coûts lissés, on descendrait à 30 centimes. C’est cher payé, surtout quand on sait que certains voisins tournent à 15 ou 20 centimes.
Et là, petite pensée pour la Coop de l’eau 79, juste de l’autre côté de la frontière départementale. Leur mégabassine de Sainte-Soline, celle qui a fait la une, peine à trouver l’équilibre financier avec des tarifs similaires. Certains irrigants traînent des pieds pour payer. Résultat ? Des impayés, des tensions, des menaces de saisie. Le syndicat charentais jure que ça n’arrivera pas chez eux. « Les précautions nécessaires ont été prises », assure-t-on. On verra.
- 153 agriculteurs déjà engagés dans l’association syndicale
- Toutes les parcelles nécessaires déjà sécurisées
- Onze réserves pourraient même être lancées immédiatement si on voulait accélérer
- 22 exploitations directement bénéficiaires de la première tranche
Les contreparties environnementales : du sérieux ou du vernis ?
Évidemment, rien n’est gratuit. L’arrêté préfectoral impose tout un tas d’obligations aux irrigants : réduction des prélèvements estivaux dans la nappe, plantation de haies, baisse des pesticides, rotation des cultures plus vertueuse… Des mesures « nombreuses et contraignantes », reconnaît même le préfet. C’est le prix à payer pour faire accepter le projet.
Mais du côté des associations, on reste méfiant. Très méfiant. Pour eux, on continue à privatiser une ressource commune au profit d’une agriculture intensive. Et la biodiversité dans tout ça ? On parle peu de restauration des zones humides, de reconnection des cours d’eau, de protection réelle des écosystèmes. Le sujet semble presque tabou.
« Le modèle évolue sur un fil. Et si les agriculteurs ne peuvent pas payer ? La biodiversité, elle, reste la grande oubliée. »
Responsable d’une association locale de protection des rivières
Pourquoi ça passe en Charente-Maritime et pas ailleurs ?
C’est la grande question. Dans la Vienne, l’État a récemment lâché l’affaire sur certains projets. Dans les Deux-Sèvres, c’est toujours la guerre froide. Alors pourquoi ici, ça avance ? Plusieurs éléments de réponse.
D’abord, une majorité départementale qui soutient le projet depuis le début. Ensuite, un préfet qui affiche clairement la couleur : « Les réserves de substitution restent une priorité gouvernementale ». Et enfin, un dossier juridique blindé, passé entre les gouttes des tribunaux pendant que d’autres prenaient l’eau.
Résultat ? On fait des envieux, dit-on dans les couloirs. Des départements voisins regardent avec intérêt, voire jalousie. Si le modèle charentais fonctionne – chantier à l’heure, remplissage sans sabotage, paiement des factures – il pourrait devenir une référence. Sinon… eh bien, on risque de reparler longtemps de ces 20,5 millions d’euros.
Et nous, simples citoyens, on en pense quoi ?
Personnellement, je suis partagé. D’un côté, on ne peut pas nier le changement climatique. Les étés deviennent plus secs, les nappes phréatiques baissent, les restrictions d’eau se multiplient. Les agriculteurs ont besoin d’outils pour continuer à produire. De l’autre, stocker des millions de mètres cubes derrière des digues géantes, avec autant d’argent public, pour essentiellement du maïs destiné à l’élevage… ça laisse un goût bizarre.
Ne pourrait-on pas, par exemple, accompagner plus massivement la transition vers des cultures moins gourmandes en eau ? Investir davantage dans l’agroécologie, les couverts végétaux, les techniques de rétention naturelle des sols ? Les deux ne sont pas forcément incompatibles, mais pour l’instant, la balance penche clairement d’un côté.
Ce qui est sûr, c’est que le dossier des bassines n’a pas fini de nous diviser. Chaque nouvelle annonce ravive les braises. En 2027, quand les pelleteuses arriveront à Saint-Félix, on saura si le compromis trouvé tient la route… ou s’il explosera en vol.
Une chose est certaine : l’eau est devenue un sujet politique majeur. Et en Charente-Maritime, le compte à rebours est lancé.