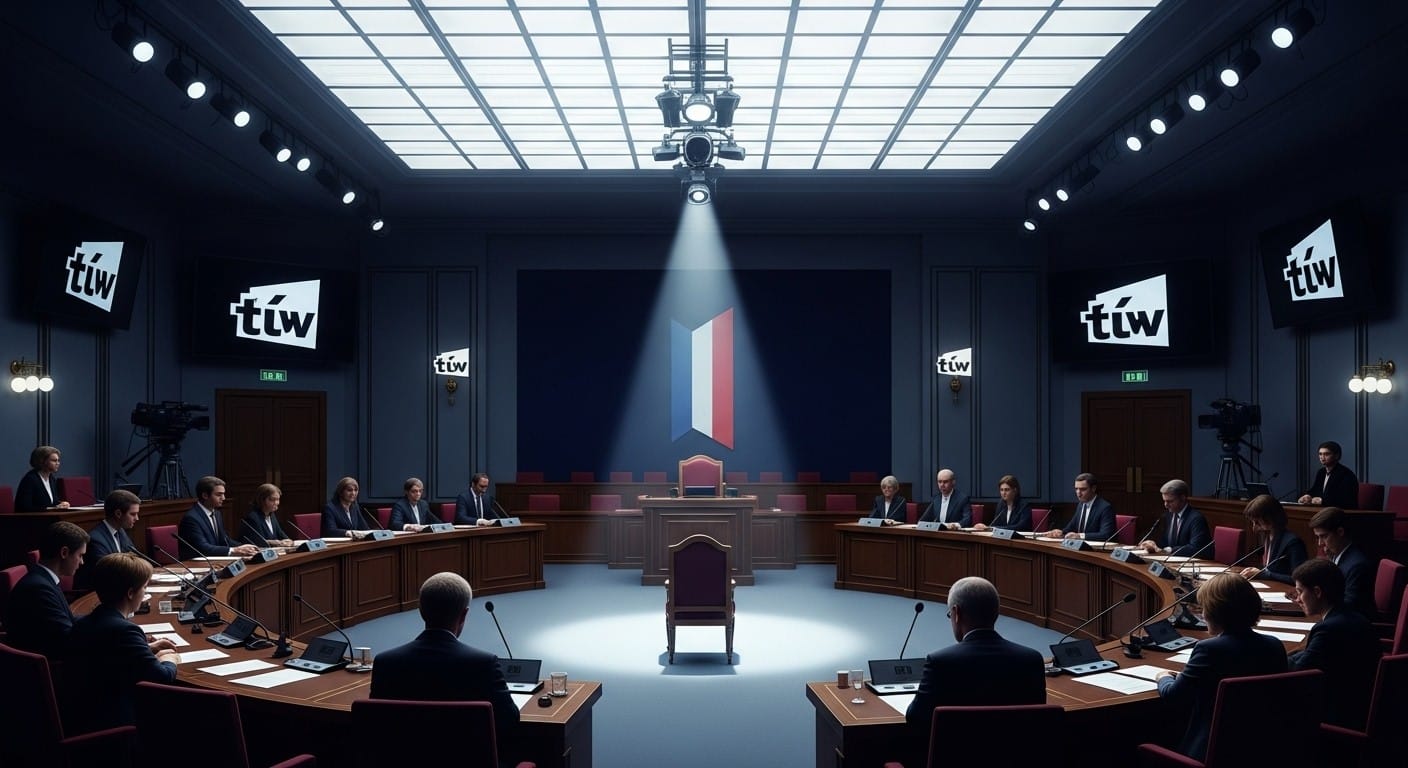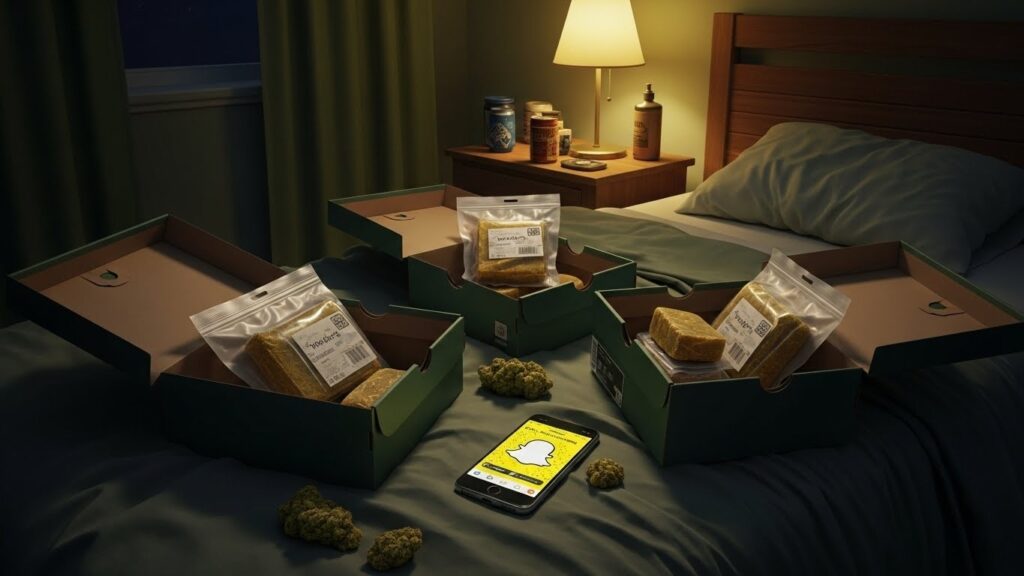Vous souvenez-vous de ce moment où l’on a vraiment senti que quelque chose clochait dans le paysage médiatique français ? Moi, c’était il y a quelques mois, quand une simple séquence télé a mis le feu aux poudres et relancé, brutalement, le débat sur la neutralité de nos chaînes et radios publiques. Demain, mardi, ça y est : la machine judiciaire parlementaire se met en marche. Une commission d’enquête va scruter pendant plusieurs semaines le fonctionnement, le financement et surtout l’impartialité de l’audiovisuel public. Et franchement, ça s’annonce comme un sacré feuilleton.
Une commission née dans la tempête
Tout part d’un épisode qui a fait couler énormément d’encre. Un échange musclé, des accusations de parti pris, et hop, le sujet de la neutralité est revenu au centre du débat politique comme un boomerang. Un député connu pour ses positions tranchées a sauté sur l’occasion et obtenu la création de cette commission d’enquête, l’un des outils les plus puissants dont dispose le Parlement. Quand on sait que les auditions sont publiques, filmées et sous serment, on comprend vite que personne ne va y aller en tongs.
Le président de l’autorité de régulation ouvrira le bal dès cet après-midi. Et derrière lui, c’est tout le gratin qui va défiler. Dirigeants actuels, anciens patrons, journalistes stars, producteurs influents… même la ministre de la Culture et un ancien chef de l’État sont sur la liste. Autant dire que les prochains mois risquent d’être animés.
Qu’est-ce qu’on va vraiment examiner ?
Officiellement, trois grands axes : la neutralité éditoriale, le fonctionnement interne et le financement de l’audiovisuel public. Mais soyons honnêtes, c’est surtout le premier point qui fait trembler tout le monde. Peut-on encore parler d’information objective quand certains animateurs ou chroniqueurs affichent clairement leurs convictions ? La question n’est pas nouvelle, mais elle n’a jamais été posée avec une telle force contraignante.
« On regardera tout », a prévenu l’un des initiateurs de la commission. Tout, vraiment ?
Quand on entend ça, on se dit que les dossiers sensibles vont sortir des placards. Recrutements, choix des invités, orientation des sujets d’enquête, pressions éventuelles… rien ne devrait échapper à la curiosité des députés.
Les stars du petit écran dans le viseur
Parmi les noms qui reviennent le plus souvent, on trouve évidemment les figures emblématiques du service public. Celle qui incarne l’investigation coup de poing, celle qui anime les grandes matinées radio, celui qui pose des questions sans filtre… Tous vont devoir s’expliquer sur leur ligne éditoriale, leurs choix d’invités, parfois même leurs engagements personnels.
Et là, la question que tout le monde se pose en coulisses : est-ce qu’on peut être à la fois journaliste et militant ? J’ai toujours trouvé ce débat fascinant. Parce qu’en réalité, personne n’est totalement neutre. Mais quand on est payé par l’argent public, la barre est forcément plus haute, non ?
- Comment justifier certains angles systématiquement critiques sur certains sujets ?
- Pourquoi tel responsable politique est-il invité dix fois plus qu’un autre ?
- Les producteurs extérieurs influencent-ils vraiment les contenus ?
Ce sont ce genre de questions, précises, parfois gênantes, qui risquent de tomber dans les prochains jours.
Le financement, l’autre gros morceau
On parle souvent de neutralité, mais on oublie parfois que derrière chaque émission, chaque reportage, il y a un budget. Et cet argent vient en grande partie de nos impôts (ou de ce qu’il en reste après la suppression de la redevance). Du coup, la question est légitime : est-ce que le contribuable en a vraiment pour son argent ?
Les chiffres donnent parfois le vertige. Des centaines de millions d’euros chaque année, des contrats de production parfois opaques, des salaires qui font régulièrement polémique… Tout ça va être passé au peigne fin. Et quand on sait que certains producteurs très proches des dirigeants trustent les appels d’offres, on comprend que le sujet est sensible.
Et la ministre dans tout ça ?
Elle aussi va devoir venir s’expliquer. Parce qu’au-delà des chaînes elles-mêmes, c’est tout le pilotage politique de l’audiovisuel public qui est en jeu. Quelle est la frontière entre tutelle légitime et ingérence ? Comment nomme-t-on les dirigeants ? Quels objectifs leur fixe-t-on vraiment ? Autant de sujets qui reviennent régulièrement sur la table depuis des années.
Ce qui est intéressant, c’est que cette commission arrive dans un contexte politique particulièrement tendu. Entre les débats sur le pluralisme, les accusations réciproques de biais et la montée en puissance des chaînes d’information continue, le service public se retrouve plus que jamais au cœur de la bataille pour l’opinion.
Un précédent qui fait peur (ou espérer)
Ce n’est pas la première fois qu’une commission s’attaque à l’audiovisuel public, loin de là. Mais cette fois, le ton semble différent. Plus offensif. Plus déterminé. Certains y voient une volonté réelle de faire le ménage, d’autres une opération purement politique. Peut-être un peu des deux, comme souvent.
Ce qui est sûr, c’est que les auditions vont être suivies comme une série Netflix. Chaque phrase sera décortiquée, chaque hésitation commentée, chaque révélation potentielle amplifiée. Et au bout du compte ? Peut-être des recommandations qui changeront vraiment la donne. Ou peut-être juste du bruit médiatique qui s’éteindra aussi vite qu’il est arrivé. L’histoire nous a habitués aux deux scénarios.
Et nous, spectateurs, qu’est-ce qu’on en retire ?
Personnellement, ce qui me frappe le plus dans cette affaire, c’est à quel point elle révèle notre rapport ambivalent à l’information. On veut des journalistes engagés qui tapent fort, mais on leur reproche ensuite de ne pas être neutres. On réclame du pluralisme, mais on zappe dès qu’on entend une opinion qui nous dérange.
Cette commission, au-delà des règlements de comptes politiques, pose une question de fond : quel modèle voulons-nous pour notre service public de l’information à l’ère des réseaux sociaux et des chaînes d’opinion assumées ? La réponse ne sera pas simple. Mais au moins, pour une fois, on va en parler sérieusement. Et ça, déjà, ce n’est pas rien.
Alors oui, il y aura probablement des moments gênants, des révélations embarrassantes, peut-être même quelques têtes qui tomberont. Mais si au bout du compte ça nous aide à mieux comprendre comment fonctionne vraiment notre audiovisuel public, alors cette commission aura été utile. Rendez-vous demain à 16h30 pour le début des hostilités. Quelque chose me dit que ça va secouer.
Et vous, vous en pensez quoi ? Le service public est-il encore neutre ? Ou est-ce une notion qui n’a plus vraiment de sens aujourd’hui ? Les commentaires sont ouverts, comme toujours.