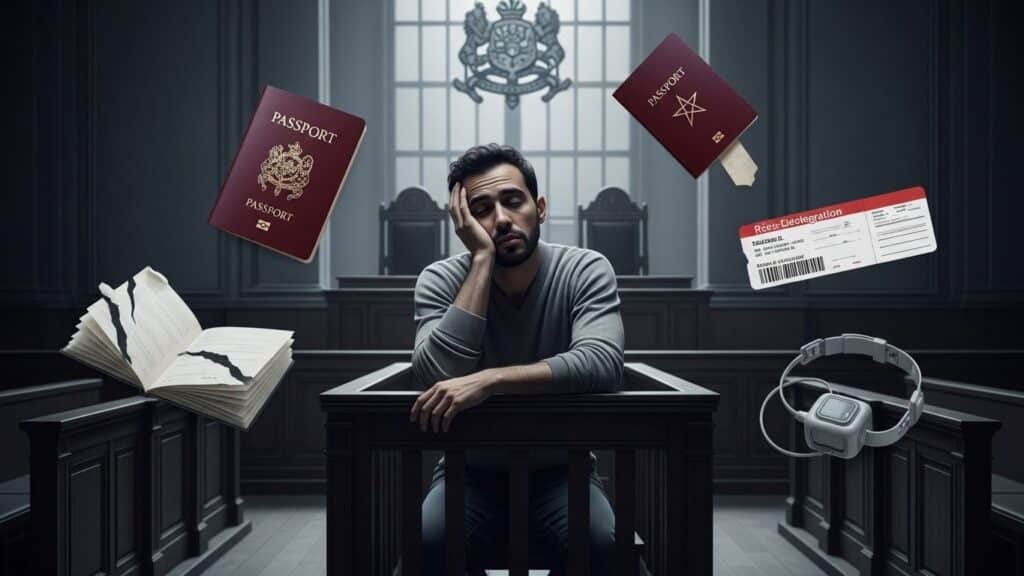Franchement, quand on suit les COP depuis quelques années, on finit par reconnaître le scénario. On arrive avec des rêves un peu fous, des discours enflammés, des pancartes « 1.5°C or bust », et on repart souvent avec un compromis tiède que tout le monde accepte en grimaçant. La COP30, qui se tient en ce moment au Brésil, ne déroge pas à la règle. Mais cette fois, le goût est particulièrement amer pour l’Europe.
Imaginez : après deux semaines de négociations marathon, des nuits blanches et des centaines de versions du texte, on nous présente un projet d’accord final que même les plus optimistes décrivent comme « assez plat ». Le mot est lâché, presque avec résignation, par la voix française dans la salle. Et pourtant, personne ne le bloquera. Pourquoi accepter quelque chose dont on sait déjà qu’il ne suffira pas ? C’est toute la question que pose cette fin de sommet.
Un texte qui ne fait mal à personne… ni vraiment de bien
Ce qui frappe d’abord, c’est la franchise des mots choisis. « On ne s’y oppose pas parce qu’il n’y a rien d’extraordinairement méchant à l’intérieur », a résumé la ministre française de la Transition écologique. Traduction : le texte n’est pas dangereux, il est juste… vide. Pas de grandes avancées sur la sortie des énergies fossiles, pas de calendrier clair, pas de chiffres qui font peur aux gros émetteurs. En clair, il ne dérange personne. Et c’est bien ça le problème.
L’Europe, elle, était venue avec une tout autre musique. Pour les Vingt-Sept, il fallait absolument un signal fort : reconnaître que les énergies fossiles sont la cause principale du réchauffement et s’engager à les réduire drastiquement. Un message presque existentiel quand on sait que le monde reste dépendant à 80 % du charbon, du pétrole et du gaz. Mais en face, le mur était solide.
« Nous n’allons pas cacher que nous aurions préféré davantage, et plus d’ambition sur tout »
– Le commissaire européen au Climat, au sortir d’une nuit de négociations
L’Europe isolée face à un bloc hétéroclite mais déterminé
On a beaucoup parlé d’un face-à-face. D’un côté l’Union européenne, souvent rejointe par les petits États insulaires et quelques pays très vulnérables. De l’autre, un groupe impressionnant par sa diversité : grands pays pétroliers bien sûr, mais aussi des émergents puissants et une partie du monde en développement. Tous ont un point commun : ils refusent qu’on leur impose un rythme de transition qu’ils estiment irréalisable ou injuste.
Et il faut bien reconnaître que leur argument n’est pas totalement dénué de fondement. Comment demander à un pays qui sort à peine de la pauvreté de renoncer demain à l’exploitation de ses ressources fossiles, alors qu’il a besoin d’énergie abordable pour développer ses hôpitaux, ses écoles, son industrie ? La réponse classique – « on va vous aider financièrement » – commence sérieusement à lasser quand on voit les promesses passées peu tenues.
- Les pays riches s’étaient engagés en 2009 à mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour le climat des pays en développement.
- L’objectif a été atteint… en 2022, avec beaucoup de créativité comptable.
- Pour la suite, on parle désormais de « milliers de milliards » nécessaires. Mais personne n’a encore mis la main à la poche de façon crédible.
Du coup, le chantage est simple : pas d’ambition sur les fossiles sans argent frais et massif sur la table. Et comme l’argent ne vient pas assez vite, l’ambition reste au placard.
Le syndrome du « mieux que rien »
C’est là qu’intervient le fameux « assez plat ». L’Europe aurait pu jouer la carte du blocage, comme elle l’avait laissé entendre en début de seconde semaine. Risquer une COP sans accord, créer un électrochoc. Mais elle ne l’a pas fait. Pourquoi ? Parce que dans le monde très particulier des négociations climatiques, ne rien décider du tout est souvent perçu comme pire que de décider peu.
J’ai suivi assez de ces sommets pour savoir que la peur du « no deal » pèse lourd. On se souvient de Copenhague en 2009 : l’échec cuisant a traumatisé toute une génération de négociateurs. Depuis, on préfère souvent un accord minimaliste qui sauve la face et maintient le processus en vie, plutôt que de tout faire sauter.
Et puis il y a la réalité politique interne. Qui veut rentrer chez soi en disant « j’ai fait capoter la COP » ? Personne. Surtout pas quand vos opinions publiques vous regardent déjà avec suspicion sur les questions climatiques.
Ce que ce texte « plat » contient malgré tout
Attention, « plat » ne veut pas dire totalement vide. Il y a quand même quelques éléments qui passeront peut-être inaperçus mais qui comptent :
- Une reconnaissance un peu plus claire du rôle central des énergies fossiles dans le réchauffement (même si sans calendrier de sortie)
- Des avancées techniques sur les marchés carbone et la transparence des engagements nationaux
- Un signal envoyé sur la nécessité de tripler les financements climat d’ici 2030 (sans chiffre précis malheureusement)
- Le lancement de discussions sur un nouvel objectif financier post-2025 (le fameux « millier de milliards »)
C’est maigre, oui. Mais dans le petit monde des COP, chaque phrase compte et pourra servir de base pour les prochaines batailles.
Et maintenant ? Vers une diplomatie climatique à plusieurs vitesses
Ce qui se dessine, et c’est peut-être l’aspect le plus intéressant de cette COP30, c’est l’émergence d’une réalité qu’on refusait de voir jusqu’à présent : il n’y aura probablement plus d’accord global ambitieux impliquant tout le monde de la même façon.
L’Europe va sans doute continuer à durcir ses propres objectifs – elle n’a d’ailleurs pas le choix avec son Pacte vert et ses lois climat. Une poignée de pays suivront, peut-être le Japon, le Canada, la Corée du Sud. Mais pour le reste du monde, la transition se fera à un rythme bien plus lent, dicté par les réalités économiques et les priorités de développement.
Est-ce dramatique ? Oui et non. Oui, parce que le temps presse et que chaque année perdue nous rapproche de points de non-retour. Non, parce que forcer tout le monde dans le même moule était peut-être une illusion dès le départ. Après tout, l’Accord de Paris lui-même repose sur des engagements volontaires, pas sur des contraintes universelles.
La question qui fâche : et la France dans tout ça ?
On entend beaucoup parler de « l’Europe » comme un bloc, mais chaque pays a ses petites musiques. La France, en particulier, aime se poser en leader climatique. On se souvient du « Make our planet great again » et de l’organisation de la COP21. Mais sur le terrain des négociations, force est de constater qu’elle pèse de moins en moins lourd seule.
Être dans le camp des « ambitieux » c’est bien, mais quand ce camp se réduit comme peau de chagrin, ça devient compliqué. Et puis il y a la réalité énergétique française : un pays qui a massivement misé sur le nucléaire (donc décarboné) mais qui reste très dépendant du gaz importé et qui peine à réduire ses émissions dans les transports et le bâtiment. Difficile de faire la leçon aux autres quand on traîne soi-même des boulets.
Le mot de la fin : l’urgence reste entière
Alors oui, la COP30 va probablement s’achever sur un accord fade. Les délégués vont se serrer la main, prendre des selfies devant les panneaux « I love Brazil », et repartir chacun chez soi en se disant que c’était mieux que rien.
Mais pendant ce temps, dehors, la planète continue de se réchauffer. Les records de température tombent les uns après les autres. Les événements extrêmes se multiplient. Et les scientifiques, eux, ne parlent plus en demi-teintes : il nous reste très peu de temps pour infléchir vraiment la trajectoire.
Peut-être que le vrai enseignement de cette COP30, c’est que l’espoir ne viendra plus uniquement des grandes messes onusiennes. Il viendra aussi – et peut-être surtout – des villes, des entreprises, des citoyens, des tribunaux, des investisseurs qui décident de prendre les devants. Parce qu’attendre que 195 pays tombent d’accord sur tout, c’était peut-être beau sur le papier, mais ça ne fonctionne plus.
La déception d’aujourd’hui n’est pas une fatalité. Elle peut aussi être un électrochoc. À condition qu’on accepte enfin de voir la réalité en face : le temps des petits pas prudents est révolu. Il va falloir courir. Et certains ont déjà commencé.