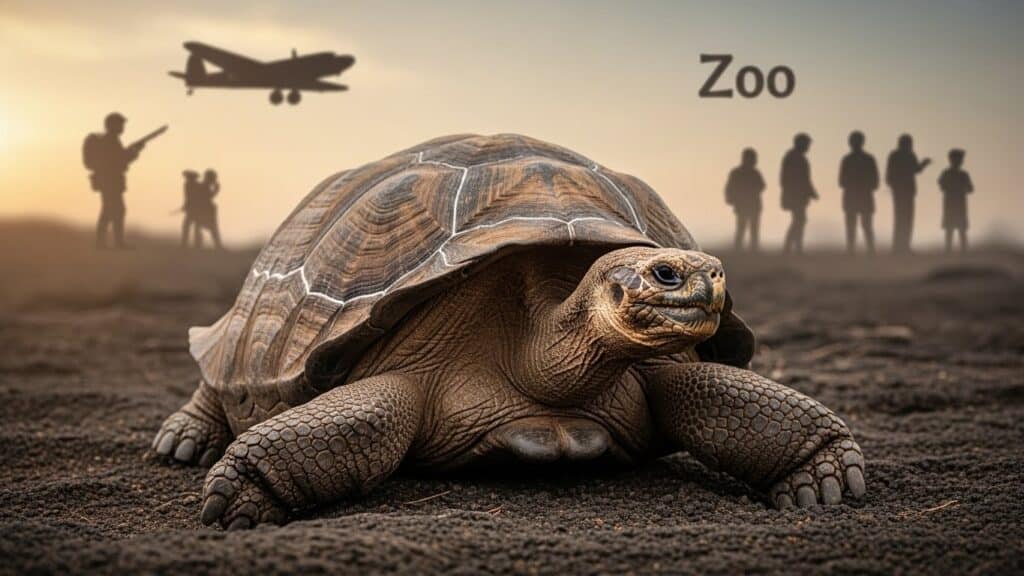Vous vous souvenez du temps où l’on faisait tourner la France avec d’immenses cheminées crachant leur fumée noire ? Moi oui. Et pourtant, en ce mois de novembre 2025, c’est précisément sur l’une de ces vieilles dames industrielles qu’on pose les fondations du futur numérique français.
Imaginez : 400 hectares de terrain, quelque part entre Vernou-la-Celle-sur-Seine et La Grande-Paroisse, qui dormaient depuis plus de vingt ans. Un silence lourd, quelques oiseaux, des herbes folles… Et demain ? Des milliers de serveurs qui ronronneront 24 heures sur 24 pour faire tourner l’intelligence artificielle de demain. Drôle de destin, non ?
Du charbon aux algorithmes : la plus belle reconversion du siècle ?
Cette histoire commence comme un symbole parfait de notre époque. Un site qui incarnait autrefois la puissance fossile va devenir l’un des plus gros campus de données d’Europe. Et le plus fou, c’est que tout reste français : le terrain appartient à un géant historique de l’électricité, le futur exploitant est la filiale d’un opérateur télécom bien connu des Français. Pas de fonds étrangers, pas de polémique sur la souveraineté. Juste deux acteurs hexagonaux qui décident de faire cause commune.
Le chiffre donne le vertige : environ 4 milliards d’euros d’investissement privé. À l’échelle d’un seul projet, c’est énorme. C’est presque la moitié de tout ce qui a été annoncé lors du dernier grand raout présidentiel destiné à attirer les investisseurs étrangers. Sauf que là, l’argent reste à la maison.
Un calendrier déjà bien avancé
Les travaux doivent démarrer rapidement. Objectif affiché : première mise en service partielle dès 2027. Pour un projet de cette taille, c’est ambitieux. Très ambitieux même. On parle de plusieurs bâtiments, de dizaines de milliers de mètres carrés de salles blanches, de systèmes de refroidissement dernier cri… Tout cela sur un terrain qui, il y a encore quelques mois, ressemblait plus à un décor de film post-apocalyptique qu’à un futur hub technologique.
Mais quand on connaît la détermination des équipes impliquées, on se dit que c’est possible. D’ailleurs, les études de sol sont déjà bien avancées, les raccordements électriques – ironiquement fournis par l’ancien propriétaire du site – sont en cours de dimensionnement. Tout s’enchaîne.
Cent emplois directs… et bien plus derrière
On nous promet une centaine d’emplois directs hautement qualifiés : ingénieurs réseaux, techniciens data center, experts cybersécurité, responsables énergie… Des métiers qui payent bien, qui forment les jeunes, qui font rester les talents en région parisienne plutôt que de les voir partir à Dublin ou Amsterdam.
Mais le vrai impact, c’est ailleurs. Plusieurs centaines d’emplois indirects : sous-traitance, restauration, sécurité, maintenance, formation… Sans parler des entreprises qui viendront forcément s’installer dans le coin quand elles sauront qu’un tel monstre de puissance de calcul est à deux pas. C’est tout un écosystème qui peut renaître.
- Ingénieurs spécialisés en refroidissement liquide
- Spécialistes de la haute tension et de la redondance électrique
- Experts en fibre optique et interconnexion
- Techniciens de maintenance 365 jours/an
- Équipes de sécurité physique et logique
Et ça, croyez-moi, ça change la vie d’un territoire.
L’épineuse question de l’énergie
Évidemment, on ne peut pas parler data center sans parler consommation électrique. C’est LE sujet qui fâche. Un gros campus comme celui-ci, ça peut avaler l’équivalent de la consommation d’une ville de 100 000 habitants en pleine canicule. Alors oui, on nous promet des solutions innovantes : récupération de chaleur fatale, immersion des serveurs dans l’huile pour mieux refroidir, contrats d’achat d’électricité verte… Tout l’arsenal habituel.
Mais soyons honnêtes : tant que le mix énergétique français restera très majoritairement nucléaire, la couleur « verte » de ces méga-centres restera relative. Après, il y a une réalité qu’on oublie souvent : ces serveurs tourneront de toute façon quelque part dans le monde. Autant qu’ils tournent chez nous, avec notre électricité décarbonée, plutôt qu’en Virginie sur du charbon ou du gaz. Vu sous cet angle, le bilan carbone n’est pas si mauvais.
« On préfère largement accueillir ces infrastructures en France, où 92 % de l’électricité est décarbonée, plutôt que de voir nos données traitées à l’étranger sur des énergies très émettrices. »
Un expert du secteur entendu récemment
Pourquoi ce site-là précisément ?
La réponse est presque trop belle. Un terrain immense, déjà dépollué (ou en cours), raccordé au réseau très haute tension, proche de Paris sans être dedans, au bord de la Seine pour le refroidissement éventuel, et surtout… déjà zoné industriel. Autrement dit : zéro opposition possible sur le principe. C’est ce qu’on appelle un site « plug and play » pour un projet de cette taille.
Ajoutez à cela une volonté politique locale forte – le département et la région poussent le dossier depuis des années – et vous avez la recette parfaite. Parfois, les planètes s’alignent.
Et les riverains dans tout ça ?
Forcément, la question revient souvent. Un data center, c’est discret. Pas de fumée, pas d’odeur, peu de camions une fois la construction terminée. Juste un ronronnement sourd et des bâtiments noirs un peu austères. Certains habitants se souviennent encore du bruit des convois de charbon. À côté, le futur voisin fera figure de moine trappiste.
Il y aura bien sûr des concertations, des engagements sur l’insertion paysagère, peut-être même un peu de chaleur récupérée pour chauffer des serres ou une piscine municipale – on voit ça ailleurs, pourquoi pas ici ? L’idée fait son chemin.
Un projet dans l’air du temps
Ce qui frappe, c’est à quel point ce projet colle à l’époque. Souveraineté numérique, réindustrialisation, attractivité française, intelligence artificielle… Tous les mots-clés y passent. Et pourtant, derrière les discours, il y a du concret : des grues qui vont bientôt arriver, des emplois qui vont se créer, une friche qui va revivre.
On peut toujours critiquer – et on le fera – la consommation énergétique, l’esthétique discutable, le sentiment que l’IA va tout bouffer. Mais on ne peut pas nier le symbole : transformer un vestige du XXe siècle carboné en infrastructure du XXIe siècle numérique, c’est une forme de poésie industrielle.
Et quelque part, c’est aussi une réponse à ceux qui disent que la France ne sait plus faire de grands projets. Là, si. Et plutôt deux fois qu’une.
Alors oui, en 2027, quand les premiers racks de serveurs s’allumeront sur l’ancienne centrale de Montereau-Vallée de la Seine, il y aura de quoi être fier. Pas seulement parce qu’on aura réussi à faire renaître un territoire. Mais parce qu’on aura prouvé qu’on pouvait encore écrire l’avenir avec nos propres mains.
Le charbon est mort. Vive les données.