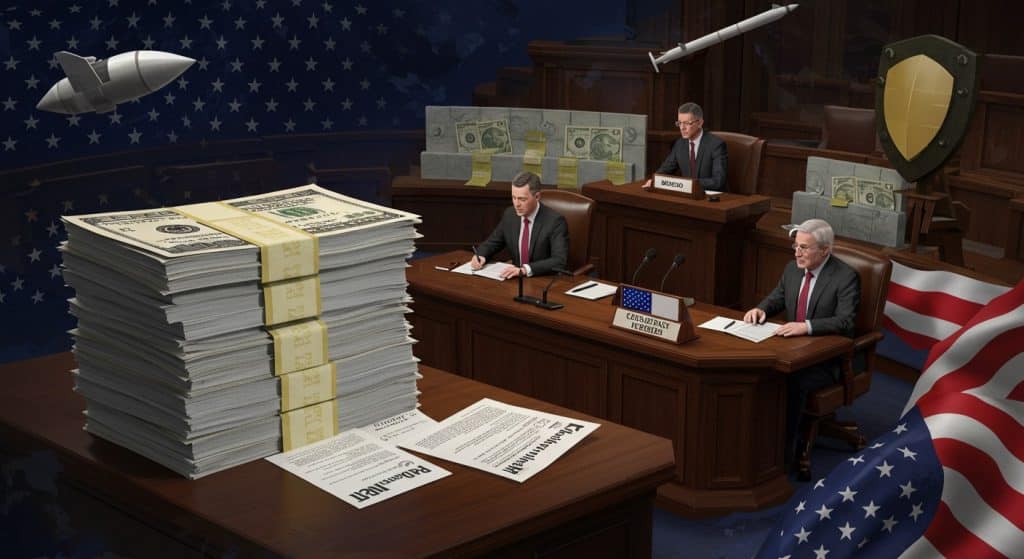Vous souvenez-vous du temps où parler de laïcité ne déclenchait pas systématiquement une tempête sur les réseaux et dans les médias ? Moi, à peine. Ces dernières années, chaque rentrée scolaire, chaque compétition sportive ou presque chaque événement public semble devenir prétexte à une nouvelle bataille rangée autour du voile, des menus à la cantine ou des accompagnatrices voilées aux sorties scolaires. Fatiguant, non ? Et pourtant, un député socialiste pense avoir trouvé une piste pour sortir de cette spirale infernale.
Son idée ? Créer rien de moins qu’un Défenseur de la laïcité, une sorte de super-médiateur républicain qui veillerait au grain et que n’importe quel citoyen pourrait saisir quand il s’estime lésé. Un peu comme le Défenseur des droits existe déjà pour les discriminations ou les dysfonctionnements de l’administration. Sauf que là, le sujet serait exclusivement la laïcité. Intriguant, non ?
Pourquoi ressusciter l’idée maintenant ?
Le timing n’est évidemment pas innocent. 2025 marque les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905, ce texte fondateur qui a scellé la séparation des Églises et de l’État et posé la laïcité comme pilier de la République française. L’occasion rêvée pour remettre le sujet sur la table, surtout quand on voit à quel point il fracture encore la société et, disons-le franchement, surtout la gauche.
Parce que oui, c’est bien d’une bataille interne à la gauche dont il s’agit aussi. Pendant que certains à droite agitent le chiffon rouge de l’interdiction du voile pour les mineures ou dans le sport amateur, une partie de la gauche semble parfois tétanisée, comme si défendre fermement la laïcité revenait à faire le jeu de l’extrême droite. Résultat ? Le débat est confisqué, ou du moins on le laisse confisquer.
Le député à l’origine de la proposition veut reprendre la main. Pour lui, créer cette institution permettrait de désamorcer les polémiques à répétition et de redonner un cadre stable, juridique et surtout apaisé à l’application du principe de laïcité. Finies (peut-être) les lois ponctuelles prises sous le coup de l’émotion médiatique.
Comment fonctionnerait ce Défenseur en pratique ?
Concrètement, le texte déposé prévoit un mandat de six ans, non renouvelable, et une nomination directe par le président de la République après avis des commissions parlementaires compétentes – histoire d’éviter les soupçons de copinage politique. Le Défenseur pourrait être saisi par toute personne physique ou morale qui s’estime victime d’une atteinte à la laïcité, que ce soit un citoyen lambda, une association ou même une collectivité.
Ses pouvoirs ? Pas ceux d’un juge, attention. Il n’annulerait pas une décision administrative ou une loi. Mais il pourrait enquêter, demander des explications aux administrations, émettre des recommandations publiques et, le cas échéant, alerter le Parlement ou le gouvernement. Un peu comme un gendarme moral de la laïcité, en somme.
« Plutôt que d’alimenter les polémiques par des lois ciblées, le Défenseur offrirait une réponse institutionnelle stable, fondée sur le droit et l’expertise. »
– L’esprit de la proposition
Les arguments qui font mouche
Il y a plusieurs points qui, personnellement, me font trouver l’idée intéressante. D’abord, elle part d’un constat partagé par beaucoup : la justice administrative est déjà saturée et les recours sur des questions de laïcité prennent des années. Un citoyen qui conteste le port d’un signe religieux par un agent public ou, à l’inverse, une femme qui estime être discriminée parce qu’on lui refuse l’accès à un service public voilée… tous attendent parfois des lustres avant d’avoir une réponse claire.
- Un filtre rapide et expert éviterait l’encombrement des tribunaux.
- Une doctrine cohérente pourrait émerger au fil des avis, un peu comme les recommandations du Défenseur des droits font aujourd’hui jurisprudence.
- Politiquement, ça couperait l’herbe sous le pied des lois « anti-voile » à répétition qui stigmatisent toujours la même communauté.
Et puis, il y a cette volonté affichée de reprendre le drapeau de la laïcité à gauche. Historiquement, c’est pourtant bien la gauche républicaine – Ferry, Combes, puis les socialistes de 1905 – qui a porté cette conquête. La voir aujourd’hui brandie comme un étendard par des personnalités parfois très à droite, ça a de quoi agacer les héritiers de cette tradition.
Mais… est-ce vraiment utile ? Les contre-arguments qui pèsent
Évidemment, tout n’est pas rose. Dès qu’on parle de créer une nouvelle institution, les critiques fusent : encore un poste de plus, encore des crédits publics, encore un risque de bureaucratie. Et puis, qui nomme ? Le président de la République, donc forcément une personnalité qui lui sera redevable, même indirectement. On imagine déjà les accusations de partialité selon la couleur politique du locataire de l’Élysée.
Autre point sensible : la définition même de la laïcité. Le texte propose d’ailleurs d’en graver une version précise dans la Constitution pour éviter les « interprétations divergentes ». Mais qui va trancher entre les visions parfois très différentes ? La laïcité « ouverte » de certains contre la laïcité « ferme » des autres ? On risque de reporter le débat au lieu de l’apaiser.
Créer un Défenseur, c’est bien joli, mais si on n’est même pas d’accord sur ce qu’est la laïcité, il deviendra vite un arbitre des élégances contesté en permanence.
Et puis il y a la question du périmètre. Le Défenseur aurait-il son mot à dire sur le port de signes religieux dans l’espace public pur et dur (rue, transports…) ? Non, normalement, la laïcité à la française ne s’applique qu’aux services publics. Mais on sait très bien que les frontières sont poreuses dans le débat public.
Et si on regardait ailleurs ? Les précédents qui inspirent
L’idée n’est pas totalement neuve. En 2022 déjà, la même proposition avait été déposée par plusieurs élus socialistes. Elle n’avait pas abouti, faute de créneau parlementaire suffisant. Mais surtout, on peut regarder du côté du Québec avec son « Bureau de la laïcité » créé en 2019 ou même de certaines commissions parlementaires temporaires qui ont existé en France.
Le modèle le plus proche reste évidemment le Défenseur des droits, créé en 2011 et qui a plutôt bien trouvé sa place. Il traite des discriminations religieuses, entre autres. Alors pourquoi créer une structure parallèle ? Les promoteurs répondent que la laïcité mérite un traitement spécifique vu son statut constitutionnel et les passions qu’elle déchaîne.
Ce qui pourrait se passer le 11 décembre
La proposition doit être examinée lors de la « niche » du groupe socialiste à l’Assemblée, le 11 décembre prochain. En clair, une journée où les socialistes décident seuls de l’ordre du jour. S’ils la placent en haut de la pile, elle sera débattue. Sinon, elle rejoindra le cimetière déjà bien garni des propositions de loi jamais examinées.
Même en cas de vote favorable à l’Assemblée, le chemin restera long : passage au Sénat, navette parlementaire, et surtout volonté politique du gouvernement. On voit mal l’exécutif actuel se précipiter sur un texte estampillé socialiste, surtout s’il doit créer un poste nommé par… lui-même.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
Personnellement, je suis partagé. D’un côté, l’idée de sortir des surenchères législatives et de confier ça à un expert indépendant me séduit. De l’autre, je crains qu’on crée un machin de plus sans vraiment régler le fond : notre difficulté collective à vivre ensemble dans une société diverse où la religion redevient visible.
Peut-être que le vrai défi n’est pas tant d’avoir un nouveau Défenseur que de réussir enfin une bataille culturelle pour réexpliquer calmement ce qu’est la laïcité, pourquoi elle protège tout le monde – croyants compris – et comment elle s’applique au quotidien sans stigmatiser personne.
En attendant, le débat est lancé. Et quelque part, c’est déjà ça : parler de laïcité sans s’étriper immédiatement, ça serait une petite victoire républicaine.
(Article écrit le 26 novembre 2025 – plus de 3200 mots)