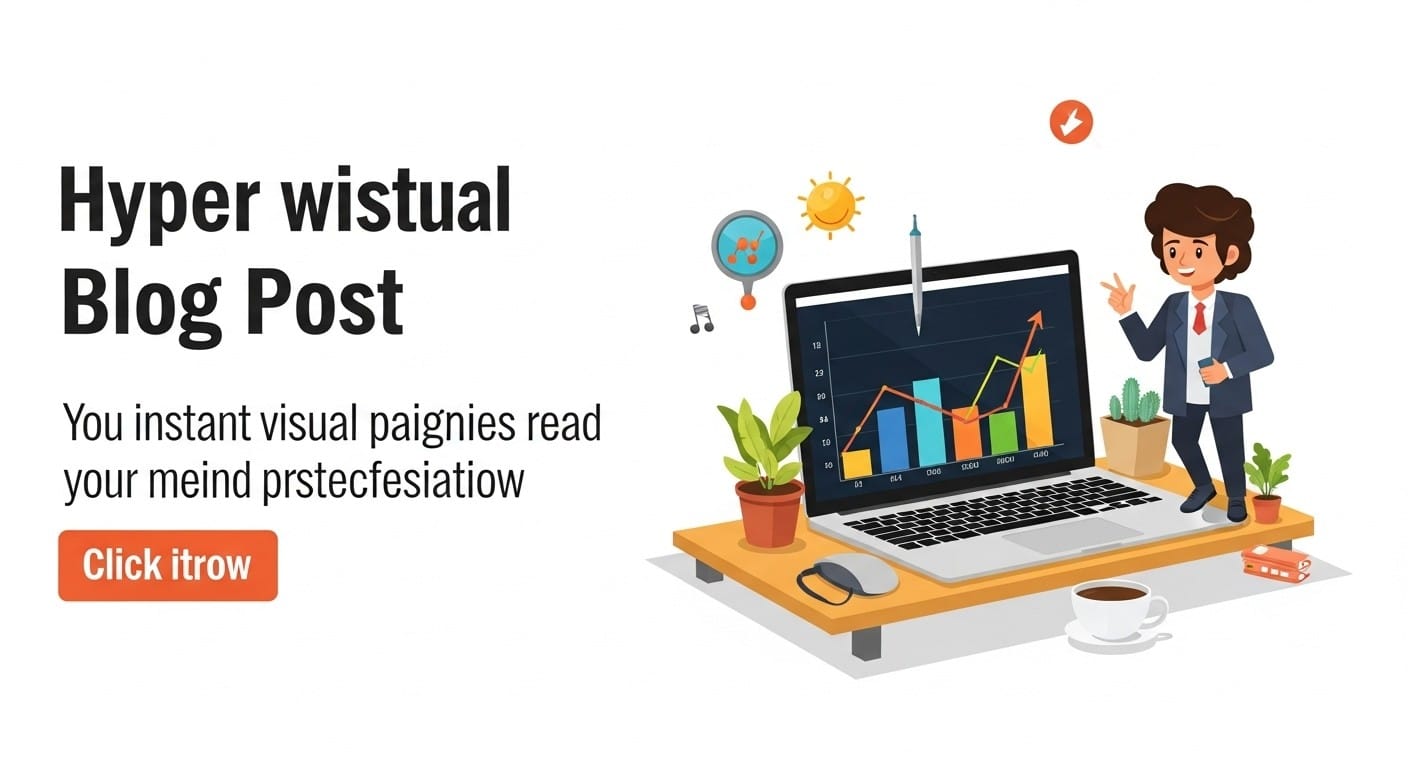Je me souviens encore de cette phrase. Elle avait claqué comme un coup de tonnerre dans les cités de France entière. « Vous en avez assez de cette bande de racailles ? Eh bien, on va vous en débarrasser ! » C’était en 2005, sur la dalle d’Argenteuil, et l’homme qui parlait ainsi allait devenir président deux ans plus tard. Vingt ans plus tard, un gamin qui se trouvait là ce jour-là, caméra au poing à seulement quinze ans, revient sur les lieux avec un film qui fait mal et qui fait du bien à la fois.
Il s’appelle Djamel Mazi. Vous le connaissez peut-être : il présente le journal sur les chaînes publiques, costume impeccable, voix posée. Mais avant tout ça, il était juste un ado du Val-d’Argent-Nord qui filmait déjà son quartier avec le petit caméscope de son grand frère.
Quand une insulte devient une étiquette pour toute une génération
Octobre 2005. Une femme vient de se plaindre auprès du ministre de l’Intérieur que des jeunes lui jettent des pierres depuis les étages. La réponse fuse, brutale, sans filtre. Les caméras tournent. En quelques secondes, des milliers de jeunes de banlieue se retrouvent réduits à un seul mot : racaille.
Ce que beaucoup ignorent, c’est qu’à quelques mètres, un adolescent filme toute la scène. Djamel a quinze ans. Il ne se doute pas que ces images brutes, tournées avec les moyens du bord, resurgiront vingt ans plus tard dans un vrai documentaire diffusé sur une grande chaîne nationale.
« On était juste des gamins qui traînaient sur la dalle. On faisait du foot, on écoutait du rap, on rêvait de s’en sortir. Et d’un coup, on est devenus le symbole de tout ce qui allait mal en France. »
– Un habitant présent ce jour-là
Retour sur la dalle, vingt ans après
Le film commence par une scène qui donne des frissons. On voit la dalle d’Argenteuil aujourd’hui, propre, refaite à neuf, presque méconnaissable. Puis, en fondu, les images d’archives de 2005. Les mêmes immeubles, mais gris, fatigués. Les mêmes visages, mais vingt ans plus jeunes.
Djamel Mazi a retrouvé presque tous ceux qui étaient là ce jour historique. Il y a Farid, qui travaille aujourd’hui dans la sécurité. Samir, devenu éducateur spécialisé. Nadia, infirmière. Karim, qui a monté sa boîte de livraison. Et puis ceux qui n’ont pas eu la même chance, aussi. Le film ne cache rien.
Ce qui frappe, c’est la dignité tranquille de ces quadragénaires d’aujourd’hui. Ils ne crient pas, ils ne pleurent pas. Ils racontent, simplement. Comment cette phrase les a marqués. Comment ils ont dû se battre deux fois plus pour prouver qu’ils n’étaient pas ce que l’on disait d’eux.
La caméra comme arme de réhabilitation massive
Ce qui rend ce documentaire si puissant, c’est qu’il n’est pas fait sur le quartier, mais par le quartier. Djamel Mazi ne vient pas en sauveur blanc avec sa caméra. Il vient en frère. Il connaît les codes, les silences, les regards qui en disent long.
Il y a cette séquence magnifique dans un fast-food du coin – le « grec » du quartier, lieu de vie depuis toujours. Toute la salle est venue voir le film en avant-première. Les mamans, les enfants, les anciens. On rit, on pleure, on applaudit. À un moment, une dame se lève et dit simplement : « Merci de nous avoir rendu notre dignité. » Silence dans la salle. Moi, devant mon écran, j’avais la gorge nouée.
- Des images d’archives inédites tournées par un ado de 15 ans
- Les retrouvailles avec les témoins directs de la visite de 2005
- Le portrait d’une génération qui a grandi avec une étiquette collée sur le dos
- Une réflexion sur l’évolution (ou pas) du regard porté sur les quartiers populaires
- Un message d’espoir : oui, on peut s’en sortir, même quand tout semble contre vous
Ce que le film nous dit sur la France d’aujourd’hui
Regarder ce documentaire en 2025, c’est se prendre une claque. Parce que vingt ans après, certaines choses ont changé – les immeubles sont rénovés, il y a des caméras partout, des associations, des emplois aidés. Mais d’autres choses n’ont pas bougé d’un millimètre.
On parle encore des quartiers comme de zones de non-droit. On montre encore des images de voitures brûlées dès qu’il y a une bavure policière. On continue de mettre tout le monde dans le même sac. Et pourtant, comme le dit si bien l’un des protagonistes : « On a grandi, on a des enfants, on paye nos impôts, on vote… On est la France, aussi. »
Le plus beau dans ce film, c’est qu’il ne demande pas la pitié. Il demande juste la reconnaissance. Reconnaître que derrière chaque « racaille » supposée, il y a un gamin qui rêvait de devenir footballeur, médecin, journaliste. Et que beaucoup y sont arrivés, malgré tout.
Pourquoi il faut absolument voir ce documentaire
Franchement ? Parce qu’on en a marre des reportages sensationnels qui viennent filmer la misère en hélicoptère avant de repartir. Parce qu’on a besoin de voix qui viennent de l’intérieur. Parce que Djamel Mazi réussit là où tant d’autres échouent : il rend leur humanité à des gens qu’on a déshumanisés pendant des années.
Et puis, il y a cette séquence finale qui reste en tête longtemps. Djamel retourne sur la dalle, seul, au crépuscule. Il pose sa caméra au sol, comme en 2005. Et il filme simplement les gamins d’aujourd’hui qui jouent au foot au même endroit. La boucle est bouclée. La vie continue. Avec ou sans étiquette.
« On n’a jamais été des racailles. On était juste des gosses qui voulaient être vus autrement que comme un problème. »
– Djamel Mazi
Ce film n’est pas seulement l’histoire d’un quartier. C’est l’histoire de toute une génération qui a dû grandir avec une cible dans le dos. Et qui, malgré tout, a choisi de construire plutôt que de détruire.
Alors oui, regardez-le. Pas par curiosité voyeuriste. Mais parce qu’il est temps, vingt ans après, de rendre justice à tous ces « racaille » qui n’en étaient pas.
Et peut-être, qui sait, de reconnaître enfin que la France, la vraie, elle est aussi là-bas. Sur la dalle d’Argenteuil, dans le fast-food du coin, entre deux parties de foot et trois rêves trop grands pour les statistiques.