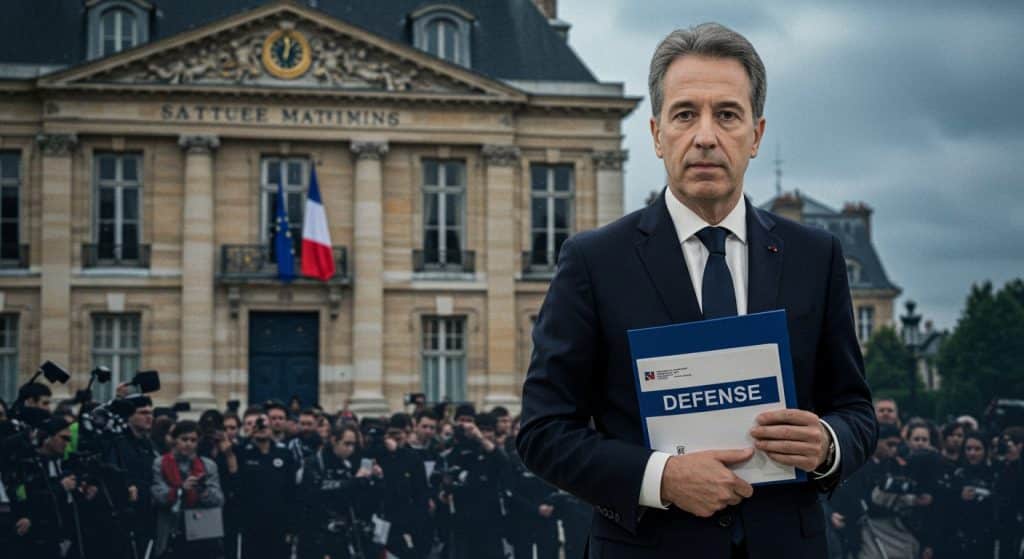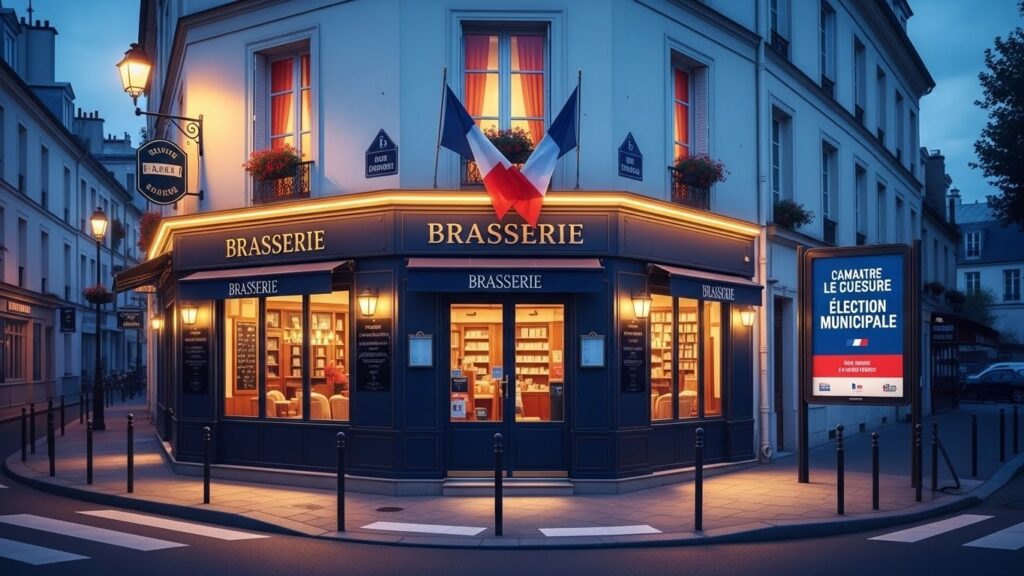Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pousse des millions de personnes à descendre dans la rue, pancartes à la main, pour faire entendre leur voix ? En ce début de septembre 2025, la France s’apprête à vibrer au rythme d’une mobilisation d’envergure dans la fonction publique. Les 10 et 18 septembre, les agents publics, qu’ils soient enseignants, soignants ou employés territoriaux, sont appelés à cesser le travail. Pourquoi ? Pour dire non à l’austérité et défendre des services publics qu’ils jugent menacés. Ce mouvement, porté par la CGT, premier syndicat de la fonction publique, promet de secouer le paysage social. Mais qu’est-ce qui se cache vraiment derrière cet appel à « tout bloquer » ? Plongeons dans les coulisses de cette grève.
Une Mobilisation Historique dans la Fonction Publique
La CGT, fer de lance de ce mouvement, ne fait pas les choses à moitié. Avec près de 5,8 millions d’agents publics concernés, cette grève s’annonce comme un moment clé pour la défense des services publics. Les fédérations de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État se sont unies pour appeler à l’action. Leur objectif ? Lutter contre les politiques d’austérité qui, selon eux, fragilisent les services essentiels comme l’éducation, la santé ou les administrations locales. Mais au-delà des slogans, quelles sont les raisons profondes de cette colère ?
Pourquoi les 10 et 18 Septembre ?
Le choix des dates n’est pas anodin. Le 10 septembre, une mobilisation spontanée, amplifiée par les réseaux sociaux, a reçu le soutien de plusieurs forces politiques de gauche. Cette journée s’inscrit dans une dynamique de contestation large, presque comme un cri de ralliement. Le 18 septembre, quant à lui, coïncide avec un moment politique crucial : un vote de confiance qui pourrait sceller l’avenir du gouvernement. Les syndicats veulent profiter de ce timing pour maximiser l’impact de leur message. En gros, ils disent : « On ne lâchera rien tant que nos revendications ne seront pas entendues. »
Il est temps de tout bloquer pour défendre nos services publics, pilier de notre société.
– Porte-parole syndical
Ce double appel à la grève reflète une stratégie bien pensée. D’un côté, le 10 septembre sert de « galop d’essai », une montée en puissance pour tester la mobilisation. De l’autre, le 18 septembre vise à frapper fort, en pleine actualité politique. Mais tous les syndicats suivent-ils le même tempo ? Pas vraiment, et c’est là que les choses deviennent intéressantes.
Les Syndicats Face à la Grève : Unité ou Division ?
Si la CGT fait cavalier seul pour le 10 septembre, d’autres organisations syndicales, comme Force Ouvrière (FO) et la CFDT, adoptent une approche plus nuancée. FO, par exemple, a confirmé sa participation à la grève du 18 septembre, mais reste encore en réflexion pour le 10. Une hésitation qui montre que la stratégie n’est pas toujours unanime. La CFDT, de son côté, a clairement indiqué qu’elle ne participerait pas à la mobilisation du 10 septembre, préférant se concentrer sur la seconde date. Pourquoi ce décalage ?
Pour la CFDT, il s’agit d’une question de cohérence avec ses priorités nationales. Une représentante syndicale a expliqué que l’organisation voulait éviter de disperser ses forces et se focaliser sur une mobilisation massive le 18 septembre. Cette divergence illustre bien les tensions qui peuvent exister entre syndicats, même lorsqu’ils partagent un objectif commun : protéger les services publics.
- CGT : Appelle à la grève les 10 et 18 septembre, avec un discours radical.
- FO : Participe au 18 septembre, décision en attente pour le 10.
- CFDT : Absente le 10, mais pleinement mobilisée le 18.
Cette diversité d’approches pourrait-elle affaiblir le mouvement ? Pas forcément. Selon certains observateurs, cette pluralité reflète la richesse du dialogue social en France. Mais elle pose aussi une question : jusqu’où les syndicats sont-ils prêts à aller pour faire plier le gouvernement ?
Les Enjeux de la Grève : Plus qu’une Simple Protestation
Derrière l’appel à la grève, il y a des enjeux concrets qui touchent directement les 5,8 millions d’agents publics. La fonction publique, c’est un mastodonte qui regroupe trois grands secteurs : l’État (2,5 millions d’agents), l’hospitalier (1,9 million) et le territorial (1,3 million). Chacun de ces secteurs fait face à des défis spécifiques, mais un mot revient sans cesse : austérité. Les syndicats dénoncent des budgets en berne, des conditions de travail dégradées et une menace sur la qualité des services rendus aux citoyens.
Prenez l’exemple des hôpitaux. Depuis des années, les soignants alertent sur le manque de moyens, de personnel et de lits. Dans les écoles, les enseignants pointent du doigt des classes surchargées et des salaires qui ne suivent pas l’inflation. Quant aux agents territoriaux, ils doivent souvent jongler avec des missions toujours plus nombreuses pour des ressources en baisse. Cette grève, c’est leur façon de dire : « Assez, c’est assez. »
| Secteur | Effectifs | Principaux enjeux |
| Fonction publique d’État | 2,5 millions | Salaires, conditions de travail, effectifs |
| Fonction publique hospitalière | 1,9 million | Manque de moyens, épuisement du personnel |
| Fonction publique territoriale | 1,3 million | Budgets réduits, missions accrues |
Ce tableau, c’est un peu le thermomètre de la grogne sociale. Chaque ligne raconte une histoire de frustration, mais aussi d’espoir. Car au fond, ce que veulent les grévistes, c’est un avenir où les services publics restent un pilier solide de la société française.
Un Boycott du Dialogue Social : Une Tactique Risquée ?
En parallèle de la grève, la CGT a décidé de boycotter les instances de dialogue social avec l’administration. Une décision qui fait grincer des dents. D’un côté, elle montre une volonté de rupture avec un système jugé inefficace. De l’autre, elle pourrait compliquer les négociations à long terme. J’ai toujours trouvé que le dialogue social, même imparfait, reste un outil précieux pour faire avancer les choses. Mais quand les syndicats estiment qu’on ne les écoute pas, difficile de leur reprocher de hausser le ton.
Le boycott est un signal fort : nous ne jouerons plus le jeu d’un dialogue qui ne mène nulle part.
– Représentant syndical
Ce choix tactique divise. Certains y voient un moyen de pression efficace, d’autres une posture qui risque d’isoler les syndicats. Une chose est sûre : il met en lumière un ras-le-bol profond face à des années de réformes perçues comme déconnectées des réalités du terrain.
Quels Impacts pour les Citoyens ?
Quand on parle de grève dans la fonction publique, on pense tout de suite aux perturbations. Écoles fermées, hôpitaux en service minimum, administrations au ralenti… Les 10 et 18 septembre risquent de compliquer la vie de beaucoup de Français. Mais est-ce vraiment juste de pointer du doigt les grévistes ? Après tout, ils défendent des services dont nous bénéficions tous. Les hôpitaux qui sauvent des vies, les écoles qui forment nos enfants, les services municipaux qui font tourner nos villes… Tout ça, c’est leur boulot.
Pourtant, il faut être réaliste : une grève massive, ça secoue. Les transports, par exemple, pourraient être particulièrement touchés, surtout le 18 septembre, où une intersyndicale élargie appelle à l’action. Et si les Français comprennent souvent les revendications, ils peuvent aussi se lasser des perturbations à répétition. C’est un équilibre fragile, et les syndicats le savent.
- Éducation : Risque de fermetures d’écoles, surtout dans le primaire.
- Santé : Services hospitaliers réduits, urgences prioritaires.
- Transports : Perturbations possibles dans les métros, trains et bus.
Pour limiter l’impact, les syndicats insistent sur la nécessité d’un service minimum. Mais dans les faits, c’est souvent compliqué à mettre en place. Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous prêts à soutenir les grévistes, même si ça bouleverse votre quotidien ?
Un Contexte Politique Explosif
Impossible de parler de cette grève sans évoquer le contexte politique. En septembre 2025, la France est à un tournant. Le vote de confiance du 18 septembre, qui pourrait faire ou défaire le gouvernement, donne à cette mobilisation une dimension particulière. Les syndicats savent que c’est le moment de faire entendre leur voix, alors que les projecteurs sont braqués sur l’exécutif.
Ce n’est pas juste une question de salaires ou de conditions de travail. C’est aussi une bataille pour l’avenir des services publics. Les grévistes reprochent au gouvernement de privilégier des logiques budgétaires au détriment des besoins des citoyens. Et dans un climat où la gauche politique soutient activement le mouvement, cette grève pourrait devenir un symbole de résistance plus large.
Et Après ? Les Perspectives du Mouvement
Alors, que peut-on attendre des 10 et 18 septembre ? Si la mobilisation prend, elle pourrait marquer un tournant dans le rapport de force entre syndicats et gouvernement. Mais pour que le mouvement porte ses fruits, il faudra une participation massive. Les 5,8 millions d’agents publics représentent une force colossale, mais tout dépendra de leur capacité à se mobiliser ensemble.
J’ai toujours pensé que les grandes grèves, celles qui changent la donne, sont celles qui savent parler à tout le monde. Pas seulement aux agents publics, mais aussi aux citoyens qui dépendent de leurs services. Si la CGT et ses alliés parviennent à rallier l’opinion publique, ils pourraient obtenir des avancées concrètes. Mais le chemin est encore long, et les défis nombreux.
Les services publics, c’est le cœur de notre modèle social. Les défendre, c’est défendre l’avenir.
– Observateur du mouvement social
En attendant, une chose est sûre : les 10 et 18 septembre 2025 resteront dans les mémoires comme des dates où la France a retenu son souffle. Entre colère, espoir et détermination, les agents publics sont prêts à se faire entendre. Et vous, serez-vous dans la rue à leurs côtés ?