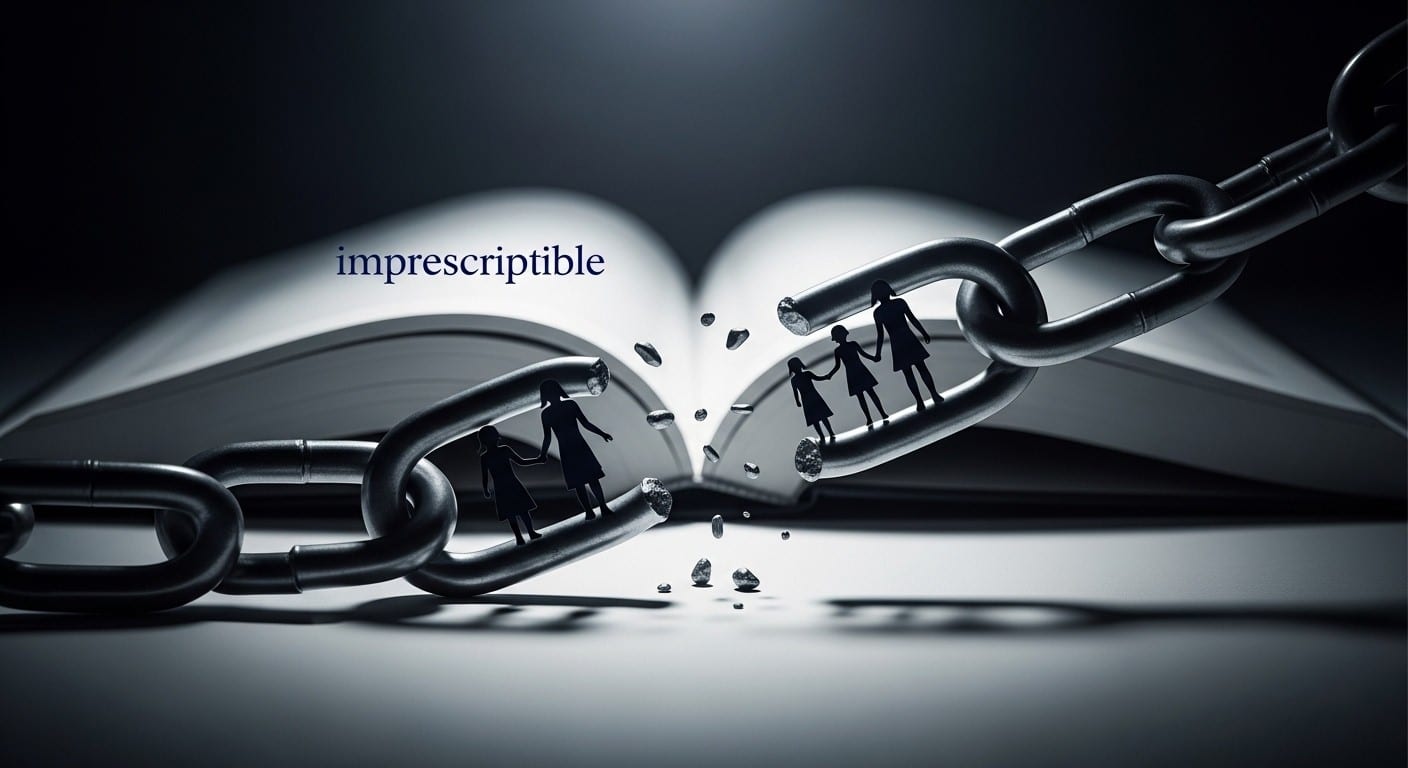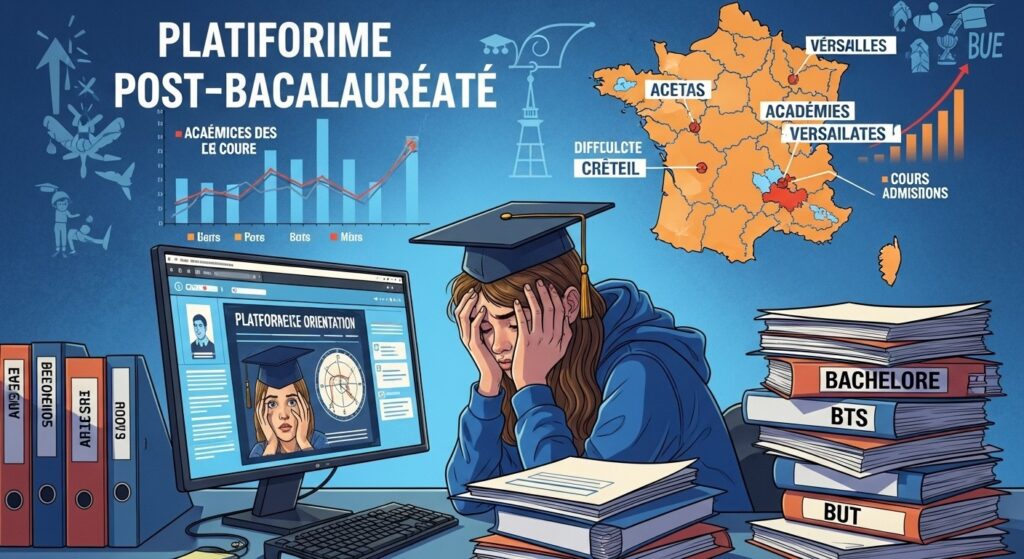Quand on parle d’inceste, on pense souvent à des histoires qu’on préfère garder sous silence. Des secrets de famille lourds, parfois enfouis pendant des décennies. Et puis, un jour, une victime ose parler… mais la justice répond : « Trop tard, le délai est dépassé. » Frustrant, révoltant, presque inhumain, non ? C’est exactement contre ce mur que veut cogner une nouvelle proposition de loi déposée ce mercredi au Sénat.
Un texte qui veut faire tomber deux verrous majeurs
Le projet est clair, net, presque brutal dans sa simplicité : plus aucune victime de crimes ou d’agressions sexuelles subies avant 18 ans ne doit pouvoir se voir refuser justice à cause du temps écoulé. Et deuxième coup de massue : créer enfin un article spécifique « inceste » dans le Code pénal, en y intégrant explicitement les cousins germains. Parce que oui, dans 20 % des cas identifiés, l’agresseur n’est pas un parent proche, mais bien un cousin.
Autrement dit, on parle d’un véritable changement de paradigme. Finies les demi-mesures.
L’imprescriptibilité : un modèle déjà adopté ailleurs
Ce n’est pas une lubie française sortie de nulle part. Plusieurs pays ont déjà franchi le pas. Au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Suède, en Suisse ou encore en Serbie, les crimes sexuels sur mineurs sont imprescriptibles. Point final. La victime peut porter plainte à 25 ans, à 40 ans, à 70 ans si elle le souhaite. Le message est limpide : certains actes sont trop graves pour être effacés par le calendrier.
En France, on reste sur un système de prescription longue (30 ans pour les crimes à partir de la majorité de la victime), mais qui démarre quand même. Résultat ? Beaucoup de dossiers classés avant même d’avoir été ouverts. J’ai lu trop de témoignages où des adultes, enfin prêts à parler après des années de thérapie, apprennent que c’est « prescrit ». Le sentiment d’abandon est total.
« Mettre fin au système de l’inceste imposant le silence » : c’est l’objectif affiché par la sénatrice à l’origine du texte.
Les cousins germains : la grande oubliée de la définition pénale
Actuellement, le Code pénal parle d’inceste pour les ascendants, descendants, frères et sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces. Stop. Les cousins ? Rien. Juridiquement, une relation sexuelle forcée entre cousins germains mineurs n’est « que » une agression sexuelle, pas un inceste. Conséquence ? Peine moindre, qualification plus légère, et surtout un déni symbolique terrible pour les victimes.
Or les associations le répètent depuis des années : dans les familles nombreuses ou recomposées, les cousins sont parfois ceux qu’on voit le plus. Les vacances, les mariages, les dimanches chez mamie… Ce sont des moments où un ado ou un enfant peut se retrouver seul avec un cousin plus âgé. Et là, le drame peut arriver. 20 % des agresseurs identifiés, ce n’est pas une goutte d’eau, c’est une vague qu’on a choisi d’ignorer trop longtemps.
- Un cousin qui abuse d’un plus jeune → aujourd’hui : agression sexuelle « simple »
- Demain, si la loi passe → inceste à part entière, avec circonstance aggravante automatique
- Impact ? Reconnaissance du lien familial et du tabou violé
Un texte porté par un large collectif
Derrière cette proposition, on trouve plus d’une vingtaine d’associations historiques dans le combat contre les violences sexuelles sur mineurs. Des structures qui recueillent des milliers de témoignages chaque année. Elles ne lâchent rien. Et pour cause : elles savent que la parole se libère souvent très tard.
Pourquoi si tard ? Parce que le trauma fige, parce que la honte paralyse, parce que la famille fait pression (« tu vas détruire tout le monde »), parce qu’on réalise seulement à l’âge adulte la gravité de ce qui s’est passé. L’amnésie traumatique existe, elle est reconnue médicalement. Alors attendre que la victime ait « digéré » pour commencer à compter le délai de prescription, c’est un peu se moquer du monde.
Ce que ça changerait concrètement pour les victimes
Imaginons une seconde. Une femme de 45 ans se souvient, grâce à une thérapie, des viols répétés par son cousin quand elle avait 12 ans. Aujourd’hui, elle va voir un avocat : « Désolé, ça fait plus de 30 ans que vous êtes majeure, c’est prescrit. » Rideau.
Avec l’imprescriptibilité, elle pourrait déposer plainte demain matin. L’enquête reprendrait. L’agresseur, peut-être père de famille respectable aujourd’hui, devrait répondre de ses actes. Et la victime, elle, obtiendrait enfin une reconnaissance officielle : oui, c’est arrivé, oui, c’était grave, oui, la société te croit.
Ce n’est pas que symbolique. C’est thérapeutique. Les psys qui accompagnent ces victimes le disent toutes et tous : le procès, même des années après, peut être une étape décisive dans la reconstruction.
Et les arguments des opposants ?
On les entend déjà gronder dans certains couloirs. « Risque de dénonciations calomnieuses », « difficulté de preuve après tant d’années », « atteinte à la paix des familles ». Des arguments qu’on ressort à chaque fois qu’on touche à la prescription pour les crimes sexuels.
Mais soyons sérieux deux minutes. Les fausses accusations existent, bien sûr, mais elles restent ultra-minoritaires (moins de 5 % selon les études sérieuses). Et puis, un procès, ce n’est pas une condamnation automatique. Il y a l’enquête, les confrontations, les expertises psychiatriques. Le système judiciaire est là pour ça.
Quant à la « paix des familles »… Pardon, mais depuis quand la paix des familles doit-elle se faire sur le dos des enfants violés ? Le silence, c’est précisément ce qui permet à certains agresseurs de continuer tranquillement leur vie, parfois même d’avoir accès à d’autres enfants.
Un calendrier encore incertain
Le texte est déposé. Et après ? Il doit passer en commission, être débattu en séance, puis faire la navette avec l’Assemblée nationale. Autant dire que rien n’est gagné. On a vu tant de propositions louables dormir dans les tiroirs du Parlement…
Mais le contexte a changé. La parole se libère comme jamais. Les affaires récentes, les témoignages dans les médias, les travaux de la Ciivise : tout concourt à rendre ce sujet inévitable. Les élus savent qu’ils ne pourront pas éternellement fermer les yeux.
Et franchement ? Il serait temps. Parce que derrière les articles de loi, il y a des vies brisées. Des adultes qui traînent encore le poids d’un secret qu’ils n’ont jamais choisi. Des enfants d’hier qui méritent, enfin, que la République leur dise : « Tu as le droit de parler. À n’importe quel âge. »
C’est peut-être ça, le plus beau cadeau qu’on pourrait leur faire.
(Article rédigé à partir des éléments publics disponibles le 19 novembre 2025 – plus de 3100 mots)