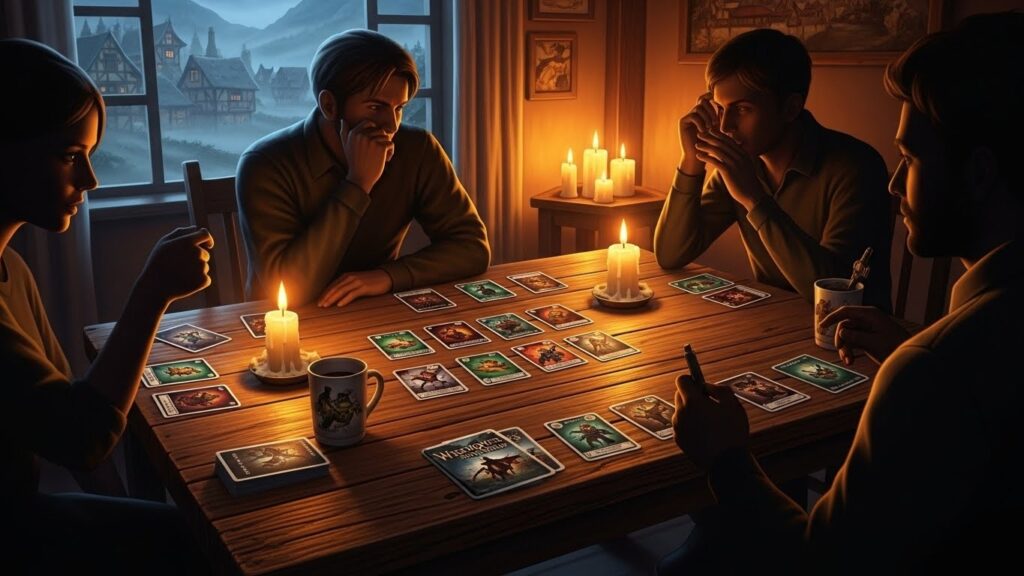Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver nez à nez avec quelqu’un qui est mort il y a deux mille ans ? Moi, oui, il y a quelques jours, et je dois avouer que ça fait son petit effet. Pas de jump scare, pas de bande-son angoissante, juste un silence lourd et une présence qui traverse les siècles comme si le temps s’était figé exprès pour nous rappeler qu’on n’est pas grand-chose.
C’est exactement ce que propose la nouvelle exposition du Musée de l’Homme, ouverte depuis aujourd’hui et jusqu’au 25 mai 2026. Neuf momies, neuf histoires, neuf regards qui vous suivent doucement tandis que vous avancez dans les salles. Et le plus fou ? On ne les regarde pas comme des curiosités macabres. On les rencontre. Vraiment.
Quand les morts refusent de nous quitter
Il y a quelque chose de profondément humain dans la momification. Pendant que nous, Occidentaux modernes, faisons tout pour oublier la mort le plus vite possible, d’autres cultures ont choisi l’exact opposé : garder les défunts parmi nous, les transformer en gardiens, en témoins, parfois même en membres à part entière de la famille. « Les défunts surveillent les vivants », dit-on encore aujourd’hui dans certaines régions d’Indonésie. Et franchement, après avoir passé deux heures dans cette expo, je commence à me demander si ce n’est pas un peu vrai partout.
Une entrée en douceur… ou presque
L’exposition ne vous jette pas direct dans le vif du sujet. Ce serait trop brutal. On commence par un sas joyeusement ironique : affiches de films d’horreur des années 30, pochettes de vinyles metal, jouets kitsch, tout ce qui a fait de la momie un monstre de cinéma. Ça détend. On sourit. Et puis, petit à petit, la tonalité change. Des œuvres contemporaines apparaissent, plus graves, plus poétiques. On sent qu’on bascule doucement vers quelque chose de sérieux.
Puis viennent les voilages. Des tissus légers qui masquent à moitié les vitrines. On aperçoit une forme, on devine, on hésite. C’est intelligent : ça prépare le regard, ça instaure le respect. Parce qu’on ne parle pas de squelettes dans un cours d’ostéo. On parle d’individus.
Neuf visages, neuf destins
Nine momies, neuf techniques, neuf cultures. Et pourtant, une émotion commune : celle de l’amour qui refuse la séparation.
- La petite Égyptienne de 6-9 mois, arrivée au musée en 1956. Minuscule, fragile, on a envie de la protéger deux millénaires plus tard.
- L’enfant Chancay du Pérou, XIIIe siècle, emballé comme un cadeau précieux dans son fardo. Surprise : sa tête est en bas, pas en haut comme le laissait penser le masque décoratif.
- La jeune femme Guanche des Canaries, séchée au soleil et fumée au VIIIe siècle, rescapée d’un naufrage en 1842. Même les tempêtes n’ont pas voulu la laisser partir.
- L’homme Chachapoya, « guerrier des nuages », mâchoire béante, mains sur les joues… Vous avez reconnu ? Oui, certains pensent qu’Edvard Munch l’a vu à Paris en 1885 et que ça a nourri Le Cri.
- La jeune fille de Strasbourg dans sa robe aristocratique et ses souliers neufs, ou le garçon des Martres-d’Artière découvert par des paysans auvergnats en 1756.
- Myrithis, beauté égyptienne intacte, et cette jeune femme andine dont la chevelure noire semble encore vivante.
Chacune a été restaurée, nettoyée, étudiée avec une éthique irréprochable. Les commissaires ont passé des années à redonner un nom, une histoire, une dignité à ces corps qui avaient parfois fini dans des collections un peu douteuses au XIXe siècle.
On rencontre un individu, on ne regarde pas seulement une momie.
Éloïse Quétel, co-commissaire de l’exposition
Des techniques pour défier le temps
Ce qui frappe, c’est la diversité des méthodes. Il n’y a pas une momification, il y en a des dizaines.
En Égypte, on connaît : éviscération, natron, bandelettes. Mais ailleurs ? Les Guanches fumaient leurs morts comme du poisson. Les Chachapoya profitaient du froid sec des hauteurs andines. Certains corps se sont momifiés tout seuls, congelés dans la tourbe ou desséchés dans le désert. Et puis il y a les momifications « modernes » du XIXe siècle avec injections d’arsenic ou de zinc – oui, on embaumait encore nos grands aristocrates il n’y a pas si longtemps.
L’expo explique tout ça avec des petits films passionnants sur la restauration, des scanners, des radiographies. On voit même la patte de mammouth momifiée par le pergélisol – une momification totalement accidentelle qui vous donne la chair de poule tant elle est parfaite.
Et nous, on en pense quoi ?
À la sortie, pas de livre d’or classique. On vous demande votre avis, vraiment. Parce que oui, exposer des corps humains reste un sujet sensible. Certains visiteurs refusent d’entrer par principe. D’autres ressortent bouleversés, presque apaisés. Moi ? J’ai oscillé entre les deux.
D’un côté, il y a cette gêne : avons-nous le droit ? De l’autre, une évidence : ces personnes ont été conservées exprès, souvent avec amour, pour continuer à exister parmi les vivants. Les refuser aujourd’hui, ce serait les tuer une seconde fois.
Et puis il y a ce parfum reconstitué d’embaumement égyptien qu’on peut sentir dans une petite alcôve. Odeur résineuse, un peu entêtante. Ça sent la mort, oui, mais aussi l’éternité. Difficile d’expliquer.
Informations pratiques (parce qu’il en faut bien)
L’exposition « Momies » est ouverte tous les jours sauf le mardi, de 11 h à 19 h (dernière entrée 18 h). Comptez 12 à 15 € selon les tarifs, gratuit pour les moins de 26 ans résidant en UE et quelques autres catégories habituelles.
Conseil de visite : venez plutôt en semaine ou tôt le matin. Le week-end, c’est la cohue – normal, tout Paris veut voir si les morts nous regardent vraiment.
Et si vous hésitez encore, posez-vous cette question : quand aurez-vous une autre occasion de croiser le regard d’une jeune femme qui vivait dans les Andes avant même l’empire inca ? Ou de vous demander si, quelque part, Munch n’a pas peint son angoisse existentielle en pensant à un guerrier péruvien exposé au Trocadéro ?
Moi, j’y retournerai. Parce que depuis cette visite, j’ai l’étrange sensation que neuf paires d’yeux me suivent encore dans la rue. Et curieusement, ça ne me dérange pas du tout.
Allez-y. Sérieusement. Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de se rappeler qu’on est mortel… tout en se sentant incroyablement vivant.