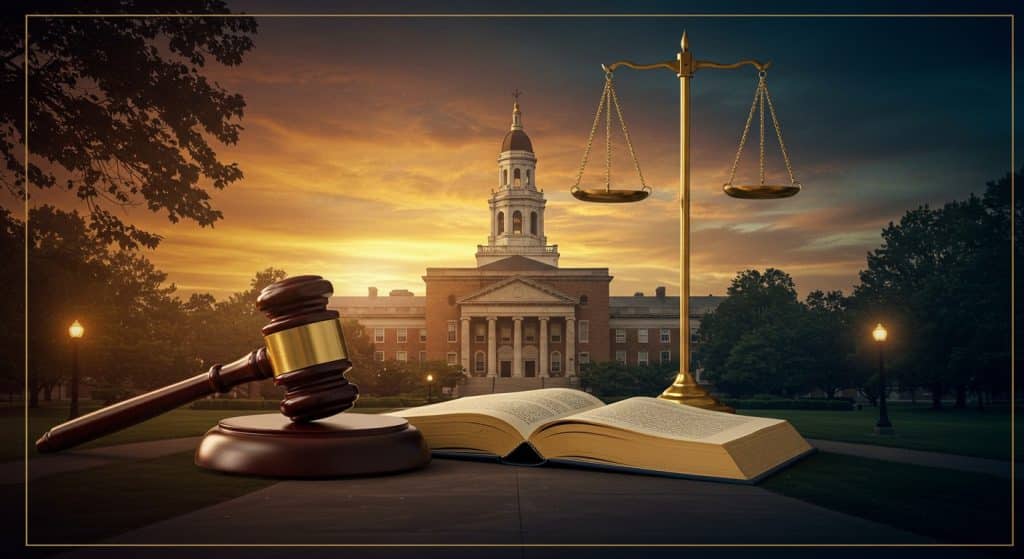Imaginez la scène un instant. Un type que l’on présente comme l’un des cent détenus les plus dangereux du pays, enfermé dans l’une des prisons les plus sécurisées de France, reçoit l’autorisation de sortir quelques heures… pour aller chercher du travail. Vous vous frottez les yeux ? Pourtant, c’est exactement ce qui vient de se produire. Et franchement, ça laisse pantois.
Je ne vais pas tourner autour du pot : cette affaire sent la poudre. Elle met en lumière, une fois de plus, le gouffre qui peut exister entre la réalité du terrain pénitentiaire et certaines décisions judiciaires. Alors prenons le temps de décortiquer tout ça calmement, parce qu’il y a beaucoup à dire.
Une décision qui défie l’entendement
Dans le nord de la France, la prison de Vendin-le-Vieil n’est pas n’importe quel établissement. Ouverte il y a quelques mois seulement, elle accueille le tout premier quartier de lutte contre la criminalité organisée – le fameux QLCO – du pays. Un endroit pensé pour couper totalement les ponts entre les gros bonnets du crime et le monde extérieur. On y trouve des profils très lourds, du narcotrafic au terrorisme.
Et voilà qu’un de ces pensionnaires, impliqué jusqu’au cou dans le narcotrafic international, se voit accorder une permission de sortie. Pas pour un drame familial, pas pour un enterrement. Non : officiellement, pour trouver un emploi. Quand on sait le niveau de dangerosité requis pour atterrir dans ce quartier, on a du mal à y croire.
Le plus stupéfiant ? Tout le monde était contre. Le directeur de l’établissement, le parquet local, le parquet général… Tous ont donné un avis défavorable. La chambre d’application des peines a balayé ces recommandations d’un revers de main. Et hop, le détenu a pu franchir les portes vendredi matin.
Cette décision est totalement déconnectée des exigences et des contraintes que nous vivons au quotidien.
Un syndicat de surveillants pénitentiaires
Le QLCO, c’était pourtant la réponse forte
Revenons un peu en arrière. L’ouverture du QLCO de Vendin-le-Vieil avait été présentée comme une petite révolution. Inspiré du régime italien anti-mafia – le fameux 41 bis –, ce dispositif devait permettre d’isoler complètement les têtes pensantes de la criminalité organisée. Plus de téléphone, plus de visites prolongées, fouilles intégrales, surveillance renforcée 24h/24.
L’idée était claire : empêcher ces individus de continuer à diriger leurs réseaux depuis leur cellule. On se souvient tous des affaires où des parrains donnaient encore des ordres depuis l’intérieur. Le ministre de la Justice avait même chiffré à environ 500 le nombre de détenus considérés comme particulièrement dangereux dans les prisons françaises. Le QLCO devait être la réponse musclée.
Et là, patatras. Quelques mois à peine après l’ouverture, une décision judiciaire vient remettre en question tout le dispositif. Comment expliquer à un surveillant qui risque sa peau tous les jours qu’un détenu placé sous ce régime ultra-strict peut sortir faire un tour en ville ? C’est l’incompréhension totale.
Le motif officiel : la recherche d’emploi
Officiellement donc, cette permission visait à permettre au détenu de trouver un travail. Sur le papier, on peut comprendre la logique : la réinsertion reste un objectif constitutionnel du système pénitentiaire français. Un emploi, c’est censé être un facteur de stabilité, une preuve de bonne volonté.
Mais soyons sérieux deux minutes. Quand on parle d’un individu classé parmi les cent plus dangereux du pays, avec un passé dans le narcotrafic international, est-ce vraiment le moment de jouer la carte de la confiance ? Le risque d’une reprise de contact avec d’anciens complices est énorme. Et même si tout se passe bien, le message envoyé est désastreux.
- Un détenu sous régime renforcé sort librement
- Les avis négatifs de tous les acteurs de terrain sont ignorés
- Le motif paraît dérisoire au regard du profil
- Le personnel pénitentiaire se sent méprisé
Le syndicat UFAP-UNSa Justice ne mâche pas ses mots : cette sortie « décrédibilise complètement le régime QLCO ». Et on les comprend.
Un système à deux vitesses ?
Ce qui choque particulièrement, c’est le sentiment d’une justice à géométrie variable. D’un côté, on crée des quartiers ultra-sécurisés, on communique à grand renfort de médias sur la fermeté nouvelle de l’État face au narcotrafic. De l’autre, une chambre d’application des peines accorde une permission qui semble contredire tout cela.
J’ai discuté avec plusieurs personnes du milieu pénitentiaire ces derniers jours (anonymement, bien sûr). Le sentiment dominant ? L’abattement. « On nous demande de tenir un régime de fer, et derrière, on ouvre les portes », me confiait l’un d’eux. Un autre parlait carrément de « suicide institutionnel ».
Et il y a de quoi se poser des questions. Comment justifier auprès de l’opinion publique qu’un individu présenté comme un danger majeur puisse se balader quelques heures en ville ? Le risque zéro n’existe pas, tout le monde le sait. Mais là, on a l’impression de jouer à la roulette russe avec la sécurité collective.
La réinsertion, oui… mais à quel prix ?
Attention, je ne suis pas en train de dire qu’il ne faut jamais accorder de permissions. La réinsertion, c’est important. Des milliers de détenus de droit commun en bénéficient chaque année et ça fonctionne plutôt bien quand le profil s’y prête.
Mais il y a une différence énorme entre un petit délinquant qui a commis une bêtise et un acteur majeur du narcotrafic international. Le premier a souvent tout à gagner à couper les ponts. Le second a un réseau, de l’argent, des contacts. Le risque de récidive ou de reprise en main du trafic est infiniment plus élevé.
L’équilibre est difficile à trouver, je le reconnais. D’un côté, on ne peut pas garder quelqu’un indéfiniment en isolement total sans perspective. De l’autre, on ne peut pas faire comme s’il était un détenu lambda. Peut-être que la solution passe par des permissions ultra-encadrées, sous escorte renforcée, dans des conditions qui ne laissent aucune place au doute.
Et maintenant ?
Cette affaire ne va pas s’arrêter là. Les syndicats pénitentiaires ont déjà promis de monter au créneau. On parle de possibles recours, de questions écrites au ministère, voire d’une mobilisation plus large. Car au-delà du cas individuel, c’est toute la crédibilité du dispositif QLCO qui est en jeu.
Si dès les premiers mois, on accorde des sorties à des détenus placés là précisément pour leur dangerosité, alors à quoi bon tout ce barnum sécuritaire ? Autant fermer la boutique et revenir au régime classique.
Personnellement, je pense qu’on touche là à un vrai débat de société. Jusqu’où peut-on aller dans la fermeté quand on parle de criminalité organisée ? Et jusqu’où doit-on préserver les droits individuels, même pour les profils les plus lourds ? Il n’y a pas de réponse simple. Mais une chose est sûre : ignorer systématiquement l’avis des gens qui sont sur le terrain tous les jours, ça ne peut pas fonctionner.
Au moment où j’écris ces lignes, le détenu est rentré à la prison après sa permission. Sans incident, paraît-il. Tant mieux. Mais le malaise, lui, est toujours là. Et il risque de durer longtemps.
Ce genre d’histoire nous rappelle que derrière les grands discours sur la sécurité et la lutte contre le narcotrafic, il y a une réalité bien plus complexe. Une réalité faite de décisions humaines, parfois difficiles à comprendre pour le commun des mortels. Reste à espérer que cette affaire serve au moins à ouvrir un vrai débat sur la gestion des détenus les plus dangereux. Parce que là, franchement, on a un peu l’impression de marcher sur la tête.