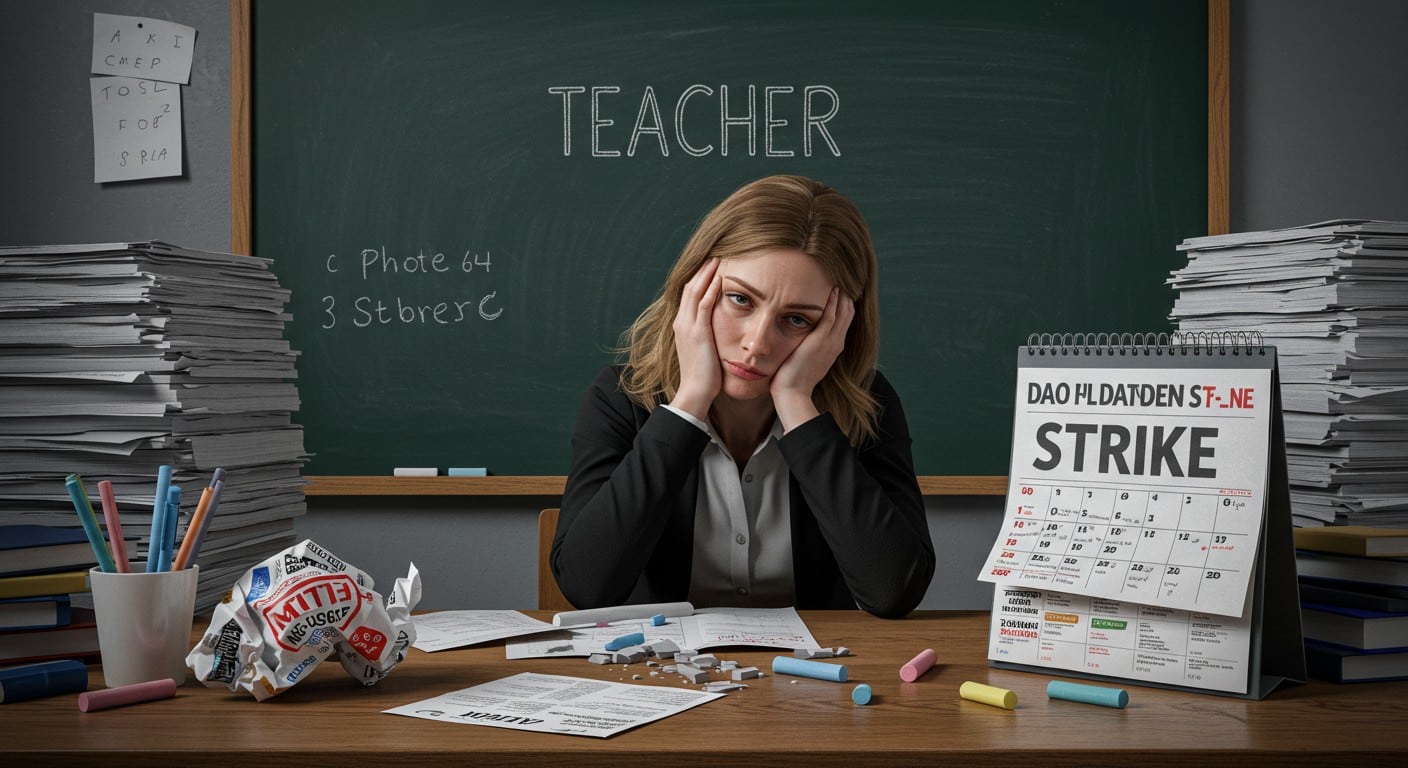Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vu une marée d’enseignants défiler dans les rues, pancartes à la main, clamant leur colère ? Moi, j’ai beau fouiller ma mémoire, les images de ces grandes mobilisations semblent s’effacer, comme une vieille photo qui jaunit. Pourtant, la grogne est toujours là, tapie dans les salles des profs, dans les échanges à voix basse entre collègues épuisés. Alors, pourquoi les enseignants, autrefois fer de lance des mouvements sociaux, semblent-ils avoir rangé leurs banderoles ? C’est ce que nous allons explorer, en plongeant dans un malaise profond, entre résignation, revendications floues et un sentiment d’impuissance qui gagne du terrain.
Un Désengagement qui Cache une Colère Intacte
Les enseignants ne sont pas du genre à rester silencieux. Historiquement, ils ont toujours été en première ligne pour défendre leurs conditions de travail, leurs salaires ou l’avenir de l’école publique. Mais aujourd’hui, quelque chose a changé. Les appels à la grève, lancés par les syndicats, peinent à mobiliser. À peine 10 % des enseignants du primaire pourraient faire grève lors des prochaines journées d’action, selon les estimations syndicales. Pourquoi ce désintérêt ? Est-ce que la flamme s’est éteinte, ou est-elle simplement étouffée par un système qui semble ignorer leurs cris ?
Des Revendications Trop Floues pour Rassembler
Imaginez-vous recevoir un énième mail syndical, listant une dizaine de raisons de faire grève : salaires trop bas, manque de moyens, inclusion scolaire mal gérée, mal-être au travail… Tout est mélangé, comme une soupe indigeste. C’est ce que ressentent beaucoup d’enseignants. Une professeure de maternelle, qu’on appellera Claire, me confiait récemment : « Les appels à la grève, c’est toujours tout et n’importe quoi. On dirait qu’ils veulent cocher toutes les cases sans vraiment viser juste. »
« Les syndicats nous parlent de tout, mais jamais d’un sujet précis qui nous touche au cœur. Moi, ce qui me pèse, c’est l’inclusion scolaire imposée sans moyens. Pourquoi pas une grève là-dessus ? »
– Une enseignante du primaire
Ce sentiment est partagé. Les enseignants veulent des combats clairs, des objectifs précis. L’inclusion scolaire, par exemple, est un sujet brûlant : accueillir des élèves à besoins spécifiques sans formation ni moyens adaptés met les profs sous pression. Mais les mots d’ordre syndicaux, souvent trop larges, noient ces préoccupations dans un flot de revendications. Résultat ? Beaucoup jettent l’éponge avant même de commencer.
Le Poids de la Résignation
Il y a quelque chose de terriblement humain dans le fait de baisser les bras. Quand on se bat pendant des années sans voir de résultats concrets, l’espoir s’effrite. Les enseignants, eux, en savent quelque chose. Depuis des décennies, ils enchaînent les réformes, les promesses non tenues et les petites victoires qui ne changent rien au quotidien. Une source syndicale confiait récemment : « On peut obtenir des miettes après un mouvement, mais une vraie victoire, ça fait longtemps qu’on n’en a pas vu. »
Ce sentiment d’impuissance est renforcé par des contraintes bien réelles. Une journée de grève, c’est une journée de salaire en moins. Pour un enseignant débutant, dont le salaire net tourne autour de 1 600 € par mois, c’est un sacrifice qui pèse lourd. « Je ne peux pas me permettre de perdre 80 € pour une manif qui ne changera rien », m’expliquait un jeune prof de collège. Et il n’est pas le seul à faire ce calcul.
- Salaires stagnants : Les enseignants français sont parmi les moins bien payés d’Europe, avec un salaire moyen inférieur de 20 % à celui de leurs homologues allemands.
- Surcharge administrative : Entre les réunions, les évaluations et les mails, le temps pour enseigner s’amenuise.
- Manque de reconnaissance : La profession souffre d’une image dégradée, souvent caricaturée comme « toujours en vacances ».
Ces éléments alimentent un cercle vicieux : moins de mobilisation, moins de visibilité, et donc moins de chances d’obtenir des avancées.
Un Malaise Profondément Ancré
Si les pancartes restent au placard, la colère, elle, est toujours là. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les démissions d’enseignants sont en hausse, tout comme les arrêts maladie et les mi-temps thérapeutiques. En 2024, certaines académies ont rapporté une augmentation de 30 % des démissions dans le premier degré. Ce n’est pas juste une question de salaire. C’est un mal-être global, nourri par des conditions de travail qui se dégradent et un sentiment d’abandon.
J’ai discuté avec un prof de lycée qui, après 15 ans de carrière, envisage de tout plaquer. « On nous demande d’être profs, psychologues, assistants sociaux, tout en jonglant avec des classes surchargées. À un moment, on craque. » Ce témoignage n’est pas isolé. Les enseignants se sentent souvent seuls face à des défis immenses, sans le soutien nécessaire de leur hiérarchie.
| Problème | Impact | Conséquence |
| Surcharge de travail | Épuisement professionnel | Augmentation des arrêts maladie |
| Manque de moyens | Difficulté à gérer l’inclusion | Frustration et sentiment d’échec |
| Faible syndicalisation | Moins de cohésion | Mobilisations moins massives |
Ce tableau, aussi froid soit-il, reflète une réalité brûlante. Les enseignants ne se sentent plus écoutés, et cette déconnexion alimente leur désengagement.
La Fin d’une Culture Collective ?
Il fut un temps où être enseignant, c’était aussi appartenir à une communauté soudée, avec des valeurs partagées et une culture de lutte. Aujourd’hui, cette solidarité semble s’effilocher. La syndicalisation, qui atteignait 45 % dans les années 1990, est tombée sous la barre des 30 %. Pourquoi ? Parce que les enseignants, comme le reste de la société, se replient sur eux-mêmes.
« On est dans une logique de survie. Chacun essaie de sauver sa peau, de tenir jusqu’aux prochaines vacances. La lutte collective, c’est devenu un luxe. »
– Un professeur de collège
Ce repli sur soi n’est pas propre aux enseignants. C’est un miroir de notre époque, où l’individualisme gagne du terrain. Mais dans une profession où la cohésion est essentielle, cette fracture est particulièrement douloureuse. Les enseignants ne se retrouvent plus dans les grandes manifestations, préférant parfois des actions plus discrètes, comme des pétitions ou des discussions en ligne.
Et Si On Changeait de Stratégie ?
Face à ce constat, une question se pose : et si les syndicats repensaient leur approche ? Plutôt que des grèves fourre-tout, pourquoi ne pas cibler des combats précis, comme l’inclusion scolaire ou la revalorisation salariale ? Une mobilisation autour d’un sujet concret pourrait rallumer la flamme. Certains enseignants proposent même des formes d’action alternatives : grèves perlées, journées de désobéissance administrative, ou encore campagnes de sensibilisation auprès des parents.
- Focaliser les revendications : Choisir un thème fort, comme l’inclusion scolaire, pour mobiliser massivement.
- Moderniser les actions : Utiliser les réseaux sociaux pour amplifier le message et toucher un public plus large.
- Impliquer les parents : Créer une alliance avec les familles pour peser davantage dans le débat public.
Personnellement, je trouve l’idée des actions ciblées particulièrement séduisante. Une grève bien pensée, avec un message clair, pourrait réveiller l’élan collectif. Mais pour cela, il faudra surmonter un obstacle de taille : la méfiance envers les syndicats, souvent perçus comme déconnectés des réalités du terrain.
Un Enjeu d’Avenir pour l’École
L’absence de mobilisation ne signifie pas que les enseignants ont baissé les bras pour de bon. Leur silence est un cri étouffé, un mélange de fatigue et de frustration. Si rien ne change, le risque est grand : une école publique affaiblie, des vocations qui s’éteignent, et des élèves qui en pâtissent. Car au bout du compte, ce sont eux, les premiers concernés.
Alors, comment redonner envie aux enseignants de se battre ? Peut-être en leur offrant des victoires, même petites, pour raviver l’espoir. Peut-être en écoutant vraiment leurs préoccupations, sans les noyer dans des revendications trop générales. Une chose est sûre : la colère est toujours là, prête à exploser. Reste à trouver le bon détonateur.
Et vous, que pensez-vous de ce désengagement ? Les enseignants ont-ils raison de rester en retrait, ou est-il temps de reprendre la lutte ? La réponse, comme souvent, se trouve peut-être dans les salles de classe, là où tout commence.