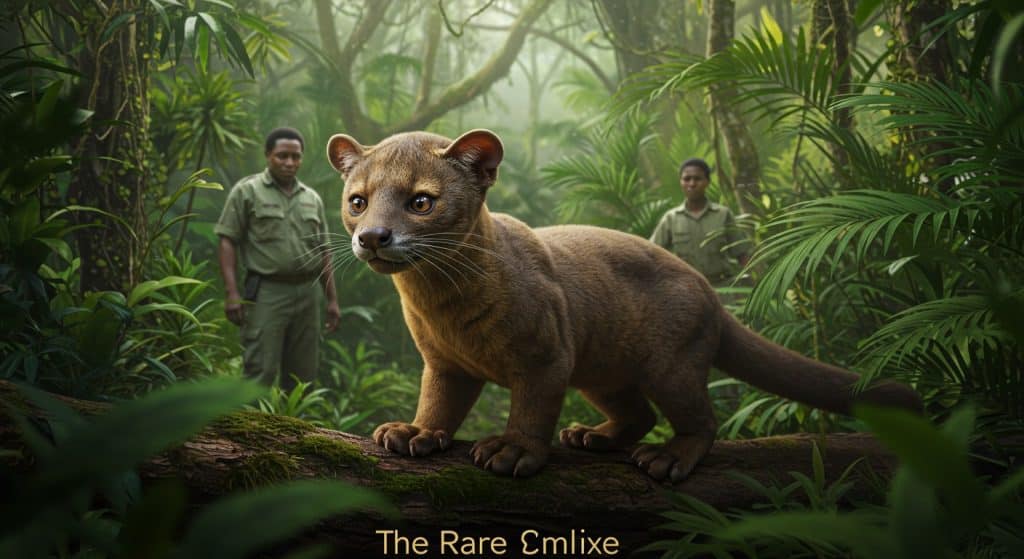Ce matin-là, en grattant mon pare-brise pendant de longues minutes, je me suis surpris à pester : « Bon sang, on n’est qu’en novembre ! » Et puis la phrase de mon grand-père m’est revenue comme un reproche : « De mon temps, on connaissait vraiment le froid. » Il avait raison. À température égale, nous semblons beaucoup plus sensibles qu’il y a quelques décennies. Mais pourquoi ?
Non, le réchauffement climatique n’explique pas tout. Même quand le mercure plonge vraiment, nous grelottons plus vite et plus fort que nos aînés. La réponse est ailleurs, dans un cocktail subtil de changements de mode de vie, d’habitudes vestimentaires, d’alimentation et même d’architecture. Allons voir ça de plus près.
Le grand paradoxe : on n’a jamais été aussi protégés… et jamais aussi fragiles
Paradoxalement, c’est parce que nous sommes mieux protégés du froid que nous le supportons moins bien. Notre corps, comme tout organe vivant, fonctionne sur le principe de l’adaptation : moins on le sollicite, moins il est performant.
1. Le confort thermique permanent nous a désentraînés
Dans les années 1950, la plupart des logements étaient mal isolés. Le chauffage central restait rare, les fenêtres simples vitrages laissaient passer les courants d’air. Résultat ? Dès l’automne, on vivait à 14-16 °C à l’intérieur. Le corps restait en alerte permanente et maintenait actifs tous ses mécanismes de production de chaleur.
Aujourd’hui ? On vit à 21-22 °C toute l’année, été comme hiver. Nos bureaux, nos voitures, nos magasins, tout est chauffé. Dès qu’on sort, le choc thermique est brutal. Le corps, habitué au cocon minute, panique.
« On a créé une génération de serres chaudes humaines », plaisante un médecin du sport que j’ai interrogé récemment.
Et il n’a pas tout à fait tort. Des études montrent que les personnes vivant dans des environnements à température constante ont une tolérance au froid réduite de 30 à 40 % par rapport à celles qui subissent des variations saisonnières marquées.
2. Nous bougeons beaucoup moins
Autre facteur majeur : la sédentarité. En 1950, la majorité des Français avaient des métiers physiques ou marchaient beaucoup. Le simple fait d’aller au travail à pied ou à vélo par tous les temps générait de la chaleur corporelle et entretenait la thermogénèse sans frisson (la capacité des muscles à produire de la chaleur au repos).
Aujourd’hui, on passe 8 à 10 heures assis par jour. Résultat : notre masse musculaire a diminué, or le muscle est notre principal radiateur naturel. Moins de muscle = moins de chaleur produite = sensation de froid plus rapide.
- En 50 ans, la masse musculaire moyenne a chuté de près de 10 % dans les pays développés
- La dépense énergétique quotidienne a baissé de 400 à 600 kcal
- Le métabolisme de base s’est effondré chez les moins de 40 ans
J’ai moi-même constaté ça : quand je passe une journée télétravail bien au chaud, je grelotte dès que je mets le nez dehors. Mais après une semaine de randonnée en montagne, même à 0 °C, je me sens presque à l’aise en simple polaire.
3. Nos vêtements nous protègent… trop bien
Drôle de constat : les vêtements techniques ultra-performants nous rendent paradoxalement plus frileux. Une doudoune en duvet 800 fill power ou une polaire technique nous isole tellement bien qu’on ne ressent presque plus le froid. Du coup, notre corps n’a plus besoin de réagir.
Nos ancêtres, eux, portaient souvent juste un manteau de laine. Le froid pénétrait un peu, suffisamment pour que le corps maintienne ses défenses actives. C’est le même principe que le vaccin : une petite dose d’agression permet de rester immunisé.
Aujourd’hui, on passe directement de 22 °C intérieur à -5 °C dehors en étant surisolé. Le corps n’a pas le temps de s’adapter progressivement et la vasoconstriction (rétrécissement des vaisseaux pour conserver la chaleur) se déclenche trop tard.
4. L’alimentation a changé notre thermostat interne
En 1950, on mangeait plus de graisses animales, de soupes roboratives, de plats mijotés. Ces aliments riches en lipides et lents à digérer maintenaient une chaleur interne durable.
Aujourd’hui ? Salades en hiver, repas légers, grignotage… Notre alimentation est devenue plus « froide ». Moins de calories denses, moins de graisses saturées (même si c’est parfois mieux pour la santé), donc moins de carburant pour le moteur thermique interne.
Et puis il y a le jeûne intermittent, très à la mode. Problème : quand on saute le petit-déjeuner, le corps baisse son métabolisme pour économiser l’énergie… et donc produit moins de chaleur. Résultat : on grelotte toute la matinée.
5. Le stress chronique nous rend frileux
Le stress active le système nerveux sympathique et détourne le sang des extrémités vers les organes vitaux. Résultat : mains et pieds glacés, même à température modérée.
Or, nous vivons dans une société beaucoup plus stressante qu’en 1950 : open spaces, notifications permanentes, pression professionnelle… Nos ancêtres avaient leurs soucis, mais pas cette stimulation constante du cortisol.
« Le stress est un voleur de chaleur », m’a expliqué une thermophysiologiste. « Il fait exactement l’inverse de ce qu’il faut pour se réchauffer. »
6. La graisse brune, cette grande oubliée
Il existe un tissu adipeux spécial, la graisse brune, dont le seul rôle est de brûler des calories pour produire de la chaleur. Chez le nourrisson, elle est très abondante. Chez l’adulte, elle diminue… sauf si on l’entretient.
Comment ? En s’exposant régulièrement au froid modéré. Or, nous faisons exactement l’inverse : dès qu’il fait moins de 18 °C, on monte le thermostat. Résultat : notre graisse brune s’atrophie et nous perdons un allié précieux contre le froid.
Des expériences montrent que dormir dans une chambre à 17-18 °C pendant un mois augmente la quantité de graisse brune de 30 à 40 %. Et devinez quoi ? On a moins froid dans la journée.
Comment retrouver une meilleure tolérance au froid ?
Bonne nouvelle : on peut se réentraîner. Ça prend du temps, mais c’est possible.
- Baisser le chauffage à 19 °C la journée, 17 °C la nuit
- Marcher tous les jours dehors, même quand il fait frisquet
- Prendre des douches tièdes-fin-froides (progressivement)
- Faire du sport en extérieur l’hiver
- Manger chaud et consistant le soir
- Dormir la fenêtre entrouverte
- Éviter de se couvrir trop dès les premiers frimas
Personnellements, depuis que j’ai commencé à appliquer ces principes il y a deux hivers, je supporte beaucoup mieux le froid. L’année dernière, à -8 °C, j’ai marché 45 minutes en simple pull sans grelotter. Mes collègues me prenaient pour un fou… mais j’étais bien.
Alors oui, l’hiver 2025 s’annonce rigoureux. Mais plutôt que de râler, et si on voyait ça comme une occasion de réveiller notre corps endormi ? Après tout, nos grands-parents n’avaient pas le choix. Nous, on l’a. Et c’est peut-être le plus beau des luxes.
Le froid n’est pas notre ennemi. C’est un professeur exigeant qui nous rappelle qu’on est vivants. À nous de réapprendre à l’écouter.