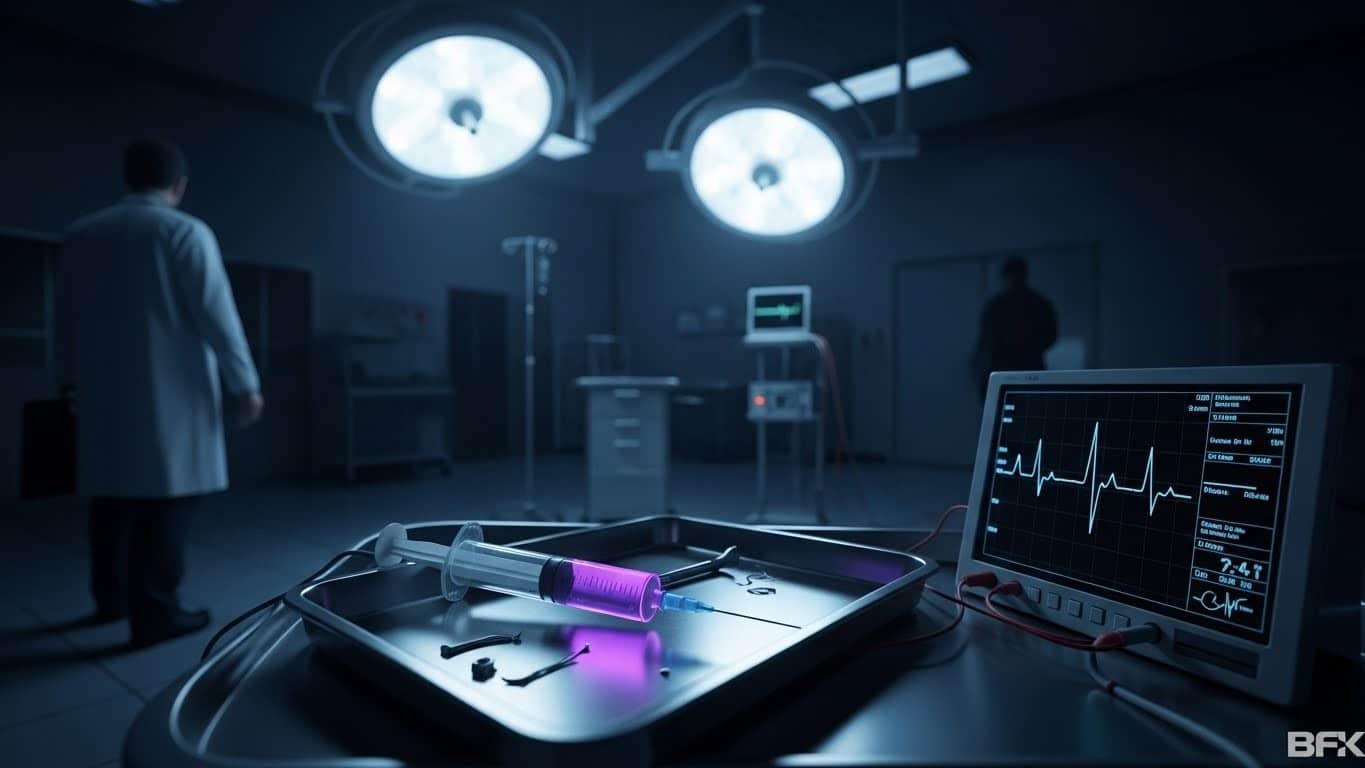Imaginez la scène. Vous êtes en salle d’audience, l’air est lourd, les familles retiennent leur souffle. Et soudain, des applaudissements éclatent. Pas ceux d’un concert ou d’un match, non. Ceux d’une cour d’assises qui vient d’écouter un policier raconter sept années d’enquête sur l’un des dossiers criminels les plus glaçants de ces dernières décennies.
Hier, à Besançon, c’est exactement ce qui s’est passé.
L’anesthésiste et les trente doses mortelles
On parle d’un médecin respecté, spécialiste de l’anesthésie, qui aurait, selon l’accusation, injecté délibérément des substances létales à des patients pour provoquer des arrêts cardiaques. Le but ? Se mettre en valeur en les réanimant ensuite… ou, plus tard, régler des comptes avec des collègues qu’il n’appréciait pas.
Trente cas. Trente vies brisées ou éteintes. Et un homme seul face à la justice.
Des applaudissements qui en disent long
Le moment où la salle a applaudi n’était pas anodin. Le directeur d’enquête, un policier chevronné qui a passé sept ans de sa vie sur ce dossier, venait de terminer sa démonstration sur les deux derniers cas. Une heure vingt de présentation méthodique, froide, implacable.
Et là, spontanément, des mains se sont mises à frapper. Familles de victimes, journalistes, simples citoyens présents… Tout le monde. C’est rare. Très rare. Presque inédit dans une cour d’assises.
« Le tueur en série, si on ne le caractérise pas dans une affaire comme celle-là, il n’existe jamais ! »
Le directeur d’enquête, hier matin
Cette phrase a résonné comme un coup de tonnerre. Parce qu’elle résume tout le défi de cette enquête : prouver l’impensable dans un milieu où l’erreur médicale est courante et où personne ne veut croire qu’un soignant puisse tuer.
Le mobile qui glace le sang : la vengeance
Les premiers cas, au début des années 2010, la thèse privilégiée était celle du narcissisme médical : l’anesthésiste aurait provoqué des crises pour briller en les résolvant. Un peu comme un pompier pyromane.
Mais les derniers dossiers, ceux présentés hier, changent complètement la donne. Là, on ne parle plus de gloire personnelle. On parle de vengeance pure.
Des patients opérés par des chirurgiens ou anesthésistes avec qui l’accusé avait eu des différends graves. Des doses massives de potassium ou de lidocaïne injectées dans les poches de perfusion. Des arrêts cardiaques survenant systématiquement quand l’accusé était dans les parages et pouvait intervenir.
Le schéma est terrifiant de répétition.
- Un conflit avec un collègue →
- Un patient de ce collègue en salle d’op →
- Une substance létale injectée discrètement →
- Crise grave →
- L’accusé arrive « par hasard » et tente la réanimation
Et parfois, le patient ne s’en sort pas.
Un milieu médical sous le choc
Ce qui frappe dans cette affaire, c’est la difficulté à faire émerger la vérité dans l’univers hyper fermé de l’hôpital. Les blouses blanches se protègent, les hiérarchies sont lourdes, et l’idée qu’un médecin puisse tuer délibérément est tout simplement inconcevable pour beaucoup.
Les enquêteurs ont dû affronter ce mur pendant des années. Des plaintes pour faux en écriture, des demandes de dessaisissement, une défense particulièrement agressive… Tout y est passé pour tenter de faire dérailler l’enquête.
Mais ils ont tenu. Et hier, la salle leur a rendu hommage à sa manière.
Pourquoi cette affaire nous fascine autant
Parce qu’elle touche à nos peurs les plus profondes. Celui qui est censé nous sauver peut-il devenir notre bourreau ? L’hôpital, lieu de vie et de mort, peut-il abriter un prédateur ?
J’ai couvert pas mal d’affaires criminelles, mais celle-ci a quelque chose de différent. Une froideur clinique. Une intelligence aiguisée de l’accusé. Le sentiment que le diable se cache parfois derrière un stéthoscope.
Et puis il y a ces familles. Ces proches qui ont vu leur père, leur mère, leur enfant partir en salle d’opération pour une intervention banale et ne jamais en revenir. Ou revenir avec des séquelles irréversibles.
Ils étaient là, hier. Silencieux. Mais leurs regards parlaient pour eux.
Ce que disent les derniers cas présentés
Les deux derniers dossiers sont particulièrement édifiants. Des patients âgés, opérés pour des pathologies courantes. Des doses de potassium totalement incompatibles avec la vie retrouvées dans leur organisme. Et à chaque fois, l’accusé présent dans le bloc ou à proximité immédiate.
Le policier a montré les plannings, les badges d’accès, les vidéos de surveillance (quand elles existaient), les témoignages croisés. Un travail de fourmi.
Et surtout, il a insisté sur le changement de mobile. Passer du besoin de reconnaissance à la vengeance pure, c’est une escalade terrifiante.
Vers un verdict historique ?
Le procès n’est pas terminé. L’accusé continue de clamer son innocence. Sa défense pointe les erreurs médicales possibles, les contaminations croisées, le manque de preuves directes (pas d’empreinte sur une seringue, pas de témoin visuel).
Mais le faisceau d’indices est impressionnant. Et surtout, il y a cette cohérence effrayante dans la répétition des faits.
On saura dans quelques semaines si la cour d’assises retiendra la qualification de tueur en série médical – une première en France.
En attendant, une chose est sûre : cette affaire a déjà changé à jamais notre regard sur ceux qui nous soignent.
Et hier, dans cette salle qui applaudit un policier… C’était peut-être la reconnaissance qu’on peut encore croire en la justice. Même quand elle doit affronter l’inimaginable.
(Article rédigé à partir des débats publics et des éléments révélés à l’audience – aucune diffamation, seulement des faits rapportés et des impressions personnelles de suivi du procès)