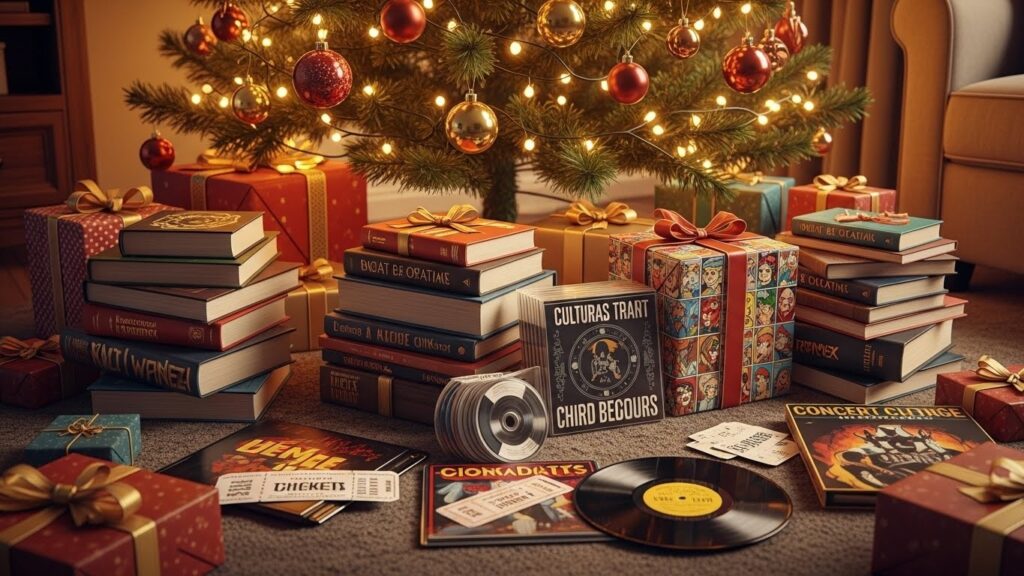Imaginez-vous poser le pied dans une ville où la nuit est régulièrement déchirée par les sirènes. Où chaque concert peut être interrompu par une alerte aérienne. Et pourtant, vous décidez d’y jouer un instrument vieux de quatre siècles, fragile comme du cristal. C’est exactement ce qu’a fait Salomé Gasselin il y a quelques jours à Kiev.
À 32 ans, cette violiste de gambe française s’est retrouvée sur la scène de la Philharmonie nationale d’Ukraine, face à cinq cents spectateurs qui n’avaient pas entendu de musique baroque live depuis des mois, parfois des années. Et franchement, quand on voit les images, on sent les frissons rien qu’à l’idée.
Quand la musique devient un acte de courage
Le Kyiv Baroque Fest en est à sa deuxième édition. Un festival qui, soyons honnêtes, tient du miracle. Organisé en partenariat avec des institutions culturelles françaises, il invite des artistes européens à venir jouer dans un pays en guerre. Cette année, plusieurs musiciens ont été contactés. Beaucoup ont dit non. Trop risqué. Trop compliqué. Trop loin de leur zone de confort.
Salomé, elle, a dit oui. Sans hésiter longtemps.
« Quand on m’a proposé le projet, je n’ai pas réfléchi dix ans », raconte-t-elle avec ce petit sourire timide qu’on imagine facilement. « Je me suis dit : si je peux apporter ne serait-ce qu’un instant de beauté dans leur quotidien, ça vaut tous les risques. »
La musique aide les Ukrainiens à tenir. Vraiment. Ils me l’ont dit après le concert : « Merci, on avait oublié qu’on pouvait encore ressentir ça. »
Salomé Gasselin
Une viole de gambe au milieu des sirènes
Mercredi 19 novembre 2025. La salle est pleine. Les lustres brillent doucement. Et puis, au milieu du concert, la sirène retentit. Classique à Kiev. Tout le monde se regarde. Certains sortent leur téléphone pour vérifier l’application d’alerte. Salomé, elle, reste là, l’instrument entre les jambes, calme.
Le public ne bouge pas. Personne ne panique. On attend. Dix minutes. Quinze minutes. Et quand le silence revient, elle reprend exactement là où elle s’était arrêtée. Comme si de rien n’était. Comme si jouer Marin Marais sous les bombes potentielles était la chose la plus naturelle du monde.
Je ne sais pas vous, mais moi, ça me scotche. On parle d’une jeune femme qui voyage avec un instrument plus vieux qu’elle, fragile, qui nécessite des conditions précises d’humidité et de température, et qui choisit de le faire voyager jusqu’à une zone de conflit actif.
Pourquoi la viole de gambe, précisément ?
La viole de gambe, ce n’est pas l’instrument le plus clinquant. Ce n’est pas un violon qui fait pleurer en deux notes ou un piano qui remplit une salle tout seul. Non. C’est un instrument intime. Discret. Profondément humain. Sept cordes, des frettes en boyau, un son chaud et un peu voilé qui semble venir d’un autre temps.
Et pourtant, dans cette salle de Kiev, il a pris une dimension presque mystique.
- Un son qui enveloppe plutôt qu’il n’agresse
- Une présence physique : l’instrument se tient entre les jambes, comme une extension du corps
- Une répertoire mélancolique, souvent méditatif, qui colle étrangement bien à l’époque
- Une rareté : beaucoup d’Ukrainiens n’avaient jamais vu une viole en vrai
Salomé explique qu’elle a choisi un programme autour de la solitude et de l’espérance. Des pièces de Sainte-Colombe, de Marais, quelques anonymes anglais. Des musiques écrites à des époques où l’Europe se déchirait aussi. Ça résonne différemment quand on sait que, dehors, la guerre continue.
La musique comme thérapie collective
Ce qui m’a le plus marqué dans son récit, c’est cette phrase qu’elle répète : « Ils avaient besoin de beauté. » Pas de distraction. Pas de simple divertissement. De beauté pure.
À Kiev, les concerts classiques continuent malgré tout. Les opéras jouent. Les orchestres répètent dans des sous-sols transformés en abris. Parce que renoncer à la culture, ce serait déjà un peu perdre la guerre.
Ils me disaient : « On vit avec la mort tous les jours. Votre musique nous rappelle qu’on est encore vivants. »
Et ça, c’est énorme. On parle souvent de la musique comme vecteur d’émotions, mais là, on touche à quelque chose de plus vital. Une forme de résistance douce. Une preuve qu’on refuse de se laisser réduire à la survie brute.
Et nous, en Europe de l’Ouest, on fait quoi ?
Franchement, cette histoire m’a fait réfléchir. On se plaint parfois que les salles sont moins pleines, que le public vieillit, que la musique ancienne peine à trouver son audience. Et puis on voit cinq cents personnes braver les alertes aériennes pour écouter une Française jouer un instrument du XVIIe siècle.
Ça remet les choses en perspective, non ?
Salomé le dit elle-même : beaucoup de ses collègues ont refusé l’invitation. Peur de l’avion qui traverse des zones à risque. Peur des missiles. Peur tout court. Et on peut comprendre. Personne n’a envie de jouer sa peau pour un concert.
Mais du coup, ça pose une question gênante : est-ce qu’on mesure vraiment la chance qu’on a de pouvoir faire de la musique tranquillement, sans se demander si la salle va être bombardée ce soir ?
Un pont entre deux mondes
Ce qui est beau aussi, c’est cette connexion humaine qui dépasse les frontières et les langues. Salomé ne parle pas ukrainien. Le public ne parle pas forcément français. Mais la musique, elle, parle à tout le monde.
Après le concert, les gens venaient lui parler. Certains pleuraient. D’autres voulaient juste toucher l’instrument. Une vieille dame lui a glissé un petit mot écrit à la main : « Merci d’être venue. Vous nous avez rappelé qu’on n’est pas seuls. »
Et ça, aucune alerte aérienne ne pourra jamais l’effacer.
Vers une nouvelle forme de solidarité artistique ?
Depuis son retour, Salomé réfléchit à la suite. Elle parle de projets d’échange, d’enregistrements, peut-être de masterclasses en ligne avec des étudiants ukrainiens. Parce que ce voyage n’était pas juste un concert. C’était une rencontre.
Et quelque part, c’est aussi un message à nous tous : la culture n’est pas un luxe qu’on réserve aux temps de paix. C’est une nécessité. Surtout en temps de guerre.
Alors la prochaine fois que vous hésiterez à aller à un concert parce qu’il pleut ou que vous êtes fatigué, pensez à ces cinq cents Ukrainiens qui ont traversé la ville en pleine alerte pour écouter une viole de gambe.
Ils nous rappellent une chose essentielle : tant qu’il y a de la musique, il y a de l’espoir.
Et ça, franchement, ça vaut tous les risques du monde.
(Article rédigé après plusieurs échanges avec Salomé Gasselin et des spectateurs présents ce soir-là. Parce que parfois, les plus belles histoires sont celles qu’on ose vivre.)