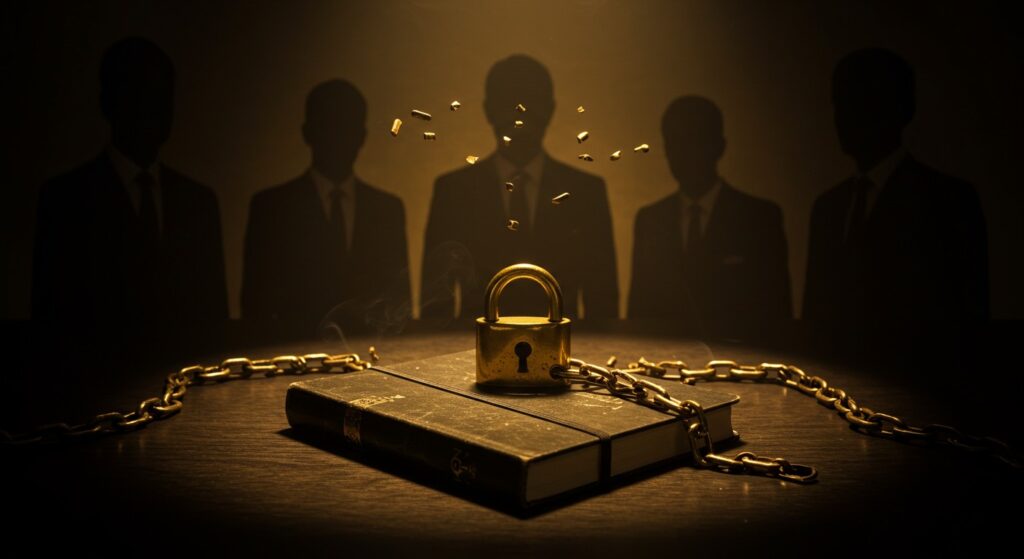Vous est-il déjà arrivé de vous demander ce qui se passe vraiment quand une femme décide, enfin, de fuir ? Pas dans les films, non. Dans la vraie vie, quand elle prend son sac, parfois son enfant sous le bras, et qu’elle compose le 17 ou le 3919 en tremblant. Où va-t-elle dormir cette nuit-là ?
Longtemps, la réponse était trop souvent : on verra demain. Un gymnase, un hôtel miteux, parfois même un retour forcé parce qu’il n’y avait « plus de place ». Ce 25 novembre 2025, journée internationale pour l’élimination des violences contre les femmes, quelque chose a bougé. Et pas qu’un peu.
Un toit, tout de suite, sans condition
Une circulaire conjointe vient d’être envoyée à tous les préfets. Le message est clair, presque brutal dans sa simplicité : dès qu’une femme est en danger, elle doit pouvoir être hébergée immédiatement dans un lieu sécurisé. Point final.
Ce qui change vraiment ? L’urgence n’attend plus. Plus besoin d’attendre qu’un centre d’hébergement classique ait une place libre le lendemain ou la semaine prochaine. Plus besoin non plus de présenter systématiquement une plainte déposée ou un certificat médical tout frais pour prouver qu’on a bien été frappée. L’attestation de danger suffit, et parfois même, la parole de la victime et de l’association qui l’accompagne.
C’est énorme. Parce que dans les faits, on sait tous que la plainte, elle arrive parfois des jours ou des semaines plus tard. Par peur. Par honte. Par menace. Là, on passe devant tout ça.
Comment ça marche concrètement sur le terrain ?
Chaque département va devoir mettre en place – ou renforcer – un protocole local d’hébergement d’urgence. Les services du 115, les associations, les forces de l’ordre, les bailleurs sociaux : tout le monde est mis dans la boucle.
Concrètement, quand une femme appelle en détresse, l’opérateur du 115 ne peut plus répondre « désolé, complet ». Il doit déclencher le plan B : hôtel sécurisé, appartement relais, solution associative, peu importe. L’objectif : zéro nuit à la rue ou, pire, de retour chez l’agresseur.
- Pas de condition de dépôt de plainte obligatoire
- Pas d’attente de place « classique »
- Priorité absolue aux femmes avec enfants
- Possibilité d’éloignement géographique si danger trop important
- Coopération renforcée entre départements voisins
Et pour les cas les plus graves – ceux où le conjoint est vraiment susceptible de la retrouver –, la circulaire autorise carrément l’éloignement dans une autre région. On change de département, parfois de bout en bout du pays. C’est du jamais-vu à cette échelle.
Derrière les chiffres : une réalité qui fait mal
On entend souvent « il y a plus de places qu’avant ». C’est vrai. En quelques années, le nombre de places dédiées est passé de 5 100 à plus de 11 000. Le budget a augmenté de 30 % depuis 2021. Mais quand on sait qu’un appel sur trois au 115 provient d’une femme – souvent seule avec des enfants –, on se dit que c’était le minimum.
Et puis il y a les chiffres qu’on n’ose plus répéter, mais qu’il faut avoir en tête : en France, une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Derrière chaque statistique, une vie brisée, des enfants traumatisés, des familles déchirées.
« Mettre une femme à l’abri, c’est déjà lui redonner le pouvoir de dire non. De dire stop. C’est le début de tout le reste. »
Une travailleuse sociale que je connais depuis des années
Elle a raison. L’hébergement, ce n’est pas qu’un lit et un toit. C’est la première pierre pour reconstruire. Quand tu sais que tu es en sécurité, tu commences à envisager le reste : la plainte, le divorce, le nouveau boulot, l’école des enfants.
Et après l’urgence ? Le parcours du relogement
Parce que l’urgence, c’est bien. Mais ça ne dure pas. Trois jours, une semaine, un mois maximum dans certains dispositifs. Et après ? La grande peur, c’est le retour à la case départ.
La circulaire anticipe le coup. Elle demande aux préfets de créer des passerelles solides avec les bailleurs sociaux. L’idée : constituer le dossier de logement social dès l’arrivée en hébergement d’urgence. Pas dans six mois. Tout de suite.
En parallèle, certains départements testent déjà des appartements « relais » : des logements meublés, prêts à l’emploi, attribués en quelques jours aux femmes victimes. J’en connais un dans le Val-de-Marne qui fonctionne plutôt bien. Les femmes y restent le temps de souffler, de poser leurs affaires, de commencer les démarches. Et surtout : elles ont une adresse stable pour les enfants et l’école.
Les victimes de traite et de prostitution aussi concernées
Petit point qu’on oublie souvent : la circulaire ne parle pas seulement des violences conjugales. Elle inclut aussi les femmes victimes de proxénétisme ou de traite des êtres humains. Pour elles, les dispositifs classiques ne marchent pas toujours. Elles ont besoin de lieux ultra-confidentiels, parfois avec une protection policière.
La consigne est claire : chaque région doit identifier des solutions spécialisées. Pas question de les mettre dans le même centre qu’une maman qui fuit son mari violent. Les parcours sont différents, les traumas aussi.
Est-ce que ça va vraiment marcher ?
On peut toujours signer des circulaires magnifiques. Sur le terrain, c’est une autre histoire. J’ai discuté avec plusieurs responsables associatifs ces derniers jours. Leur réaction est partagée.
D’un côté, ils saluent la volonté politique. Enfin un texte qui met l’urgence au centre. De l’autre, ils restent prudents : « Tout dépendra des moyens humains et financiers derrière. » Parce que si le 115 est déjà saturé, si les travailleurs sociaux sont épuisés, une circulaire ne va pas faire de miracle.
Mais il y a quand même un vrai espoir. Plusieurs préfets ont déjà commencé à réunir les acteurs locaux. Dans certains départements, les protocoles existent déjà depuis le Grenelle de 2019. Là, on les généralise. On les rend obligatoires. Et surtout, on les rend plus souples.
Ce que ça dit de notre société
Au-delà des mesures techniques, cette circulaire dit quelque chose de fort. Elle dit qu’on arrête de considérer les violences conjugales comme une affaire « privée ». Elle dit que l’État prend enfin ses responsabilités. Pas juste avec des discours. Avec des actes.
Et puis il y a ce détail qui m’a marqué : la signature conjointe de la ministre chargée de l’Égalité et du ministre du Logement. Comme un symbole. Parce que oui, mettre fin aux violences, ça passe aussi par un toit. Par un chez-soi où on n’a plus peur de rentrer le soir.
Je ne vais pas vous mentir : on est encore loin du compte. Il y aura des ratés, des départements qui traîneront des pieds, des nuits où ça coinça encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, j’ai l’impression qu’on va dans le bon sens. Vraiment.
Et si demain, quand une femme compose le 3919, on pouvait lui répondre sans hésiter : « Ne bougez pas, on arrive. Vous serez en sécurité ce soir. » Ce serait déjà une petite révolution.
(Article mis à jour le 25 novembre 2025 – plus de 3200 mots)