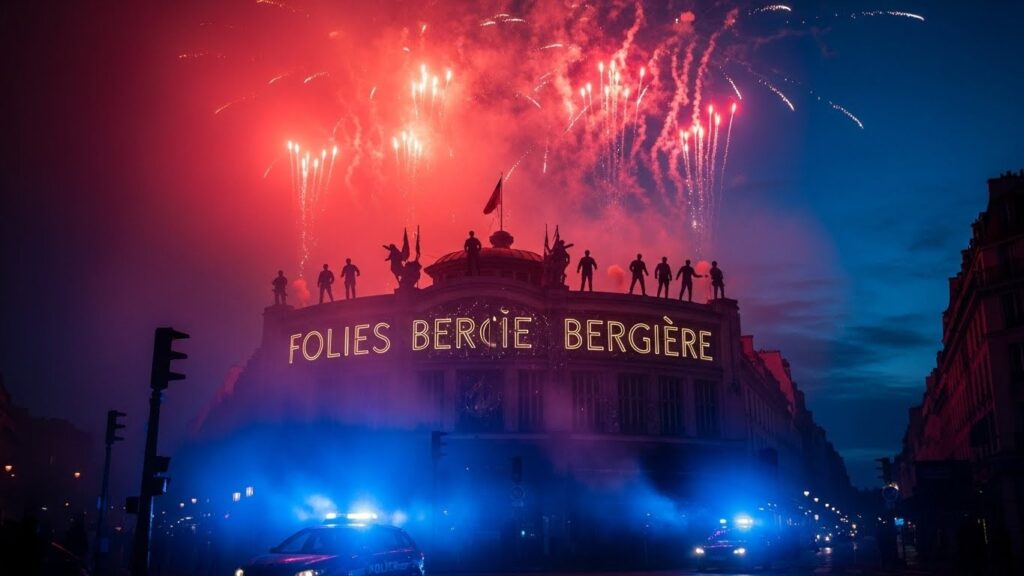Il y a des moments où l’on se demande ce qu’on ferait vraiment si l’Histoire cognait à notre porte. Pas dans un film, pas dans un livre, mais pour de vrai, avec le bruit des sirènes et la poussière des immeubles qui s’effondrent. Certains Français, eux, ont cessé de se poser la question. Ils ont pris un billet de train, parfois menti à leurs proches, et ils sont partis. Direction l’Ukraine, en guerre depuis bientôt quatre ans.
Ils ne portent pas d’arme. Ils ne savent pas toujours ce qu’ils vont trouver là-bas. Mais ils y vont quand même. Parce que rester chez soi, devant les infos, ça finit par devenir insupportable.
Un engagement qui ne fait pas la une
On parle beaucoup des soldats, des drones, des négociations à haut niveau. Beaucoup moins de ces civils français qui, chaque mois, posent une ou deux semaines de congés pour aller réparer des écoles, distribuer des médicaments ou simplement tenir la main de quelqu’un qui a tout perdu. Pourtant, ils sont plusieurs centaines à avoir fait le voyage depuis 2022. Et ils continuent.
Ce qui frappe, c’est leur profil. Pas des baroudeurs ni des anciens militaires. Des gens comme vous et moi. Un développeur web de Nantes. Une professeure d’anglais de Lyon. Un retraité de la fonction publique qui n’avait jamais quitté l’Europe avant ses 68 ans. Ils ont tous une phrase qui revient, presque mot pour mot : « Je sais maintenant ce que j’aurais fait en 1940. »
Samuel, 24 ans, la PlayStation et le testament
Samuel s’en souvient comme si c’était hier. Il avait 14 ans. Dans la voiture, la radio annonçait l’annexion de la Crimée. Son père avait lâché : « Ça, c’est un moment qui marque. » Dix ans plus tard, en août 2024, il pose trois semaines de congés. À ses parents, il parle de randonnée en Pologne. En réalité, il prend un bus pour Kharkiv, à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front.
Avant de partir, il rédige un petit mot, mi-sérieux mi-goguenard : « Si je ne reviens pas, je lègue ma PS5 à mon frère. » Il rit encore en le racontant. Mais il l’a fait. Parce que oui, on peut mourir là-bas. Une roquette perdue, un drone kamikaze, une erreur de ciblage. Ça arrive.
« J’ai vu des immeubles éventrés, des trous béants là où il y avait des salons, des cuisines. Et puis des gamins qui jouaient au foot au milieu des gravats. Ça te remet les idées en place. »
Samuel, volontaire à Kharkiv
Aider sans avoir de sang sur les mains
C’est la ligne rouge pour presque tous. Pas question de prendre une arme. On est là pour la deuxième ligne, disent-ils. Réparer des fenêtres avant l’hiver. Décharger des camions de couvertures. Accompagner des personnes âgées jusqu’aux abris quand les sirènes hurlent à 3 heures du matin. Des gestes simples, concrets, qui changent la vie de quelqu’un.
Et pourtant, le danger est bien réel. À Kharkiv, les frappes sont quotidiennes. Les volontaires appliquent la règle des deux murs : en cas d’explosion proche, se mettre derrière deux murs porteurs pour limiter les effets du souffle. Ça devient une habitude. Comme vérifier son téléphone pour les alertes aériennes avant de sortir acheter du pain.
- Distribuer des générateurs électriques dans des villages sans électricité depuis des mois
- Aider à reconstruire des toits avant les premières neiges
- Apporter des jouets dans des sous-sols transformés en écoles
- Écouter. Simplement écouter ceux qui n’ont plus personne à qui parler
Ce dernier point, beaucoup le soulignent. Parfois, la présence compte plus que le matériel.
Un miroir tendu à notre propre histoire
Pourquoi la France, plus que d’autres pays ? La question revient souvent. Il y a bien sûr la proximité géographique, la facilité des vols low-cost jusqu’en Pologne puis des bus de nuit. Mais il y a autre chose. Une mémoire collective. Quand on voit des villes bombardées, des civils qui se terrent dans le métro, des gamins qui dessinent des chars sur leurs cahiers… ça réveille quelque chose.
Beaucoup parlent de leurs grands-parents. De ceux qui ont caché des juifs, fait passer des messages, ou simplement refusé de baisser les yeux. « On se dit que si eux l’ont fait sous l’Occupation, on n’a aucune excuse aujourd’hui », confie une volontaire de 52 ans, ancienne cadre dans la banque.
Ce n’est pas de la grande histoire avec un grand H. C’est intime. Presque une dette personnelle.
Le prix à payer, et celui qu’on accepte
Évidemment, tout ça a un coût. Un billet aller-retour, même en prenant les options les moins chères, c’est 300 à 500 euros. Les hébergements sur place, même chez l’habitant, ce n’est pas gratuit. Sans parler des jours de congé sacrifiés. Et puis il y a l’angoisse des proches. Les appels quotidiennes pour dire « ça va, je suis en vie ».
Certains employeurs comprennent. D’autres beaucoup moins. Une jeune femme a été licenciée à son retour – officiellement pour une autre raison, bien sûr. Elle ne regrette rien.
« J’ai passé dix jours à trier des médicaments dans un entrepôt glacé. Mes doigts ne sentaient plus rien. Mais quand une mamie m’a serrée dans ses bras en pleurant parce qu’on lui apportait enfin ses cachets pour le cœur… franchement, mon salaire du mois, je l’aurais donné dix fois. »
Et demain ?
Quatre ans après le début de l’invasion, la fatigue se fait sentir. Chez les Ukrainiens, bien sûr. Mais aussi chez les volontaires. Certains ont fait cinq, six missions. Ils commencent à parler de burn-out. D’autres, au contraire, se disent prêts à repartir tant qu’il le faudra.
Ce qui est sûr, c’est que cet engagement discret continuera tant que la guerre durera. Parce que pour eux, rentrer et reprendre une vie normale en sachant que des civils vivent encore sous les bombes, c’est tout simplement impossible.
Alors oui, ils ne sont pas nombreux. Quelques centaines face à des millions qui regardent ailleurs. Mais ils sont là. Et parfois, dans le chaos d’une guerre qu’on croyait impossible en Europe au XXIe siècle, c’est déjà énorme.
Si vous vous êtes déjà demandé ce que vous feriez, vraiment, si l’Histoire vous mettait à l’épreuve… peut-être que ces Français ordinaires ont déjà répondu à votre place.
(Article basé sur de nombreux témoignages recueillis auprès de volontaires ayant effectué des missions humanitaires civiles en Ukraine entre 2022 et 2025. Tous les prénoms ont été modifiés pour préserver leur anonymat.)