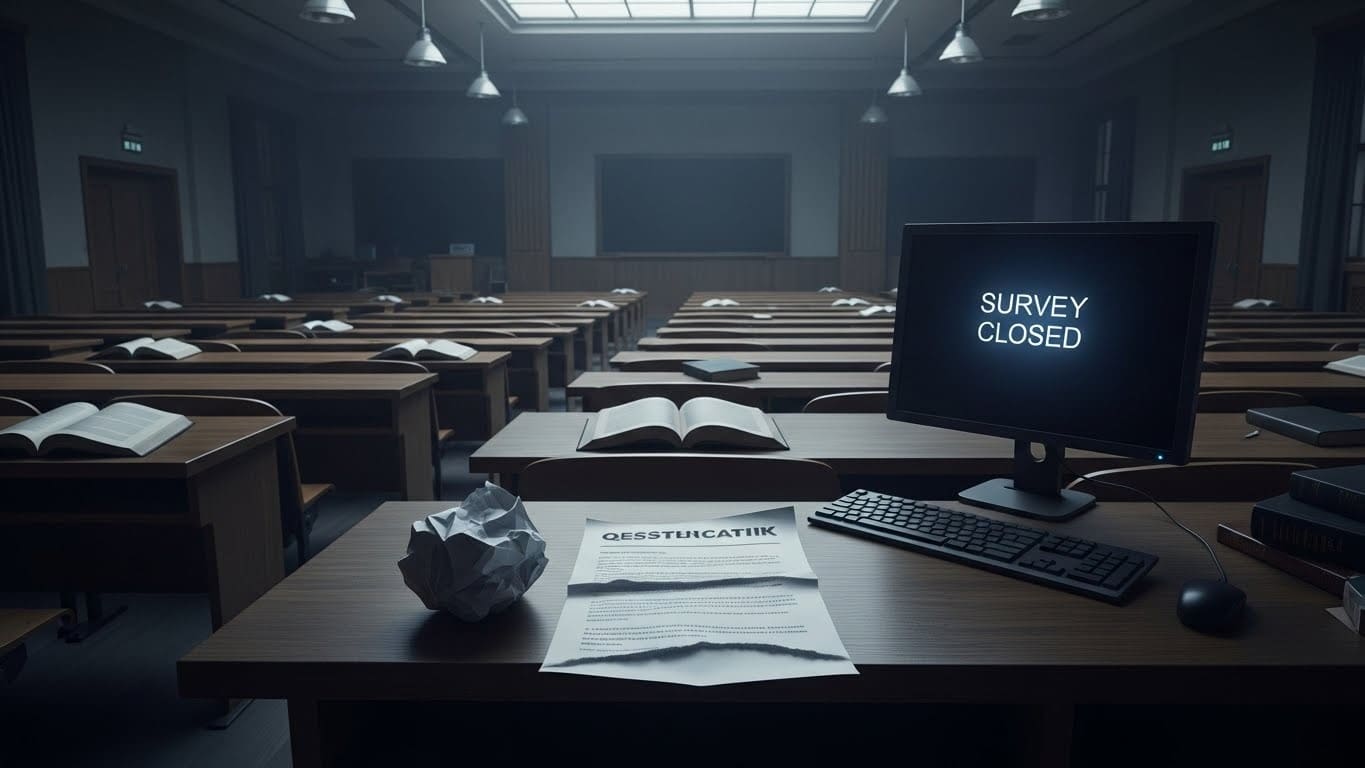Imaginez : vous ouvrez votre boîte mail professionnelle un matin et vous tombez sur un questionnaire de 44 pages qui vous demande si vous pensez que « les juifs sont globalement plus riches que la moyenne des Français ». Vrai, plutôt vrai, plutôt faux, faux ? Et vous, enseignant ou chercheur, vous êtes censé répondre en toute sérénité. Franchement, qui a eu cette idée ?
C’est pourtant ce qui est arrivé à des milliers de personnels universitaires il y a quelques semaines. Un sondage sur l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, commandé directement par le ministère, a déclenché une tempête que personne n’avait vraiment anticipée. Et mardi, l’enquête a été purement et simplement retirée. Fin de l’histoire ? Pas vraiment.
Un sondage qui a mis le feu aux poudres dès le départ
Retour en arrière. Le ministère de l’Enseignement supérieur décide, dans un contexte où les actes antisémites sont en hausse partout en France, de mieux comprendre ce qui se passe dans les facs et les grandes écoles. Objectif louable sur le papier. Pour cela, il confie la mission à un centre de recherche reconnu et à un institut de sondage expérimenté. Jusque-là, rien de choquant.
Mais quand le questionnaire commence à circuler, c’est la stupeur. Les questions ne se contentent pas de demander si on a été témoin d’actes antisémites. Non. Elles vont beaucoup plus loin. On vous demande de vous positionner sur des affirmations qui ressemblent furieusement à des stéréotypes séculaires : les juifs et l’argent, les juifs et le pouvoir, les juifs et la loyauté envers la France… Bref, le genre de phrases qu’on préférerait ne plus jamais entendre, surtout dans un cadre officiel.
« Globalement les juifs sont plus riches que la moyenne des Français » – une des affirmations proposées à évaluation dans le sondage.
Autant dire que ça a fait l’effet d’une bombe dans la communauté universitaire. Des enseignants-chercheurs de tous horizons politiques se sont sentis profondément mal à l’aise. Certains y ont vu une forme de normalisation des préjugés sous couvert de science. D’autres ont craint que, même en répondant « tout à fait faux », le simple fait de poser la question valide l’idée que ces clichés méritent débat.
Un problème de méthode ou un problème de fond ?
Les critiques n’ont pas tardé. Et elles n’étaient pas uniquement émotionnelles. Des syndicats, des associations de défense des droits, et même des juristes ont pointé du doigt des failles sérieuses.
- Le questionnaire était-il vraiment anonyme ? Plusieurs indices laissaient penser que non.
- Était-il obligatoire ? Non, mais il était diffusé via les listes institutionnelles, ce qui créait une pression implicite.
- Les questions sur l’âge, le genre, la discipline, le positionnement politique et la religion permettaient-elles de ré-identifier les répondants dans certains établissements de petite taille ? Probablement.
- Et surtout : était-il pertinent de demander à des personnels de se positionner sur des stéréotypes antisémites pour mesurer… l’antisémitisme ?
J’ai lu le questionnaire en entier – oui, les 44 pages – et franchement, on a l’impression de remonter le temps. Certaines formulations rappellent les pires heures du XXe siècle. Même si l’objectif était de mesurer l’adhésion à ces idées, la méthode choisie a paru à beaucoup contre-productive, voire dangereuse.
Une mobilisation express et un recours en justice
En quelques jours seulement, la contestation s’est organisée. Des présidents d’université ont refusé de relayer le questionnaire. Des collectifs se sont montés. Et surtout, un recours en référé-liberté a été déposé devant le Conseil d’État.
Les requérants ne demandaient pas la lune : juste que l’enquête soit suspendue le temps qu’un juge se prononce sur sa légalité. Car pour eux, il y avait atteinte grave à la liberté de conscience et risque sérieux pour la protection des données personnelles.
Le gouvernement a préféré couper court. Plutôt que d’attendre une décision judiciaire qui aurait pu faire jurisprudence, il a choisi de retirer purement et simplement le sondage. Message affiché quand on clique sur le lien : « Il a été convenu de mettre un terme à l’enquête ».
Mais alors, mission accomplie pour les opposants ?
Pas totalement. Car plusieurs questions restent en suspens, et elles sont lourdes.
Premièrement : que va-t-il advenir des données déjà collectées ? Des centaines, peut-être des milliers de personnes ont déjà répondu avant le retrait. Ces réponses contiennent des informations sensibles – positionnement politique, religion, opinions sur des sujets explosifs. Même si l’anonymat était promis, rien ne garantit qu’elles seront détruites.
Deuxièmement : est-ce que ce retrait signifie que le sujet de l’antisémitisme à l’université est enterré ? Certainement pas. Le problème existe, les chiffres le montrent, les témoignages aussi. Mais la méthode choisie était manifestement la mauvaise.
Comment faire autrement ?
La vraie question, maintenant, c’est : comment mesurer un phénomène aussi complexe sans tomber dans les pièges qui viennent de se produire ?
Quelques pistes, à mon avis :
- Commencer par les victimes. Recueillir les signalements, les témoignages, les plaintes déposées. C’est déjà une mine d’informations objectives.
- Travailler avec les associations représentatives de la communauté juive, qui connaissent les formes contemporaines de l’antisémitisme.
- Privilégier des questions factuelles : « Avez-vous été témoin ou victime d’insultes, de tags, de menaces ? » plutôt que de demander aux gens s’ils adhèrent à des clichés.
- Garantir un anonymat absolu, validé par la CNIL dès le départ.
- Et surtout, associer largement la communauté universitaire à la conception de l’enquête. Pas la mettre devant le fait accompli.
Parce que le risque, quand on impose une méthode contestable, c’est de discréditer toute tentative future. Et là, tout le monde perd : ceux qui luttent contre l’antisémitisme, et ceux qui veulent un débat apaisé sur les campus.
Un climat universitaire déjà sous tension
Il faut le dire clairement : cette affaire ne sort pas de nulle part. Les universités françaises traversent une période particulièrement difficile. Débats enflammés sur la situation au Proche-Orient, manifestations, occupations, incidents parfois violents… Le sujet est ultra-sensible.
Dans ce contexte, chaque initiative est scrutée à la loupe. Et quand une enquête officielle donne l’impression de reprendre à son compte des stéréotypes antisémites, même pour les mesurer, la confiance s’effondre. C’est humain.
Moi qui ai passé pas mal d’années sur les bancs de la fac (et qui y retourne souvent), je peux vous dire une chose : les étudiants et les enseignants ont envie de parler. Ils ont envie que les choses soient dites et réglées. Mais ils veulent aussi être respectés. Et là, le respect a clairement manqué.
Et maintenant ?
Le retrait du sondage est une bonne chose. Ça évite une bataille judiciaire longue et douloureuse. Mais ça ne doit pas être la fin de l’histoire.
Le ministère a annoncé vouloir continuer à « documenter » le phénomène. Espérons qu’il tirera les leçons de cet échec. Parce que l’antisémitisme, lui, ne prend pas de pause. Il continue de gangrener certains discours, certaines attitudes, certains silences aussi.
Ce qui est sûr, c’est que cette polémique aura au moins servi à quelque chose : rappeler que la lutte contre la haine ne peut pas se faire n’importe comment. Surtout pas en reprenant, même involontairement, le langage de ceux qu’on prétend combattre.
Et vous, qu’en pensez-vous ? Avez-vous reçu ce questionnaire ? Avez-vous été choqué par les formulations ? Ou pensez-vous au contraire qu’il fallait poser ces questions brutales pour faire émerger la vérité ? Les commentaires sont ouverts. Discutons-en calmement. C’est aussi ça, l’université.