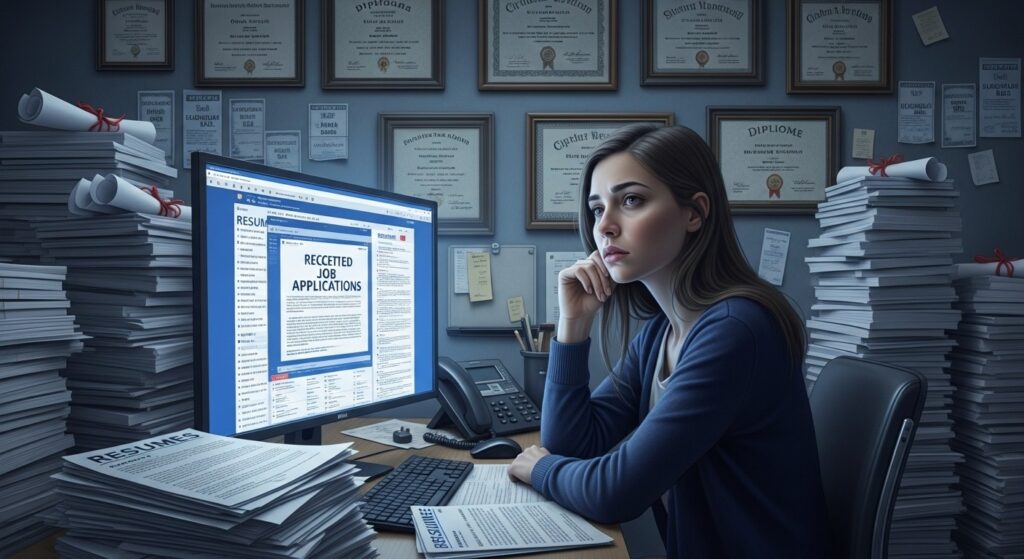Vous souvenez-vous de cette photo, fin octobre, où les délégués thaïlandais et cambodgiens se serraient la main devant un Donald Trump tout sourire ? On parlait alors d’accord « historique ». Deux mois plus tard, la réalité rattrape la mise en scène : des morts, des bombardements aériens, des dizaines de milliers de civils en fuite. La frontière entre la Thaïlande et le Cambodge s’est embrasée à nouveau, et cette fois, ça sent la poudre plus sérieusement qu’on ne veut bien l’admettre.
Franchement, quand on suit les relations entre ces deux voisins depuis vingt ans, on a parfois l’impression de revivre le même film en boucle. Un temple, une carte coloniale mal dessinée, des nationalismes qui se réveillent au moindre incident… et hop, les armes parlent. Sauf que là, on est passé à la vitesse supérieure : on parle d’avions de chasse et de villages rasés.
Un cessez-le-feu qui n’aura tenu que quelques semaines
Reprenons depuis le début, ou presque. Octobre 2025, sommet à Kuala Lumpur. Sous pression américaine, les deux pays signent un texte censé clore des années de crispations autour du tracé frontalier, notamment près du célèbre temple de Preah Vihear. Retrait des armes lourdes, déminage, dialogue renforcé : tout y est. On évite même de rouvrir le débat sur la décision de la Cour internationale de justice de 1962 qui avait donné raison au Cambodge pour le temple lui-même – un sujet qui met Bangkok hors de lui.
Mais dès novembre, ça coince. Une mine explose, quatre soldats thaïlandais sont blessés. Bangkok crie à la provocation et suspend unilatéralement l’accord. Phnom Penh jure ses grands dieux qu’il s’agit de vieilles mines datant des années de guerre civile. Rien n’y fait. Les discussions s’enlisent, les troupes restent sur place, et la mèche finit par s’allumer.
La nuit où tout a basculé
Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2025, les premiers coups de feu retentissent dans la province thaïlandaise d’Ubon Ratchathani et, côté cambodgien, dans les provinces de Preah Vihear et Oddar Meanchey. Chacun accuse l’autre d’avoir commencé. Classique.
Ce qui l’est moins, c’est la réponse thaïlandaise : des chasseurs F-16 décollent pour des frappes ciblées sur ce que l’armée qualifie de « positions de soutien de tir cambodgiennes ». Le porte-parole militaire insiste : « précision chirurgicale, zéro impact civil ». Sur le terrain, les témoignages racontent une autre histoire : des villages touchés, des habitants paniqués qui traversent les rizières avec enfants et matelas sur la tête.
« À toutes les forces sur le front, veuillez faire preuve de patience. La ligne rouge pour riposter a été fixée. »
Hun Sen, président du Sénat cambodgien et homme fort du pays
Cette phrase, postée sur les réseaux en plein milieu des bombardements, en dit long. Hun Sen, habitué aux crises, sait que la moindre riposte trop visible pourrait justifier une escalade thaïlandaise encore plus forte. Mais jusqu’à quand peut-on demander à des soldats de se faire tirer dessus sans réagir ?
Un bilan déjà lourd
À l’heure où j’écris ces lignes, les chiffres officiels divergent – comme toujours dans ce genre de situation.
- Côté thaïlandais : 1 soldat tué, 8 blessés, environ 35 000 personnes évacuées dans la nuit.
- Côté cambodgien : au moins 4 civils tués, une dizaine de blessés, des villages partiellement détruits.
Des sources locales parlent déjà de chiffres plus élevés, mais rien n’est confirmé. Ce qui est sûr, c’est que des familles entières dorment maintenant dans des gymnases ou sous des bâches en plastique, de part et d’autre de la ligne.
Pourquoi ce conflit refuse de mourir
On pourrait se contenter de dire « c’est à cause du temple ». Oui, mais pas seulement. Le différend autour de Preah Vihear cristallise des frustrations bien plus profondes.
D’abord, il y a l’héritage colonial. La frontière a été tracée au début du XXe siècle par des officiers français qui, disons-le, n’avaient pas le GPS. Résultat : des cartes contradictoires, des zones grises, et surtout une humiliation nationale pour la Thaïlande qui n’a jamais digéré la décision de La Haye en 1962.
Ensuite, il y a la politique intérieure. À Bangkok comme à Phnom Penh, agiter le drapeau national quand les tensions montent est une vieille recette pour faire oublier les problèmes domestiques. Et en ce moment, les deux gouvernements en ont besoin : inflation, jeunesse qui réclame plus de libertés, corruption… rien de tel qu’un bon vieux conflit frontalier pour resserrer les rangs.
Enfin, il y a les mines. Des milliers, posées pendant les années Khmer rouge et les conflits suivants, qui continuent de mutiler. Chaque explosion est accusée d’être volontaire par l’autre camp. C’est le cercle vicieux parfait.
Et maintenant ?
L’ASEAN, l’organisation régionale, appelle au calme – comme d’habitude. La Chine, grand partenaire des deux pays, reste discrète mais certainement active en coulisses. Quant aux États-Unis, ils regardent ça de loin : l’accord d’octobre était une belle opération de communication pour la nouvelle administration Trump, mais personne n’a vraiment envie d’envoyer des GI dans la jungle pour un bout de rocher.
Le risque, c’est l’engrenage. Si le Cambodge décide de riposter sérieusement – et il en a les moyens, avec du matériel russe récent –, on pourrait vite basculer vers quelque chose de beaucoup plus grave. Et là, plus personne ne contrôlerait grand-chose.
J’ai couvert pas mal de crises dans ma vie, mais celle-ci a un goût particulier. Parce qu’elle était évitable. Parce qu’on avait presque réussi à y mettre fin. Parce que des familles paient aujourd’hui le prix d’egos et de cartes mal dessinées il y a plus d’un siècle.
Pour l’instant, les canons se sont tus en début d’après-midi ce 8 décembre. Mais tout le monde sait que c’est peut-être juste une pause. La frontière reste une poudrière. Et la prochaine étincelle pourrait bien être la bonne.
À suivre, malheureusement, de très près.